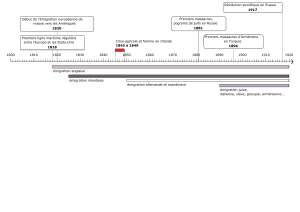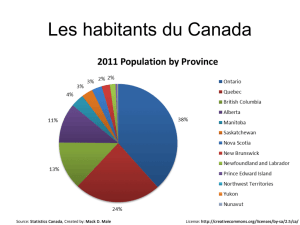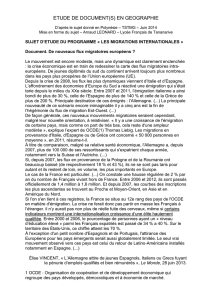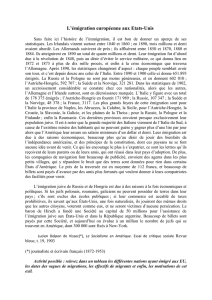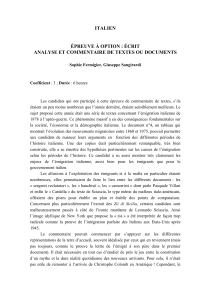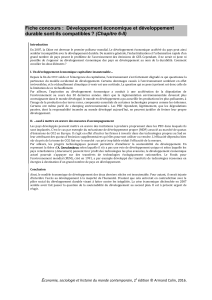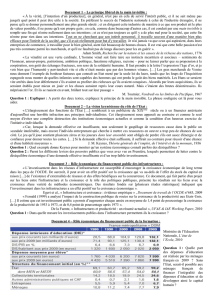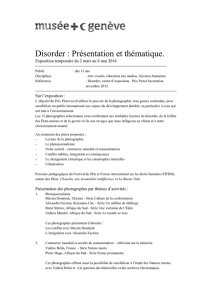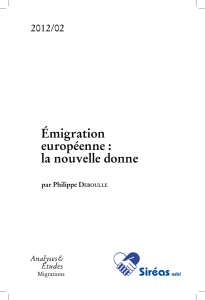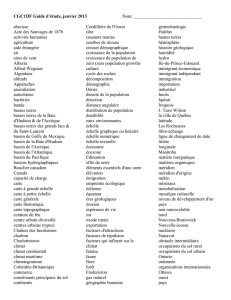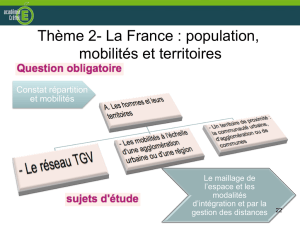les français à l`étranger. d`un “modèle colonial”

À la différence d’un certain nombre de ses voisins européens (Por-
tugal, Grande-Bretagne, Italie, Espagne), la France n’est pas perçue
comme un pays d’émigration. On estime que sur les 51,7 millions de
départs d’Europe ayant eu lieu entre 1850 et 1930, la Grande-Bretagne
en représentait 22 % (11,4 millions), l’Italie 19,1 % (9,9 millions) et
l’Irlande 14,1 % (7,3 millions), alors que seuls 2,4 millions de Fran-
çais ont quitté l’Hexagone entre 1830 et 1917. Un siècle plus tard, les
départs de France sont toujours relativement modestes. Par contre,
ils n’ont plus pour principales motivations des raisons politiques ou
religieuses, mais plutôt un désir personnel de vivre à l’étranger ou des
impératifs professionnels. Ainsi, on constate une augmentation régu-
lière de la présence française à l’étranger depuis 1970(1).
L’époque de l’émigration définitive est révolue, elle a fait place à
celle de “l’expatriation”. En effet, on parle aujourd’hui beaucoup plus
fréquemment d’expatriation que d’émigration, car la durée du séjour
à l’étranger est plus courte que par le passé. L’importance numérique
du premier type d’émigration, également appelée “émigration tradi-
tionnelle”, est difficile à préciser. On estimait qu’elle représentait
entre 20 % et 30 % des “stocks” des départs en 1976(2). Les départs
définitifs semblent maintenant plus rares, sans doute autour de 5 %
à 10 %, et ils s’effectuent souvent à l’occasion d’un mariage mixte.
Les autres, soit 90 % à 95 % des départs, ont pour objet une mission
plus ou moins brève, comprise dans la plupart des cas entre deux et
cinq ans maximum. La mobilité internationale des Français prend
la forme d’une multitude de statuts administratifs : le détachement,
l’expatriation, le contrat local, les allers et retours dans le cadre de
N° 1233 - Septembre-octobre 2001 -
28
NOUVELLES MOBILITÉS
LES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER.
D’UN “MODÈLE COLONIAL” À
LA CIRCULATION DES ÉLITES
par
Béatrice Verquin,
docteur
en géographie,
membre
de Migrinter*
La France a peu contribué aux flux d’émigrants partis d’Europe au cours
des deux derniers siècles. Même ses colonies ont, à l’époque, remporté
peu de succès – il semble que les Français aient toujours privilégié les
pays développés ou lointains. Aujourd’hui, près de deux millions d’entre
eux vivent à l’étranger et ils sont de plus en plus nombreux à partir, pour
des durées de plus en plus courtes. Ce sont essentiellement des expatriés
qualifiés participant à la circulation internationale des élites profession-
nelles, attirés par les grandes métropoles et les régions économiquement
prometteuses plutôt que par les pays traditionnellement liés à la France.
* Migrinter,
CNRS-UMR 6588, MSHS,
99, avenue du Recteur-Pineau,
86000 Poitiers,
www.mshs.univ-poitiers.fr/
migrinter/membres/verquin.htm
1)- Au cours de la période
1970-2000, la population
française établie à l’étranger
est passée de 1,1 à 1,8 million
de personnes. Cf. Béatrice
Verquin, “Français établis
hors de France. Définitions,
délimitations, sources et
concepts”, in Dynamiques
migratoires et rencontres
ethniques, L’Harmattan,
Paris, 1998, p. 73-86.
2)- Voir Paul Balta,
“Les Français ‘de’
et ‘à’ l’étranger”, Le Monde,
n° 18-19, 20 et 21 juin 1976.

l’Union européenne (appelés encore “euro-commuting”). De là se
dégagent trois grandes catégories : les “émigrés”, les “résidents per-
manents” et les “détachés”.
Les “émigrés” seraient, selon les sources consulaires, nombreux en
Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Nés français ou descen-
dants de Français, ils vivent définitivement à l’étranger et ont cessé
d’avoir des liens avec l’administration française. Actuellement double
nationaux, ils perdront – eux-mêmes ou leurs enfants – leur nationa-
lité française par désuétude, passé un délai de cinquante ans, pour cause
de non-possession d’état de français(3). Les résidents permanents consti-
tueraient quant à eux 90 % des Français enregistrés dans les consulats
de France. Leur durée de séjour est supérieure à trois ans. Par l’imma-
triculation consulaire, ils témoignent de leur volonté de rester français
et de transmettre cette nationalité à leurs enfants, même si plus de 45 %
d’entre eux ont aussi la nationalité de leur pays d’accueil. On peut les
associer aux “locaux”, car leur statut social et leur niveau de revenus
sont équivalents à ceux de leurs homologues dans le pays de résidence.
Enfin, les “détachés” – diplomates, fonctionnaires, cadres et techniciens
de grandes entreprises – ne constitueraient que 10 % de la population
immatriculée, et pour cause, avec leur protection statutaire, leur contrat
de travail et leurs primes, ils forment la partie la plus enviée et en vue,
mais très minoritaire des ressortissants français à l’étranger.
UNE PRÉSENCE FRANÇAISE TARDIVE
ET ASSEZ FAIBLE
On a vu que la France n’a pas connu, contrairement à ses voisins,
le puissant mouvement d’émigration qui a touché l’Europe pendant
la deuxième moitié du XIXesiècle et au début du XXe, au moment de
la grande poussée démographique du continent. L’émigration coloniale
ne connut pas plus de succès que l’émigration lointaine, au point que
l’on peut presque affirmer que la France a colonisé de nombreux ter-
ritoires non pas grâce à l’émigration massive de ses ressortissants, mais
plutôt en naturalisant des Espagnols et des Italiens. Certes, quelques
Français sont partis vers les colonies, mais parmi eux, les militaires
et les fonctionnaires en mission temporaire étaient de loin majori-
taires ; les colons, c’est-à-dire les émigrants décidés à rester, ont été
en définitive très peu nombreux. Il a fallu des circonstances particu-
lières, comme les crises économiques et politiques de 1848 et 1851,
l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne ou la crise du phylloxéra
pour qu’au cours du XIXesiècle, l’émigration vers les colonies prenne
un certain volume. Encore s’agira-t-il presque exclusivement de
départs pour l’Algérie !
N° 1233 - Septembre-octobre 2001 -
29
NOUVELLES MOBILITÉS
3)- La “possession d’état
de français” est établie par
la production de documents
officiels tels que la carte
d’identité, la carte d’électeur,
les pièces militaires,
l’immatriculation consulaire,
le passeport, donc par
l’existence de relations
administratives avec
les autorités françaises.

L’émigration au XIXesiècle affectait surtout les régions rurales et
pauvres, situées au sud d’une ligne Bordeaux-Annecy (le Pays basque,
l’Alsace-Lorraine et les Alpes), à l’exception de Paris et des départe-
ments de l’Est (voir carte p. 31). Dans les départements qui ont fourni
le plus grand nombre d’émigrants – les Basses-Pyrénées (33 641), la
Gironde (13 313), les Hautes-Pyrénées (10 892) et la Seine (10 555) –,
peu d’emplois s’offraient aux fils d’agriculteurs, alors même que les
activités artisanales du monde rural périclitaient. L’émigration bre-
tonne démarra plus tardivement, à la fin du XIXesiècle, ce qui
explique que cette région ne figure pas encore, en 1943, date de réfé-
rence pour l’élaboration de la carte, parmi celles où l’on recense un
nombre important de départs. Cette émigration “du malheur”(4) fut
essentiellement composée d’individus seuls, partant s’établir défi-
nitivement à l’étranger. Dès lors, nous observons qu’à cette époque
déjà, les Français effectuent un choix préférentiel pour certains pays,
notamment pour les États-Unis et leurs voisins européens, alors qu’on
les attendait dans les colonies d’Afrique et d’Asie.
L’attraction pour les pays développés, si l’on en croit les statistiques
des destinations des émigrants, semble par conséquent être l’une des
caractéristiques permanentes de l’émigration française, ainsi que la
relative qualification de ceux qui partent(5). L’analyse de cette répar-
tition géographique qui favorise les pays “étrangers” plutôt que les colo-
nies françaises invite à penser qu’elle résulte d’une recherche de nou-
veauté, d’une possibilité plus grande d’innovation. Partir aux colonies,
c’était retrouver les mêmes structures françaises et se heurter à la
rigidité de l’administration ; dans ce cas, comment se réaliser en dehors
des cadres habituels ? En comparaison, les autorités britanniques ont
assez vite compris ce besoin de réalisation personnelle des colons, puis-
qu’ils ont créé un certain nombre de zones de libre-échange ; ce type
d’espaces économiques offrait des possibilités de commerce plus
flexibles, et cela explique sans doute en partie que les Britanniques
aient été davantage présents dans leurs colonies que les Français.
LA FAIBLE ATTRACTION MIGRATOIRE
DES COLONIES
Si l’on analyse les destinations de l’émigration française en 1912
(voir carte p. 35), on observe que l’émigration “outre-mer”, c’est-à-
dire vers l’étranger lointain, est restée voisine de 40 % du total de
l’émigration française jusqu’à la période comprise entre 1911 et 1920.
Les départs à l’étranger (hors Europe) représentent les effectifs les
plus importants d’émigrants. Toutefois, ils diminuent au point d’at-
teindre à peine 20 % de l’émigration totale entre 1931 et 1940. Les
N° 1233 - Septembre-octobre 2001 -
30
NOUVELLES MOBILITÉS
4)- René Rémond,
Les États-Unis
dans l’opinion française
(1815-1852), Armand Colin,
Paris, 1962, 967 p.
5)- Centre de recherches
d’histoire nord-américaine,
L’émigration française.
Étude de cas, Algérie,
Canada, États-Unis,
Publications de la Sorbonne,
Paris, 1985, 269 p.

N° 1233 - Septembre-octobre 2001 -
31
NOUVELLES MOBILITÉS
DÉPARTEMENTS D’ORIGINE DES FRANÇAIS ÉMIGRÉS
À LA FIN DU XIX
e
SIÈCLE
Source : Henri Bunle, Études démographiques, n° 4, 1943.
Nombre d’émigrants par départements
33 500
0100 Km
10 600 à 13 300
3 200 à 6 400
1 100 à 2 900
1 000
B. Verquin, Migrinter, Poitiers, 2000.

mesures restrictives à l’entrée des pays d’immigration, la crise de 1929,
particulièrement sévère aux États-Unis, permettent de comprendre
les changements observés. Il semble que les États-Unis et l’Argen-
tine, suivis de l’Uruguay, accueillent constamment le plus grand
nombre de Français émigrés hors du continent européen.
L’émigration coloniale est relativement faible comparée aux des-
tinations étrangères. Elle semble avoir diminué de 1851 à 1890, en
raison de la guerre de 1870, de l’insurrection de 1871, de la famine,
du typhus et du choléra qui ont sévi en Algérie. Entre 1891 et 1900,
les crises de l’agriculture en France et le début de l’occupation de la
Tunisie expliquent la hausse des départs
aux colonies. Elle baisse très fortement
entre 1901 et 1910 pour atteindre son
niveau le plus bas, puis augmente légè-
rement à partir de 1911, mais la guerre
de 1914-1918 contrarie la colonisation,
en particulier au Maroc. Toutefois, à
partir de 1921, elle augmente considérablement, et entre 1931-1940,
elle représente près de la moitié des départs (43,5 %). Ce sont les
colonies d’Afrique du Nord, en particulier l’Algérie, qui reçoivent le
plus grand nombre de colons. Cette implantation prédominante s’ex-
plique facilement ; la politique de l’État français favorise en priorité
le peuplement de cette colonie, même si, au final, elle s’avéra être
un échec(6).
L’émigration française en Europe connaît une évolution très irré-
gulière mais se maintient relativement bien dans l’ensemble, avec un
maximum durant la période 1901-1910. Entre 1931 et 1935, elle se
classe au second rang derrière l’émigration coloniale, en raison sur-
tout de la baisse générale de l’émigration outre-mer. Ses principales
destinations sont la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Espagne.
L’Allemagne est également concernée par ce phénomène, même si le
recensement des Français y est difficilement réalisable du fait des
changements constants de souveraineté sur l’Alsace-Lorraine. Pour
l’ensemble de la période 1851-1940, il apparaît nettement que les
départs pour l’étranger lointain (hors Europe), dont la destination la
plus prisée est les États-Unis, ont été les plus nombreux, soit 88 400
individus (48 % de l’émigration totale). L’émigration coloniale vient
en deuxième position avec 55 500 personnes (30 %). L’Europe, quant
à elle, attire faiblement les Français, soit 39 700 émigrés (22 %).
On observe ainsi une évolution de la répartition des Français entre
le XIXeet le XXesiècles. L’émigration proche à destination de l’Eu-
rope tend à être remplacée par des départs lointains ou coloniaux.
N° 1233 - Septembre-octobre 2001 -
32
NOUVELLES MOBILITÉS
La répartition spatiale des Français,
concentrée dans l’hémisphère Nord,
illustre à elle seule
leur représentation mentale du monde.
6)- Voir Yvette Katan,
“Le ‘voyage organisé’
d’émigrants parisiens
vers l’Algérie”, in Centre
de recherche d’histoire nord-
américaine, L’émigration
française, op. cité, pp. 17-47 ;
Alain Lardillier,
Le peuplement français
en Algérie de 1830 à 1900 :
les raisons de son échec,
L’Atlanthrope, Versailles,
1982, 108 p. ; Camille Maire,
“L’eldorado en Algérie ?”,
in En route pour l’Amérique.
L’odyssée des émigrants
en France au XIXesiècle,
Presses universitaires
de Nancy, Paris, 1993,
pp. 124-138.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%