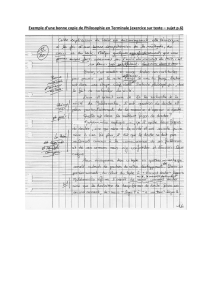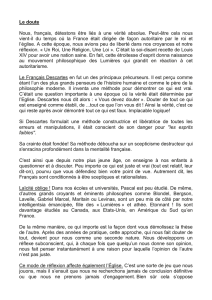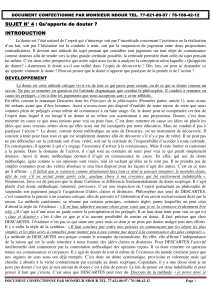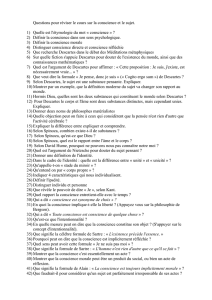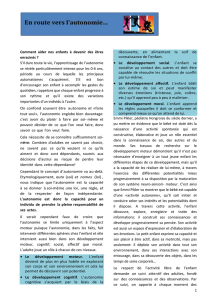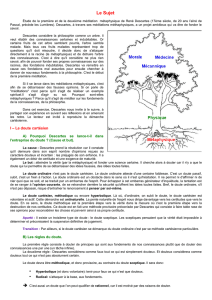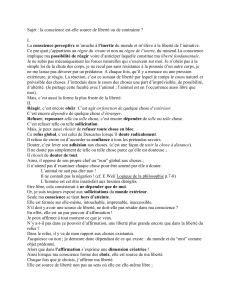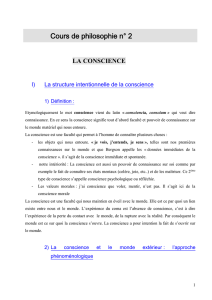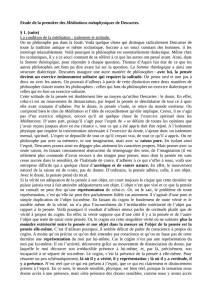Document

Texte de N. Malebranche, De la Recherche de la vérité, I, chapitre XX, extrait.
Remarques liminaires : a) ce qui suit n’est qu’une ébauche de plan, et non un commentaire complet : lors de la
rédaction finale, il conviendra surtout de ne pas se contenter de juxtaposer les arguments, et de développer
certainement davantage ; b) tout ce qui figure ici entre crochets droits, toute indication correspondant à la démarche
suivie, comme les notes de bas de page et les numéros des paragraphes, devront disparaître dans un devoir.
[Introduction]
[Objet du texte]
Dans ce passage qui forme l’essentiel de la conclusion du Livre I de La Recherche de la vérité,
Malebranche distingue et oppose l’une à l’autre deux manières très différentes de douter, l’une se
réduisant à un « doute de ténèbres », l’autre qui « naît de la lumière », la seconde seule permettant de
parvenir à des vérités.
[Position du problème]
Devons-nous douter à la manière des sceptiques et rejeter toute connaissance comme incertaine, ou bien
suivre avant tout la raison, pour savoir faire du doute l’usage qui convient ?
[Moments de l’argumentation]
Dans un premier moment, correspondant au premier paragraphe de l’extrait, Malebranche explicite les
deux formes du doute qui se laissent concevoir. Dans un second moment, il souligne l’importance de la
démarche de Descartes dans ses Méditations métaphysiques, qu’il faut selon Malebranche se garder
soigneusement de mal comprendre ou de mal interpréter.
[1ère partie : explication du 1er moment] Les deux formes du doute.
1) Pour progresser vers la recherche de la vérité, affirme Malebranche, le doute constitue un préalable
indispensable, mais encore doit-il faire l’objet d’un apprentissage. L’auteur s’adresse ici à ceux qui
seraient tentés d’opter pour la facilité et la précipitation, en mettant les esprits en garde contre la tentation
de considérer le doute comme un moyen ridiculement dérisoire de parvenir à des connaissances certaines.
Il convient d’abord de « savoir douter par esprit et par raison », c’est-à-dire de savoir subtilement et
raisonnablement se défier de tout ce qu’on croit suffisamment bien connaître pour l’avoir acquis ou
appris. Sans cet examen préalable, pense Malebranche, l’homme ne pourrait que s’égarer du droit chemin
de la vérité en se laissant aveugler par sa propre présomption.
2) La première manière de douter est celle des ignorants. L’« emportement » et la « brutalité »
caractérisent l’irréflexion. On peut douter par exemple dans un mouvement de colère, parce qu’au lieu de
suivre sa raison qui commande d’acquiescer, on se refuse d’admettre parfois jusqu’à l’évidence : qu’on
s’était trompé soi-même ; ou que la grave maladie de l’être cher faisait qu’il ne pouvait qu’en mourir,
quand bien même cela apparaîtrait comme la dernière des injustices. On peut douter par « brutalité »,
parce que l’erreur qu’on prend à tort pour une vérité fait à ce point corps avec soi qu’on n’hésite pas à
l’asséner autoritairement aux autres, lorsqu’on doute soi-même de la vérité, même la mieux établie. À
cela il est cependant facile de remédier en revenant à davantage de raison.
3) Il n’en va pas de même lorsqu’on en vient à douter « par aveuglement et par malice », ou par
« fantaisie ». Là, un degré supérieur de malignité semble être franchi. Rester durablement aveuglé,
s’entêter dans ses erreurs par obstination de l’esprit, comme le reconnaît la sagesse populaire1, est signe
d’une volonté diabolique, preuve pour le chrétien que l’homme serait voué au mal par sa nature. Il se
trouve aussi des esprits fantaisistes, c’est-à-dire dont la raison serait à ce point déréglée qu’ils iraient
jusqu’à douter pour le simple plaisir de douter. Malebranche vise probablement ici les libertins du XVIIe
siècle, ces prétendus esprits forts qui iraient jusqu’à douter de l’existence du Dieu des chrétiens, ou de la
vérité des dogmes les mieux établis, comme le révèle l’expression : les « académiciens2 et les athées ».
4) La seconde manière de douter est de raisonnablement douter, à la manière de l’homme prudent et avisé
qui pour de bonnes raisons, soucieux de parvenir à la vérité, doute d’abord du témoignage de ses sens. Il
est sage de se défier d’abord de ses sens, en raison des « erreurs des sens », c’est-à-dire des illusions
perceptives auxquelles ceux-là seraient susceptibles de conduire. Là se reconnaissent les « vrais
1 Errare humanum est, perseverare diabolicum.
2 Les académiciens – rien à voir bien entendu avec les membres de l’Académie française, ou ceux de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres – sont ici les représentants de la philosophie antique dominante : Platon, Aristote – cf.
son célèbre « nous autres académiciens », repris par Lucien de Samosate –, Cicéron, etc., qui présentaient tous sans
exception au jugement de Malebranche le défaut d’avoir été des philosophes païens, et par conséquent, dans l’esprit
de l’oratorien, ignorants du seul vrai Dieu, celui du christianisme.

philosophes », tel René Descartes, qui commencent par douter méthodiquement, non par principe, mais
en recherchant une cause possible d’erreur. On commence par avoir l’idée ou l’intuition que tout n’est pas
également assuré, ce qui conduit à faire preuve de clairvoyance, à la différence des esprits faibles qui
s’éloignent toujours davantage eux-mêmes de la « lumière » de la vérité ou de la raison en étant aveuglés
avant tout par leurs passions.
[Conclusion partielle]
On ne peut raisonnablement douter de tout, ni de n’importe quelle manière.
[2ème partie : explication du 2nd moment] Le doute cartésien.
1) Descartes, doutant avec subtilité d’esprit du bien fondé de ses anciennes opinions, apparaît bien,
comme le disait Alain, « le plus hardi douteur que l’on ait vu » (Libres Propos). Loin d’être un esprit
fantaisiste, il se mit à douter par résolution de douter, ce qui le distingue de la figure même du douteur :
alors que le douteur doute parce qu’il hésite constamment, ignore quel parti prendre, et finalement n’ose
rien entreprendre, Descartes fut le fondateur de l’entreprise de questionnement la plus radicale qui ait
jamais été, avec le souci constant de parvenir à des certitudes indubitables. Chez lui, le doute n’était
aucunement une fin en soi, mais le moyen de parvenir à des vérités suffisamment certaines par elles-
mêmes.
2) Aux ignorants qui n’auraient pas pris la peine de lire attentivement Descartes, il semblerait qu’il ne
s’agisse que de montrer combien l’esprit humain serait sujet à l’erreur, qu’il serait porté à toujours se
tromper, ou que rien ne peut être connu avec une certitude suffisante. C’est manifestement confondre le
doute méthodique cartésien avec le doute sceptique. Et s’il paraît au premier abord si facile de se défaire
de ses préjugés, encore s’agirait-il de commencer par les reconnaître comme tels, ce qui n’est pas toujours
évident. Comme l’explique Malebranche, nous sommes spontanément portés à nous fier aux témoignages
de nos sens. La solution de facilité, celle des sceptiques, serait, pour éviter l’erreur, de tous les rejeter :
nos sens nous tromperaient toujours. Celle de Descartes est plus subtile, comme on peut le constater par
exemple dans le cinquième paragraphe de la première Méditation : nos sens, en se trouvant dans les deux
cas impliqués, ne nous rendent que probable, et non pas certaine, la distinction que nous faisons entre
l’état de veille et le rêve lié au sommeil. Il se trouve ici une cause possible d’erreur. Par conséquent cela
suffit pour douter de la certitude que nous avons spontanément d’être éveillés au moment où nous
croyons l’être.
3) Les deux dernières phrases de l’extrait généralisent la portée de la démarche cartésienne : « faire sentir
ses faiblesses » à l’homme, « lui découvrir en quoi consistent ses erreurs ». C’est ici, plus
vraisemblablement que le rationaliste cartésien, le prêtre chrétien qui parle. L’homme devrait savoir faire
preuve d’humilité pour s’abaisser constamment devant son Dieu, en reconnaissant que toutes les
certitudes qu’il croit posséder en matière de connaissances ne sont rien en comparaison de l’omniscience
divine, propre, dit-on, à convaincre de folie toute la prétendue sagesse du monde3, que toutes les erreurs
des hommes naîtraient en premier lieu de leur orgueil, le plus grand péché que les créatures humaines
puissent commettre en prétendant s’égaler à leur Créateur. On peut à bon droit ne pas partager de telles
analyses.
[Conclusion partielle]
La démarche de pensée inaugurée par Descartes est exemplaire. Encore faudrait-il se garder de mal
l’interpréter.
[3ème partie : approfondissement réflexif et critique] La valeur du doute cartésien.
1) La fortune de Descartes est considérable. Après le scepticisme des anciens Grecs, partiellement repris
dans une perspective chrétienne par Montaigne4, l’importance du doute fut soulignée par Fichte, par
Hegel, comme par Kierkegaard. Le « chemin du doute » (Zweifel) est le « chemin du désespoir »
(Verzweifel ou Verzweiflung) qu’il est cependant nécessaire de suivre pour parvenir à des vérités5. Sans
3 1 Corinthiens 1:20 : « Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? ». C’est ici Saül de Tarse, l’exalté
que les chrétiens appellent Saint Paul, qui parle.
4 « La participation que nous avons à la connaissance de la vérité, quelle qu’elle soit, ce n’est pas par nos propres
forces que nous l’avons acquises… notre foy, ce n’est pas notre acquest » (Essais, II, XII, « Apologie de Raimond
Sebond »). Malebranche, rejetant, tout comme Descartes avant lui, le scepticisme, était logiquement tout à fait
critique à l’égard de Montaigne : « Ceux qui ont lu Montaigne savent assez que cet auteur affectait de passer pour
pyrrhonien et qu’il faisait gloire de douter de tout. (…) il était nécessaire de son temps, pour passer pour habile et
pour galant homme, de douter de tout ; et la qualité d’esprit fort dont il se piquait, l’engageait encore dans ces
opinions. » (Recherche de la vérité, Livre II, IIIe partie, Chapitre V, « Du livre de Montaigne »)

s’être résolument décidé à subir cette épreuve du doute systématique au moins une fois dans sa vie, il
n’est nul espoir de dépasser l’opposition entre le scepticisme et la croyance dogmatique6.
2) Mais ne se conçoit-il pas d’autre méthode pour parvenir au vrai que le doute méthodique cartésien ?
On peut ici songer à la réduction phénoménologique de Husserl. C’est l’épochè - : le terme même
du scepticisme antique volontairement repris par Husserl, qui désigne la suspension du jugement -,
consistant à mettre entre parenthèses ou à faire abstraction de toute la réalité sensible de ce monde pour se
rendre compte alors qu’il n’est que phénoménalité visée par la conscience, dont le propre est
l’intentionnalité. En allant droit à ce qui apparaît, c’est toute la réalité des apparences qui peut être mise
entre parenthèses, pour révéler le monde comme étant essentiellement relatif à la conscience humaine.
3) Ainsi, la phénoménologie apparaît comme plus efficace et plus radicale que la philosophie cartésienne
érigeant le doute en moyen pour parvenir au vrai. On comprend qu’elle puisse aujourd’hui davantage être
cultivée par les philosophes contemporains que le doute cartésien, étroitement lié quant à lui à l’époque
qui l’a vu naître.
[Conclusion partielle]
Bien après le doute méthodique cartésien, c’est aujourd’hui la réduction phénoménologique qui est
devenue pour la philosophie contemporaine proprement incontournable.
[Conclusion]
[Résumé de la démarche précédemment suivie]
Dans une première partie, nous avons montré quelles étaient pour Malebranche ces deux manières très
différentes l’une de l’autre de douter. Dans une deuxième partie, nous avons explicité ce qui faisait
considérer par Malebranche le doute cartésien comme le moyen proprement indépassable de faire de la
philosophie. Dans une troisième partie enfin, tout en en soulignant la valeur, nous lui avons cependant
objecté l’actualité de la méthode phénoménologique inaugurée par Husserl.
[Solution du problème posé]
L’usage du doute doit être certes modéré par la raison. Mais il se conçoit une méthode plus radicale
encore de parvenir à la vérité : la réduction phénoménologique husserlienne.
[Et c’est tout ! Surtout pas de question, de prétendu « élargissement », « ouverture » sur une autre
question, d’exemple ou de nouvel argument en fin de conclusion !]
5 La Phénoménologie de l’Esprit, I, p. 69. Dans ses Libres Propos, Alain, commentant la Lettre à Buitendijck de
Descartes (1643), distinguant « le doute qui porte sur la fin et celui qui porte sur les moyens », faisait du second, en
tant que soutenu par la raison, « le signe de la certitude », témoignant de la force de l’esprit, et s’opposant au « doute
de faiblesse », lequel ne serait que le signe de l’inconstance de l’esprit.
6 Cf. G. W. F. Hegel, La Relation du scepticisme avec la philosophie.
1
/
3
100%