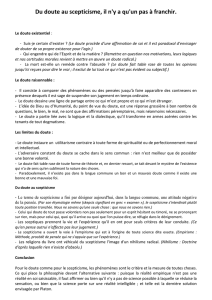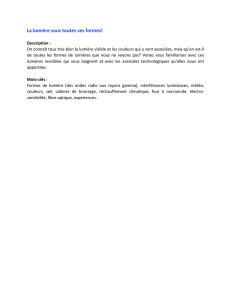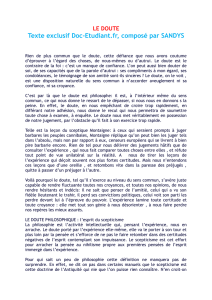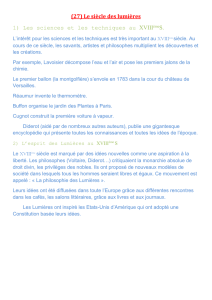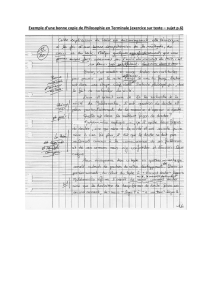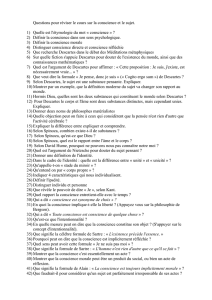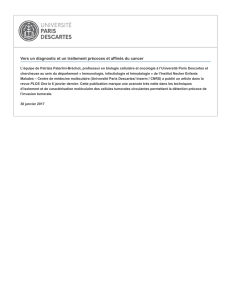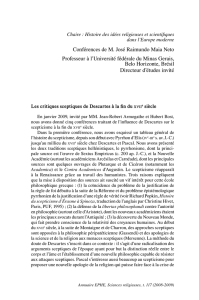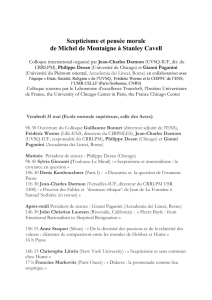Le doute Nous, français, détestons être liés à une

Le doute
Nous, français, détestons être liés à une vérité absolue. Peut-être cela nous
vient-il du temps où la France était dirigée de façon autoritaire par le roi et
l’église. A cette époque, nous avions peu de liberté dans nos croyances et notre
réflexion. « Un Roi, Une Religion, Une Loi ». C’était la soi-disant recette de Louis
XIV pour avoir une nation saine. En fait, cette étroitesse d’esprit donna naissance
au mouvement philosophique des Lumières qui grandit en réaction à cet
autoritarisme.
Le Français Descartes en fut un des principaux précurseurs. Il est perçu comme
étant l’un des plus grands penseurs de l’histoire humaine et comme le père de la
philosophie moderne. Il inventa une méthode pour démontrer ce qui est vrai.
C’était une question importante à une époque où la vérité était déterminée par
l’Eglise. Descartes nous dit alors : « Vous devez douter ». Douter de tout ce qui
est enseigné comme établi, de ...tout ce que l’on vous dit ! Ainsi la vérité, c'est ce
qui reste après avoir démontré tout ce qui est faux. Implacable logique!
Si Descartes formulait une méthode constructrice et libératrice de toutes les
erreurs et manipulations, il était conscient de son danger pour "les esprits
faibles".
Sa crainte était fondée! Sa méthode déboucha sur un scepticisme destructeur qui
s'enracina profondément dans la mentalité française.
C'est ainsi que depuis notre plus jeune âge, on enseigne à nos enfants à
questionner et à discuter. Peu importe ce qui est juste et vrai (tout est relatif, leur
dit-on), pourvu que vous défendiez bien votre point de vue. Autrement dit, les
Français sont conditionnés à être sceptiques et rationalistes.
Laïcité oblige ! Dans nos écoles et universités, Pascal est peu étudié. De même,
d’autres grands croyants et éminents philosophes comme Blondel, Bergson,
Lavelle, Gabriel Marcel, Maritain ou Levinas, sont un peu mis de côté par notre
intelligentsia émancipée, fille des « Lumières » et athée. Etonnant ! Ils sont
davantage étudiés au Canada, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud qu’en
France.
De la même manière, ce qui importe est la façon dont vous démolissez la thèse
de l’autre. Après des années de pratique, cette approche, qui nous fait douter de
tout, devient pour nous comme une seconde nature. Nous développons un
réflexe subconscient, qui, à chaque fois que quelqu’un nous donne son opinion,
nous fait penser instantanément à une raison pour laquelle l’opinion de l’autre
n’est pas juste.
Ce mode de réflexion affecte également l’Église. C’est une sorte de jeu que nous
jouons, mais il s’ensuit que nous ne recherchons jamais de conclusion définitive
ou que nous ne prenons jamais d’engagement. Bien sûr cela s’oppose

directement à un Évangile fondé sur l’indubitable Parole de Dieu, un Évangile qui
nous dit que nous sommes sauvés par la foi, un Évangile qui dit qu’ « il n’y a de
salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4:12).
Il semblerait bien que le diable ait utilisé les événements de l’histoire pour
façonner notre mentalité, au point qu’elle est devenue imperméable au message
de l’Évangile.
Mais tout n’est pas perdu ! Dieu a également été à l’œuvre à travers notre
histoire. Il s’est toujours assuré qu’une porte restait ouverte par laquelle on peut
être sauvé. Remercions Dieu pour ceux qui, comme Apollos (voir Actes 18 v 25-
28), peuvent proposer des preuves convaincantes à notre société sceptique en
discutant et démontrant l’exactitude des écritures. Satan, en mettant ses
barrières autour de l’esprit et de la raison des Français, n'a pu fermer
complètement leur cœur.
Le peuple français est un peuple passionné. Il a une perception profonde des
choses spirituelles. Blaise Pascal, un philosophe chrétien contemporain de
Descartes écrit : « Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas ». Ce
brillant intellectuel, qui ne réussit pas à venir à Dieu par le moyen de la raison, fut
touché dans son cœur lorsqu’il eut une révélation surnaturelle du Christ
ressuscité.
Un héritage mondial. À long terme, le « siècle des Lumières » a laissé un
héritage mondial. Beaucoup d’aspects de la démocratie moderne, des lois et des
droits de l’homme peuvent être reliés à ce mouvement qui a commencé en
France. Il en est de même de la pensée séculière de l’Occident. Il est difficile
d’estimer l’impact de ces philosophes français qui étaient parmi les premiers à
dépeindre un monde scientifique sans place pour Dieu. Cette vision de l’ordre
naturel, enseignée comme un fait indiscutable dans la majorité des écoles
occidentales, a empêché des millions de personnes de découvrir une relation
personnelle avec Dieu.
Dans une grande partie du monde occidental, le scepticisme religieux du « siècle
des Lumières » a été affaibli par les réveils religieux de la fin du XVIIIème siècle.
Le Méthodisme en Angleterre et le Piétisme en Allemagne, ont été accompagnés
du grand réveil de l’Amérique. Ces réveils protestants ont contrebalancé les
doutes intellectuels des Lumières et ont amené beaucoup de personnes à
retrouver une foi personnelle.
Mais en France, les réveils n’ont jamais percé. La communauté réformée avait
été amenée près de l’extinction dans les années précédentes. La philosophie du
doute a continué à s’enraciner plus profondément. Paradoxalement, ce
scepticisme a été accompagné d’une croissance du spiritisme (inventé par le

Français Allan Kardec) et d’autres pratiques occultes, alors que les Français
cherchaient des moyens peu orthodoxes pour satisfaire leur faim spirituelle.
Aujourd’hui le scepticisme est gravé dans la conscience française aussi
profondément que la laïcité est ancrée dans leur société. L’importance de la
raison, la nécessité de douter et d’avoir un esprit critique ont gravement influencé
notre culture et nos mentalités. Ces mauvais penchants font partie de notre
identité française et nous n’en sommes souvent pas conscients. Ils font obstacle
à une œuvre puissante du Saint-Esprit dans nos vies et dans notre pays.
La sinistrose. Combien de fois nos gouvernants n’ont-ils pas souligné le risque
de "sinistrose" ? Nous nous enflammons vite, mais nous baissons également les
bras rapidement devant la moindre résistance, allant même jusqu’à dénigrer ce
que nous avons adoré. Chacun peut plus ou moins se reconnaître…
L’église n’est donc pas exempte du scepticisme ambiant, hérité d’un certain
rationalisme, et qui peut se cacher chez les chrétiens sous le masque d’une
sagesse désabusée ou encore d’une vison pessimiste de l’avenir. Nos faux
raisonnements nous empêchent d’obéir. Tels des forteresses, ils s’élèvent contre
la connaissance de Dieu. Ils doivent être renversés afin que nos pensées
puissent nous amener à l’obéissance (2 Corinthiens 10:4-5 ; Jacques 1:22). Voilà
le cœur d’une des principales forteresses qui “plombent” nos églises et freinent
l’œuvre de Dieu. Tout le message et le ministère de Jésus sont centrés sur la
nécessité de la repentance qui est, en fait, un changement de mentalité. De notre
réponse authentique et entière à ce défi dépend l’avenir spirituel de notre pays.
Cela commence par l’Eglise, donc par nous.
1
/
3
100%