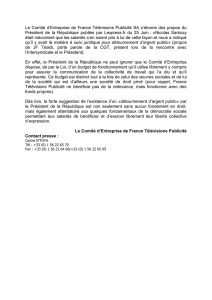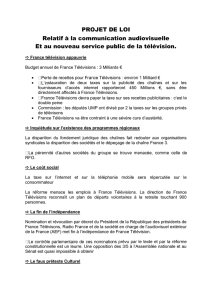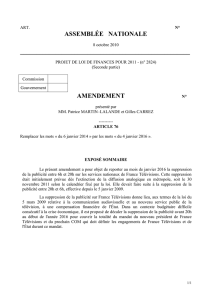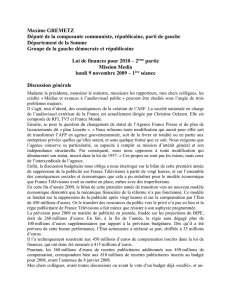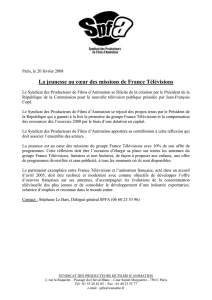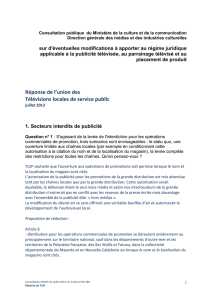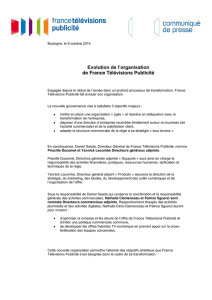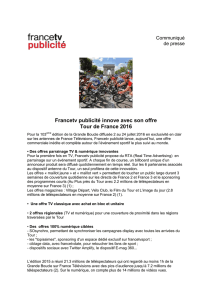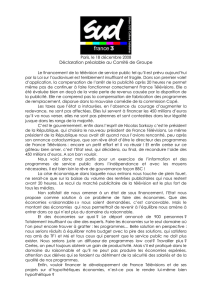Commission pour la nouvelle télévision publique

Commission
pour la nouvelle télévision
publique
Rapport
Présenté au Président de la République par Jean-François Copé le 25 juin 2008

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................................. 3
SYNTHÈSE ..................................................................................................................... 6
1. - LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ....................................................................... 9
1.1. La révolution numérique, qui transforme le paysage audiovisuel français ................................... 9
1.2. La transformation de l’économie du secteur, qui voit entrer de nouveaux acteurs .................... 11
1.3. France Télévisions doit répondre à ces deux défis pour entrer de plain pied dans le 21
ème
siècle11
2. - LE MODÈLE CULTUREL ET DE CRÉATION ........................................................ 14
2.1. Un modèle fondé sur une triple exigence ...................................................................................... 14
2.2. Les unités de programme média global ........................................................................................ 16
2.3. La priorité à la création ................................................................................................................ 19
2.4. La nécessaire réforme du cadre réglementaire ............................................................................ 21
2.5. Conquérir de nouveaux publics .................................................................................................... 22
2.6. Garantir le pluralisme et la diversité de l’information sur tous les supports .............................. 23
2.7. L’identité des chaînes .................................................................................................................... 24
3. - LE MODÈLE DE GOUVERNANCE ET DE GESTION INTERNE ........................... 28
3.1. Une organisation à adapter au défi du média global .................................................................... 28
3.2. Organiser une boucle de gouvernance, cohérente et lisible ......................................................... 31
4. - LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER ........................................................ 37
4.1. Les premières propositions de la commission .............................................................................. 37
4.2. Le contexte économique général du secteur audiovisuel .............................................................. 38
4.3. Les principes structurants du financement de France Télévisions .............................................. 40
4.4. Les besoins de financement ........................................................................................................... 41
4.5. Les principales ressources possibles ............................................................................................. 43
4.6. Synthèse des préconisations .......................................................................................................... 46
ANNEXES.49

3
Introduction
En annonçant le 8 janvier 2008 la suppression de la publicité sur les écrans des chaînes
du service public de la télévision, le Président de la République a souhaité entamer un
vaste chantier visant à répondre à une question cruciale : que doit être la télévision
publique au XXIème siècle? Média de divertissement, d'information, de connaissance
et de création, la télévision joue un rôle fédérateur unique. Ce rôle indispensable de
créateur de lien social nécessite incontestablement la présence d’un service public
audiovisuel puissant, garant de la diversité et de l’expression démocratique, référence
pour les autres télévisions, moteur pour les industries culturelles.
Cette annonce met en lumière l’obsolescence du cadre législatif et réglementaire de
la télévision publique. Le paysage audiovisuel de 1986, date de la loi qui s’applique,
n’a rien à voir avec celui de 2008. Certes, de nombreuses modifications ont été
apportées depuis à ce texte, et tout particulièrement la loi du 1
er
août 2000 qui érige
France Télévisions en société holding chargée de superviser les chaînes de
l’audiovisuel public, mais cette somme d’ajouts successifs ne construit pas un
ensemble cohérent.
La révolution technologique qui a permis la multiplication des diffuseurs et l’accès
soudain, pour une majorité de foyers français, à une offre hertzienne élargie de 6 à 20
chaînes, l’accroissement presque à l’infini des voies de diffusion, la versatilité du média
télévisuel, l’apparition d’offres concurrentes proposées sur le réseau Internet,
contribuent à la transformation du paysage audiovisuel. Surtout, la convergence conduit
à ce que de nouveaux acteurs – précédemment confinés au rôle de fournisseurs de
‘contenant’ – entrent de manière massive dans le domaine des ‘contenus’. Les
opérateurs de télécommunication, dont la taille est sans commune mesure avec celles
des diffuseurs historiques, a fortiori des producteurs, sont en passe de jouer un rôle
nouveau, bénéficiant naturellement des images des télévisions. La publicité qui finançait
l’essentiel des diffuseurs privés et le tiers de France Télévisions se trouve émiettée du
fait de la fragmentation de l’audience, sans s’accroître. Ce panorama, confirmé par les
chiffres les plus récents, conduit au constat de l’obsolescence du modèle
économique actuel du secteur audiovisuel. Le moment apparaît, à cet égard,
particulièrement propice pour France Télévisions de ne plus dépendre de la ressource
publicitaire.
Ses évolutions et ses transformations successives font de France Télévisions un
ensemble disparate de dizaines d’entreprises distinctes, au pilotage complexe. A l’image
d’un château de cartes, il a toujours semblé dangereux d’en améliorer un pan au risque
de voir l’édifice s’effondrer. Or, dans un contexte en pleine mutation, où les défis doivent
devenir autant de chances de développement et de rayonnement, où l’ambition doit être
le maître mot pour aider les citoyens à mieux comprendre le monde qui les entoure, rien
n’est plus dangereux que l’immobilisme que favorise cette obsolescence du modèle
organisationnel.
Il ressort de cette triple obsolescence des enjeux tels qu’il ne s’agit plus d’adapter
à la marge, mais de réfléchir de manière systémique à ce que doit être ce service

4
public au sein d’un paysage audiovisuel bouleversé.
Dans ce cadre, par une lettre de mission du 27 février 2008, le Président de la
République a mis en place la commission pour la nouvelle télévision publique et
en a confié la présidence à Jean-François Copé. Les objectifs assignés s’inscrivent
dans ce cadre global et se structurent en quatre volets cohérents. Une réflexion sur la
télévision publique doit, en effet, se comprendre de manière globale pour envisager le
système dans son ensemble. Il s’agit du :
• modèle de développement qui traite de la diversification et de la prise en
compte des nouvelles technologies de communication qui transforment
radicalement la manière de regarder la télévision ;
• modèle culturel et de création, traitant des contenus, c’est-à-dire de la
diversité et de la créativité des antennes du service public audiovisuel et
de leur rôle dans la création artistique, audiovisuelle et
cinématographique ;
• modèle de gouvernance, qui doit approfondir l’identité, les valeurs, et
dessiner le nouveau visage à donner à France Télévisions, ainsi que la
mesure de sa performance ;
• modèle économique, qui analyse de manière approfondie les moyens
financiers nécessaires et élabore des mécanismes de financements
pérennes.
Afin d’assurer la plus large représentativité à cette commission, elle associait à parité
des parlementaires de toutes tendances politiques, des professionnels du secteur
de l’audiovisuel et des personnalités dont l’expérience a permis d’utilement enrichir
les réflexions. Les parlementaires socialistes et communistes ont souhaité mettre un
terme à leur participation aux travaux de la commission le 4 juin 2008. La commission a
naturellement entendu privilégier le consensus pour aboutir aux propositions qu’elle
formule. Néanmoins, la plus grande liberté a été donnée à ses membres pour que les
positions individuelles puissent également être exprimées. Elles prennent ainsi la forme
de contributions portées en annexe au présent texte permettant de donner un écho à
l’ensemble des opinions, sans exclusive, même si elles n’ont pas recueilli l’assentiment
de la majorité de la commission.
C’est donc à l’aune de cette volonté globale et ambitieuse que les travaux de la
commission ont abouti à la rédaction de ce rapport qui fait une synthèse des
conclusions de quatre mois de réflexions, enrichies par de très nombreuses
auditions et l’analyse de contributions écrites de spécialistes, ainsi que par la
consultation des citoyens permise par un site Internet qui a constitué un outil précieux
pour faire émerger les points de vue les plus divers.

5
Il se structure autour d’une synthèse générale qui reprend les principales conclusions du
rapport et de développements, articulés autour des quatre thèmes principaux, organisés
de manière logique : le modèle de développement ; le modèle culturel et de création ; le
modèle de gouvernance ; le modèle économique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
1
/
77
100%