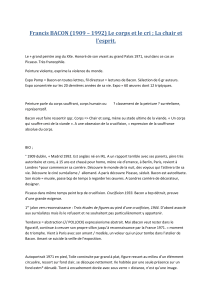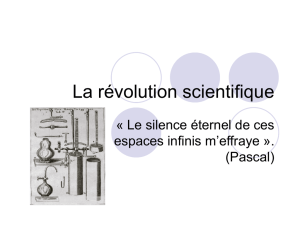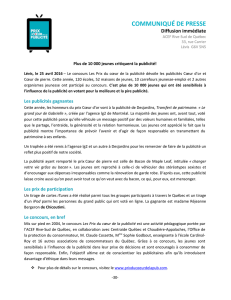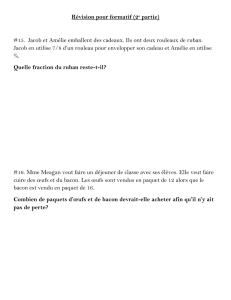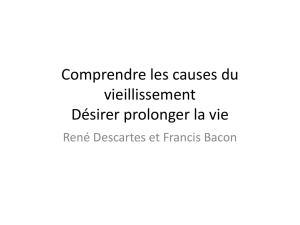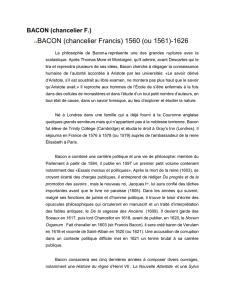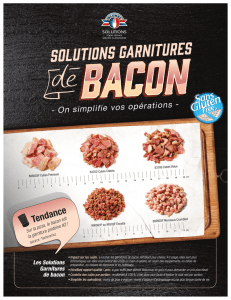1 Francis Bacon : formation et renouveau de la pensée scientifique

Christophe*Regina*
*
1*
Francis Bacon : formation et renouveau de la pensée scientifique
1) Analyse critique (notée sur 10 points)
Faites le commentaire composé des 6 documents proposés, en soulignant leur intérêt et leurs
limites éventuelles pour la compréhension du thème.
2) Exploitation adaptée à un niveau donné (notée sur 10 points)
Rédigez un écrit de synthèse, résultant de l’analyse critique des documents et visant à la
transmission d’un savoir raisonné, en mettant en évidence les notions, les connaissances et les
documents ou extraits de documents que vous jugerez utiles à un enseignement d’histoire au
niveau que vous aurez choisi.
Document 1 :
L’alchimie est omniprésente dans l’œuvre de Francis Bacon, et cela pour au moins deux raisons,
qui correspondent aux deux aspects de son œuvre philosophique. D’une part, Bacon entend
construire une nouvelle philosophie naturelle, pour laquelle il amasse des matériaux. Ce projet
s’accomplit partiellement dans une série de petits traités comme le Phaenomena universi, le De
fluxu et refluxu maris ou le De viis mortis, ou encore dans la Sylva sylvarum or a Natural
History in Ten Centuries. Bacon y utilise les travaux des alchimistes comme données,
éventuellement corrigées, pour alimenter ses réflexions sur les éléments, les esprits, la
constitution des métaux, les sels et, d’une façon plus générale, sur tous les processus de
transformation et d’amélioration des corps naturels, qu’ils soient d’origine minérale, végétale
ou animale.
D’autre part, Bacon veut imposer aux sciences une nouvelle méthode de recherche qui échappe
aussi bien au dogmatisme de la pensée scolastique qu’aux errements d’un empirisme incapable
de tirer profit des faits observés. Il s’agit alors, pour Bacon, de savoir si les travaux des
alchimistes ne constituent que l’illustration de cette recherche aveugle d’artisans sans méthode
qui se prennent pour des philosophes, ou si, au contraire, ils constituent la première esquisse
d’une démarche scientifique qu’il convient de perfectionner. C’est surtout dans le Novum
Organum que Bacon tire parti des travaux des alchimistes, puisque, dans le livre II, il s’appuie
sur la transmutation en or et les usages du feu pour donner des exemples de la manière dont
doivent être conduites les recherches dans « une histoire naturelle et expérimentale qui soit
suffisante et de qualité » (…).
Bernard JOLY, « Francis Bacon réformateur de l’alchimie : tradition alchimique et invention scientifique
au début du XVIIe siècle », Revue philosophique de la France et de l'étranger, Presses Universitaires de
France, 2003/1 Tome 128, p. 23-40
Document 2 :
La vie de Francis Bacon
- 1561 : naissance à Londres.
- à 13 ans, il entre à l’Université de Cambridge.
- à 16 ans, il rédige un ouvrage de réfutation d’Aristote.
- 1576-1579 : il voyage en France pour « s’instruire des moeurs de ses provinces ».

Christophe*Regina*
*
2*
- à 19 ans, il rédige un traité sur l’État de l’Europe. Après la mort de son père, Bacon entreprend
des études de droit et devient avocat.
- 1593 : il entre à la Chambre des Communes et devient le protégé du comte d’Essex, favori
d’Élisabeth, puis se retourne contre lui et obtient sa condamnation. Devenu favori du roi
Jacques Ier et du duc de Buckingham, il cumule alors titres et honneurs et sa fortune s’accroît
considérablement.
- 1618 : il est nommé grand chancelier.
- 1621 : il est condamné pour corruption, perd sa charge et est rejeté de la vie publique. Il sera
publiquement réhabilité, mais il meurt peu après, en 1626.
Œuvres principales
- The Advancement of Learning, traité « de la valeur et de l’avancement des sciences » (1605)
- Instauratio magna (1620), dont la première partie est une présentation détaillée des divisions
des sciences et la seconde partie, intitulée Novum Organum (ou « nouvelle logique » par
opposition à celle d’Aristote), une méthode pour guider l’esprit et avancer dans les sciences.
Cet ouvrage sera interprété comme une déclaration de guerre à l’aristotélisme.
- La Nouvelle Atlantide (publiée après sa mort en 1627).
Document 3 :
L’intelligence humaine, quand elle a admis certaines doctrines, soit parce qu’elle les tient de la
tradition et de la croyance publique, soit parce qu’elles lui plaisent, veut que tout leur soit
subordonné et s’accorde avec elles. La force des objections et le grand nombre des difficultés
devraient l’emporter ; mais elle ne les regarde pas, ou elle les dédaigne, ou bien elle les écarte
et les rejette par une distinction, au grand détriment de la vérité ; mais il faut bien que l’autorité
de ces préjugés demeure inviolable. On montrait un jour à une personne des tableaux suspendus
dans un temple et offerts par des hommes qui avaient échappé au naufrage, puis on lui
demandait avec instance si elle ne reconnaissait pas la providence des dieux : « Mais, dit-elle
avec raison, où sont donc les portraits de ceux qui ont fait des vœux et qui ont péri ? » (…)
L’esprit de l’homme est principalement touché par les choses qui se présentent et le frappent
toutes ensemble et subitement : l’imagination d’ordinaire en est remplie et comme enflée ; quant
au reste, par une opération secrète, il le suppose et l’imagine semblable à ce petit nombre
d’objets qui l’assiègent ; mais quand il faut passer à ces expériences lointaines et d’une autre
nature par lesquelles les axiomes s’éprouvent comme au feu, l’esprit est lent et inhabile, s’il
n’est forcé par de dures lois et par un pouvoir violent.
L’esprit humain marche toujours : il ne peut ni s’arrêter, ni se reposer ; il va sans cesse en avant,
mais en vain. On ne peut concevoir de limites à l’univers ; il y a toujours quelque chose au delà.
Mais cette impuissance de la pensée entraîne de plus grands dommages dans la recherche des
causes : en effet, il y a certainement des universaux très réels dans la nature, et ils n’ont
véritablement aucune cause ; mais l’esprit de l’homme, qui ne connaît point le repos, cherche
des raisons encore plus claires ; toutefois, tandis qu’il court après les raisons éloignées, il
retombe sur les causes les plus prochaines, qui sont les causes finales : or, ces causes existent
en nous bien plutôt que dans l’univers ; et voilà la source où vient se corrompre la philosophie.
Mais c’est le fait d'un ignorant et d’un mauvais philosophe de chercher une cause aux vérités
les plus générales et de n’en pas chercher aux vérités secondaires et subordonnées. (…)
Mais les plus grands embarras et les plus grandes erreurs de l’esprit humain ont pour cause la
stupeur, l’incompétence et les égarements des sens ; ce qui les frappe de près l’emporte sur ce
qui ne les atteint que de loin, et qui souvent devrait être préféré. La réflexion finit où s'arrête la

Christophe*Regina*
*
3*
vue ; quant aux choses invisibles, on ne les observe pas. Ainsi échappe à l’homme toute
opération des esprits renfermés dans les corps palpables. Nous ignorons de même ces
transformations subtiles qui ont lieu dans les parties d’objets plus grossiers, changements que
l’on appelle d’ordinaire des altérations, et qui sont en réalité des mouvements locaux dans les
infiniment petits et cependant, si ces deux sortes de mystères ne sont étudiés et mis en lumière,
on ne peut exécuter rien de grand dans la nature. (…)
L'expérience seule fonde la connaissance, à condition qu'elle soit menée de façon raisonnable,
en évitant de se jeter au hasard dans des routes incertaines et de procéder à des tentatives vaines
et superficielles. L'expérimentation doit être menée avec méthode, en s'enquérant d'abord de
tout ce qui a été écrit sur la matière, et en s'éclairant de toutes les observations antérieures. Tous
les faits particuliers doivent être passés au crible, comparés les uns aux autres. La route n'est ni
rectiligne ni plane ; elle monte aux axiomes et redescend à la pratique, l'un corrigeant l'autre.
Quand ces préceptes seront passés dans l'usage, alors la lumière de la connaissance brillera pour
les hommes.
F. BACON, Novum Organum (1620), trad. français d'B. Burnouf, Extraits du Novum Organum de Bacon,
Paris. 1850, p. 7-10.
Document 4 : La réforme du savoir selon Francis Bacon, Two books of the proficience and
advancement of learning human and divine, Londres, T. Homes, 16051.
Les parties du savoir humain correspondent respectivement aux trois parties de
l’entendement de l’homme, qui est le siège du savoir : l’histoire correspond à sa mémoire, la
poésie à son imagination, et la philosophie à sa raison. Le savoir sacré admet la même
distribution si bien qu’entrent aussi dans la théologie l’histoire de l’Église et les paraboles qui
constituent la poésie sacrée, et aussi la sainte doctrine c’est à dire l’enseignement moral.
L’histoire de la nature est de trois sortes : il y a l’histoire de la nature dans son cours
ordinaire, l’histoire de la nature errante ou divergente, et celle de la nature transformée ou
forgée – c’est à dire respectivement l’histoire des créatures, l’histoire des merveilles et l’histoire
des arts. La seconde est utile pour deux raisons : la première est qu’elle permet de corriger le
caractère partiel et partial des axiomes et des opinions, qui sont d’ordinaire constitués à partir
seulement des exemples courants et familiers ; la seconde est que, des merveilles de la nature,
part le chemin le plus court et la compréhension la plus brève menant aux merveilles de l’art.
Car c’est tout simplement en suivant, ou pour ainsi dire en pourchassant la nature dans ses
égarements, que l’on se rend capable de la conduire par la suite au même endroit. (…)
Il serait bon de diviser la philosophie naturelle en deux, la mine et le fourneau, et de
faire pour les philosophes de la nature deux professions ou deux emplois : certains seraient
mineurs, et d’autres forgerons.
Il doit y avoir deux parties dans la philosophie naturelle, la recherche des causes et la
production des effets ; ou encore la philosophie spéculative et la philosophie opératoire, ou
enfin la science naturelle et la prudence naturelle.
********************************************************
1 Sous la forme de deux longues lettres adressées au roi d’Angleterre Jacques Ier, Francis Bacon (1561-1626)
propose une double réforme du savoir et des conduites de savoir : il faut à la fois que les sciences s’ouvrent à l’idée
de « progrès » et que se constitue une communauté scientifique internationale, seule capable, par la pérennité de
son institution, d’installer la connaissance humaine dans le processus continu d’un développement historique.
L’ouvrage reçut, lors de sa parution, un accueil que l’auteur jugea décevant. Ainsi, pour se faire plus largement
entendre des lettrés de son temps, Bacon envisagea-t-il, dès 1608, de faire traduire son livre en latin. Le projet
aboutit en fait à une traduction doublée d’une révision, en l’espèce des neuf livres qui composent le De dignitate
et augmentis scientiarum de 1623.

Christophe*Regina*
*
4*
De même que nous avons divisé la philosophie naturelle en recherche des causes et
production des effets, de même nous subdiviserons cette partie qui traite de la recherche des
causes suivant la division traditionnelle et bien fondée des causes : d’une part, la physique, qui
recherche et travaille ce qui a trait aux causes matérielles et efficientes ; d’autre part, la
métaphysique, qui traite des causes formelles et finales.
La physique se situe à une distance égale de l’histoire naturelle et de la métaphysique.
Car l’histoire naturelle a pour tâche de décrire les choses dans leur variété ; la physique celle
de décrire les causes, en tant qu’elles changent et sont particulières ; et la métaphysique celle
de décrire les causes immuables et permanentes. Il n’est pas possible ni pertinent de chercher
l’ensemble des formes de ces sons qui font les mots, lesquels, par composition et transposition
des lettres, sont en nombre infini. Mais d’un autre côté on comprend aisément qu’on recherche
la forme de ces sons ou de ces voix qui font les lettres simples, ce qui, une fois acquis, permet
d’induire et de rendre manifeste les formes de tous les mots, lesquels sont constitués et
composés de sons.
De même, s’occuper de rechercher la forme d’un lion, d’un chêne, de l’or est une vaine
entreprise, alors que rechercher les formes de la sensibilité, du mouvement volontaire, du
mouvement végétatif, des couleurs, de la gravité et de la légèreté, de la densité et de toutes les
autres qualités et natures qui, comme les lettres de l’alphabet, sont en nombre limité et
desquelles sont faites les essences (dont la matière est le substrat) de toutes créatures ;
rechercher les vraies formes de ces éléments est l’objet de cette partie de la métaphysique que
nous définissons à présent.
L’utilité de cette partie de la métaphysique est excellente à deux égards. Premièrement,
c’est le devoir de toute connaissance, et sa vertu fondamentale, que de condenser l’étendue
infinie de l’expérience des choses individuelles aussi loin que le permettra l’appréhension du
vrai et d’apporter ainsi un remède à la doléance exprimée par la formule : « la vie est courte et
l’art est long ». Ce devoir est accompli en unifiant les notions et les concepts des sciences. Car
les savoirs sont comme des pyramides, dont l’histoire constitue la base. Ainsi l’histoire naturelle
est la base de la philosophie naturelle. Le plan juste au-dessus de cette base est la physique, et
le plan juste au-dessous du sommet est la Métaphysique. Quant au point du sommet, et la loi
condensée de la nature, nous ne savons pas si la recherche humaine peut y atteindre.
Qui en vient à connaître une forme connaît la plus grande possibilité de sur-imprimer
cette nature sur n’importe quelle variété de matière, et se trouve ainsi moins entravé dans son
opération, tant en ce qui concerne la matière, qui est la base, qu’en ce qui concerne l’efficient,
qui est la condition.
Francis BACON, Du progrès et de la promotion des savoirs divin et humain, Paris, Gallimard, Tel, 1991
(1605), p.86-117.
Document 5 : Giambattista Vico, La science nouvelle, 1744.
Nous voyons dans le Timée de Platon que, grâce à la méthode de la synthèse, l'école italique
de Pythagore avait, porté fort loin la science des mathématiques. Un temps de Socrate et de
Platon, Athènes resplendissait de tous les arts qui ornent l’esprit humain : elle excellait dans la
poésie, dans l’éloquence, dans l’histoire, dans la musique, dans la métallurgie, la peinture, la
sculpture et l’architecture. Ce fut ensuit le tour d’Aristote à inventer le syllogisme, méthode qui
explique l'universel par le particulier, plutôt qu'elle ne rassemble les particularités pour en
former des généralités ; ce fut le tour de Zénon, auteur du sorite, de cette méthode qui
correspond à celle de nos philosophes modernes, et qui tend à augmenter la subtilité de l'esprit

Christophe*Regina*
*
5*
humain, sans ajouter à sa pénétration. Ces deux philosophes n'ont apporté aucun bienfait réel
au genre humain, et c'est avec raison que dans son Novum Organum,
Le grand philosophe politique Bacon de Verulam rendit hommage à la méthode de l’induction.
Les Anglais l'ont ensuite appliquée à la philosophie expérimentale.
Giambattista Vico, La science nouvelle, Jules Renouard, Paris, 1844, p. 165.
Document 6 : Induction et médecine
Portrait de Thomas Sydenham (1624-1689)
par Mary Beale (s.d.)
National Portrait Gallery (Royaume-Uni)
(…) Le médecin qui étudie avec le plus de soin et d'application les phénomènes des
maladies devait être nécessairement le plus capable de connaître les véritables indications
curatives. Voilà la méthode à laquelle je me livrai entièrement, bien persuadé que, si je suivais
la nature, quand même je marcherais dans des routes inconnues jusqu'alors et abandonnées, je
ne m'écarterais jamais en rien du droit chemin. Me gouvernant donc par cette règle, je
m'appliquai à observer exactement les fièvres ; et, après m'être donné, pendant quelques années,
bien des peines, des fatigues et des inquiétudes, je découvris enfin une méthode pour les guérir
(…)
Depuis lors, ayant observé de nouvelles espèces de fièvres qui m'étaient inconnues
auparavant, et qui se succédaient continuellement les unes aux autres, je résolus de joindre
ensemble, avec le plus de soin qu'il me serait possible, tout ce qui regardait cette matière, ou
qui en dépendait, afin de suppléer à l'exiguïté de mon premier ouvrage par une histoire plus
exacte et plus complète de ces maladies. Lorsque je méditais ce dessein, et que j'étais
entièrement occupé à chercher une méthode propre à guérir toutes sortes de fièvres, eu égard
aux divers changements que la nature y opère, et aux divers remèdes qu'il faut employer, je
reconnus bientôt qu'au lieu de la reconnaissance que j'avais sujet d'attendre, je n'essuierais que
des reproches, et que les uns m'accuseraient de ne suivre d'autre règle que mes propres idées,
et les autres de n'en suivre absolument aucune. (…)
Nonobstant les travaux des autres, j'ai toujours cru que j'aurais à me reprocher d'avoir
vécu inutilement, si ayant pratiqué, comme j'ai fait, la médecine, je ne contribuais pas, du moins
de quelque petite chose, à l'avancement de cet art. C'est pourquoi, après de longues et sérieuses
 6
6
 7
7
1
/
7
100%