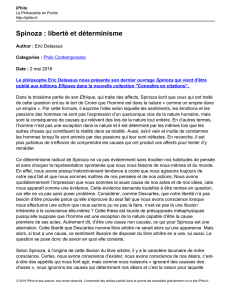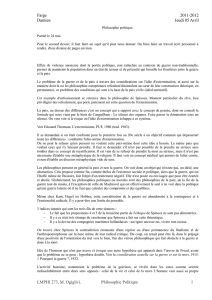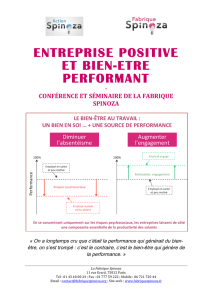Ne pas rire, mais comprendre

1
« Ne pas rire, mais comprendre »
(La réception historique et le sens général du spinozisme)
La plupart des lecteurs de Spinoza s’accordent sur le caractère
exceptionnel, jusqu’à l’étrange, de sa philosophie -Gueroult, pour qui « dans le ciel
de la philosophie, Spinoza n’a cessé de briller d’un éclat singulier »
1
, ayant même
pu, sur ce point, trouver l’approbation d’Alquié, aux yeux de qui Spinoza,
fondamentalement, « se sépare de tous les philosophes occidentaux de l’époque
moderne »
2
. Pourtant, à première vue, Spinoza, en cherchant à rendre raison « de
soi, des choses et de Dieu »
3
, ne fait guère autre chose que ce que font la plupart des
1
Martial Gueroult, Spinoza, Dieu -Éthique 1. Paris : Aubier-Montaigne, 1968, p. 9. La
phrase citée est la toute première de ce grandiose commentaire, œuvre ultime et inachevée de
Martial Gueroult.
2
Ferdinand Alquié, Le Rationalisme de Spinoza. Paris : PUF, 1981, p. 11 : « Je ne nie certes
pas que la liaison contraignante des concepts [de Spinoza] ne puisse modifier ma vision du monde.
Mais Spinoza ne borne pas là son ambition. Il affirme que l’on peut, en suivant sa doctrine,
parvenir à la vie éternelle et à la béatitude. C’est en ce sens qu’il se sépare de tous les philosophes
occidentaux de l’époque moderne [nous soulignons]. On n’a pas assez insisté sur cette différence,
par assez averti, au début de toute étude consacrée à Spinoza, que nous quittons avec lui le terrain
sur lequel Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant se sont placés ». Selon Alquié, comme on le sait
(et c’est la thèse générale de son livre), « c’est de cette différence » que « provien<drai>t »
« l’incompréhensibilité de l’Éthique » (ibid).
3
Voir E V 42 sc : « l’ignorant, en effet, outre que les causes extérieures l’agitent de bien des
manières, et que jamais il ne possède la vraie satisfaction de l’âme, vit en outre presque
inconscient et de soi, et de Dieu, et des choses <sui et Dei et rerum quasi inscius>, et, dès qu’il
cesse de pâtir, il cesse aussi d’être. Alors que le sage, au contraire, considéré en tant que tel, a
l’âme difficile à émouvoir ; mais conscient et de soi, et de Dieu, et des choses <sui et Dei et rerum
[...] conscius> avec une certaine nécessité éternelle, jamais il ne cesse d’être », etc. Traduction

R
ÉCEPTION ET
S
ENS
G
ÉNÉRAL DU
S
PINOZISME
2
philosophes de la tradition : son geste reste comparable à ceux de Descartes, de
Malebranche, ou de Leibniz, pour citer les auteurs de l’âge classique dans lequel il
s’inscrit, et dont, à des titres divers, il fut proche en son temps. Plus généralement,
au titre de « rationalisme absolu »
4
, le spinozisme semble prendre normalement
place parmi les grands rationalismes qui jalonnent l’histoire de la philosophie,
comme par exemple celui de Hegel. Et quoi de plus normal, de plus banal, pour une
philosophie ou pour un philosophe, que de cultiver la rationalité autant qu’il est
possible, ou, pour parler comme Spinoza, « autant qu’il est en lui » (quantum in se
est) ? Mais c’est un fait, le destin de sa pensée a été très différent de celui des
auteurs que nous venons de citer, et, pourrait-on dire, presque unique dans l’histoire
de la philosophie : comme s’il y avait, dans ce rationalisme, quelque chose
d’insaisissable, une obscurité par excès de clarté, ou un aspect aveuglant, qui
faisaient que, de génération en génération, s’est perpétuée avec une étonnante
constance le conflit des interprétations sur la philosophie de Spinoza. Non pas
simplement le conflit naturel des interprétations par lequel une philosophie demeure
vivante à travers les intérêts variés dont elle est l’objet ; mais un conflit
fondamental, ou plutôt une série de conflits fondamentaux, qui ont pris le plus
souvent l’allure de véritables confrontations, ou de combats, dans l’histoire des
idées des trois derniers siècles, non pas sur tel ou tel aspect de la doctrine, mais sur
son sens le plus profond, le plus global, le plus général, sur sa nature ou son essence
même : bref, aussi extraordinaire que cela puisse sembler, il semble qu’un accord
même minimal ait été impossible à trouver sur la nature même du projet
philosophique de Spinoza, sur son sens, sa signification, ses intentions. De là sans
doute la célèbre phrase de Bergson : « tout philosophe a deux philosophies : la
sienne et celle de Spinoza », à condition, ajouterions-nous, d’avoir d’abord fait de
celle de Spinoza la sienne propre -ce qui fait qu’on a presque autant de Spinoza que
de philosophes. De là sans doute aussi la thèse si intéressante du livre d’Alquié,
selon lequel la philosophie de Spinoza serait, pour des raisons qu’il explique tout au
long de son ouvrage, fondamentalement « incompréhensible », et sans doute, à ses
yeux, plus « incompréhensible » qu’aucune autre.
Il ne serait donc pas légitime, nous semble-t-il, et tout particulièrement à
propos de Spinoza, de prétendre présenter une sorte de vérité officielle ou scolaire
Pautrat (Paris : Seuil, 1988). Cette tripartition correspond à ce qu’on appelait « métaphysique
spéciale », et qui se retrouvera jusqu’à la Critique de la Raison Pure, dans la triple exposition
critique de la psychologie, de la cosmologie, et de la théologie rationnelles de la Dialectique
Transcendantale. Voir à ce sujet, par exemple, les explications de Vleeschauwer (Hermann J.
van), in La déduction transcendantale dans l'oeuvre de Kant, 3 tomes. Paris et al : Nijhoff, 1934-
36-37 (repr. NY, Londres : Garland, 1976), notamment t. I p. 65 : « La métaphysique traditionnelle
renfermait deux parties distinctes et passablement hétérogènes, l'ontologie ou la métaphysique
générale, et la métaphysique spéciale. Dans l'ontologie, on étudiait l'être, les grands principes et les
plus haute subdivisions de l'être, appelées catégories par Aristote [...]. L'ontologie classique se
trouve répartie sur les premières sections, intitulées Esthétique Transcendantale (qui se charge des
concepts de l'espace et du temps), et Analytique Transcendantale (qui étudie les autres catégories
aristotéliciennes). Par contre, dans la Dialectique Transcendantale, Kant fait le procès des trois
sciences rationnelles dont se composait la métaphysique spéciale ».
4
L’expression est de Gueroult, et caractérise selon lui plus que tout autre le système de
Spinoza.

R
ÉCEPTION ET
S
ENS
G
ÉNÉRAL DU
S
PINOZISME
3
de la doctrine : tout au contraire, l’état le plus actuel des analyses, des réflexions et
des interprétations, se sait l’héritier (souvent critique, bien sûr) de lectures
radicalement différentes, et qu’il n’est pas possible de révoquer d’un revers de main,
au nom d’une prétendue « scientificité » ou « objectivité » nouvelles ou supérieures,
même si les éditions, index, traductions, et commentaires récents nous donnent
aujourd’hui un Spinoza plus fiable, sans doute, que celui dont disposaient ses
lecteurs anciens -et même si, comme toujours en ces matières, le fait de pouvoir
profiter des analyses qui nous précèdent nous donne une forme de supériorité sur
elles. Nous voudrions donc présenter ici à grands traits certaines de ces
interprétations si radicalement divergentes, d’apparence parfois si aberrantes, de la
philosophie de Spinoza : non pas simplement à titre de curiosité (encore que cela
serait une raison valable, tant l’histoire de la réception du spinozisme est
passionnante et haute en couleurs) ; encore moins pour les ridiculiser au nom d’une
interprétation « vraie » que nous réserverions pour la fin, afin de mieux la mettre en
valeur ; mais tout au contraire, dans le but de mettre en évidence la relative
légitimité de ces lectures (relative, car elle n’est jamais totale), et, de ce fait, pour
souligner les aspects véritablement mystérieux, étranges (peut-être d’ailleurs
« fascinants » en cela même, pour reprendre les termes d’Alquié
5
) du spinozisme ;
ou à tout le moins, quittant le registre du roman noir, pour donner à comprendre
l’extraordinaire plasticité, l’extraordinaire souplesse, l’extraordinaire adaptabilité
dont a toujours fait preuve, paradoxalement, une philosophie qu’on imaginerait
plutôt (pour parler comme Nietszche) aussi raide, distante, obstinée, corsetée
comme elle l’est dans ses démonstrations invulnérables, qu’une jeune vierge en
armure
6
. L’histoire de la réception du spinozisme
7
est sans doute l’histoire de la
constitution d’un certain nombre de légendes. Mais le but de l’exposé qui suit est
précisément, non pas tant de déplorer de telles légendes, ou de s’en moquer (même
s’il ne se propose aucunement de les réactiver telles quelles), que de les
comprendre
8
, en cherchant à dégager la part de vérité qu’elles contiennent, c'est-à-
dire ce en quoi elles trouvent à se justifier ou à se fonder dans l’œuvre de Spinoza -
sans craindre d’éclairer à nouveau certains aspects de la doctrine, que la recherche
systématique de ce qu’elle offre elle-même de systématique, ou de plaisant pour le
lecteur, peut conduire à laisser dans l’ombre.
5
F. Alquié, Le rationalisme de Spinoza, p. 350 : « Nul ne saurait méconnaître le caractère
fascinant d’une telle philosophie ».
6
Voir Par delà le bien et le mal -prélude d’une philosophie de l’avenir. Première partie : Les
préjugés des philosophes, § 5 : « [...] Ou encore ces jongleries mathématiques, dont Spinosa a
masqué sa philosophie -c'est-à-dire ‘l’amour de sa propre sagesse’, pour interpréter ainsi comme il
convient le mot ‘philosophie’, -dont il a armé sa philosophie comme d’une cuirasse, pour intimider
ainsi, dès le début, l’audace des assaillants qui oseraient jeter un regard sur cette vierge invincible,
véritable Pallas Athénée ! Combien cette mascarade laisse deviner la timidité et le côté vulnérable
d’un malade solitaire ! » (traduction Henri Albert, Mercure de France, 1898. L’ouvrage de
Nietzsche avait été publié en 1886).
7
Comme le montre bien l’un de ses plus grands historiens, Paul Vernière, dans son fameux
Spinoza et la pensée française avant la Révolution, Paris : PUF, 1954 (réédité en 1982).
8
Suivant en cela l’injonction spinozienne du Traité Politique (1/4) : « ne pas rire des actions
des hommes, ne pas les déplorer, encore moins les détester -mais seulement les comprendre »
<humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere>.

R
ÉCEPTION ET
S
ENS
G
ÉNÉRAL DU
S
PINOZISME
4
ATHÉISME, IMMORALISME.
9
Il peut sembler incroyable d’avoir pu accuser d’athéisme une
philosophie qui s’ouvre sur un De Deo, qui démontre l’existence de Dieu, et qui
déclare par exemple (une citation entre mille), en Éthique II 10 scolie 2, que « tous
doivent accorder assurément que rien ne peut être ni être conçu sans Dieu <nihil
sine Deo esse, neque concipi posse> ; car tous reconnaissent que Dieu est la cause
unique de toutes choses, tant de leur essence que de leur existence ; c'est-à-dire que
Dieu n’est pas seulement cause des choses quant au devenir, comme on dit, mais
quant à l’être »
10
; une philosophie qui se place en outre volontiers sous l’autorité
des textes sacrés (ainsi Jean en exergue au Traité Théologico-Politique : « Nous
connaissons à ceci que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous : qu’il
nous a donné de son esprit »
11
) ; une philosophie, enfin, qui accorde un rôle
absolument déterminant à la figure du Christ
12
. Et cependant, l’imputation
d’athéisme a été la première dont a bénéficié Spinoza, avec une constance et une
force tout à fait remarquables. D’abord parce que le Dieu de Spinoza est « Deus sive
Natura », c'est-à-dire, non seulement le Dieu des philosophes, insensible, nécessaire,
immanent à tout ce qui est, parfait, infini, éternel, anhistorique, et, en ce sens,
impersonnel, ne se souciant pas des prières des hommes ou de leurs espérances,
incapable bien sûr de prendre telle ou telle forme sensible, que ce soit celle d’un
homme (son « fils » !), ou d’une hostie
13
; Dieu, donc, « sans miracles et sans
prophètes »
14
, sans croix, sans prières, sans espérance, et sans résurrection -religion
si singulière en son temps qu’il fallut que le philosophe Anglais John Toland,
disciple en esprit de Spinoza, forge le nom de « panthéisme »
15
(inconnu du vivant
9
Voir Roland Caillois, « Spinoza et l’athéisme », in Spinoza nel 350° anniversario della
nascita. Atti del Congresso (Urbino 4-8 ottobre 1982). Naples : Bibliopolis, 1985, pp. 3-33.
10
E II 10 sc 2 : [...] nam apud omnes in confesso est, quod Deus omnium rerum, tam earum
essentiae, quam earum existentiae, unica est causa, hoc est, Deus non tantum est causa rerum
secundum fieri, ut aiunt, sed etiam secundum esse.
11
Jean, ép I, ch IV, v. 13 ; formule reprise dans la Lettre 76 à Albert Burgh.
12
Voir Alexandre Matheron, Le Christ et le Salut des Ignorants chez Spinoza. Paris : Aubier-
Montaigne, 1971.
13
Certains passages sont particulièrement explicites à cet égard : on lit ainsi, dans la Lettre
76 à Albert Burgh : « encore ces absurdités seraient-elles supportables si vous adoriez un Dieu
infini et éternel et non celui que Châtillon, dans la ville de Tienen en flamand, a donné
impunément à manger à ses chevaux. Et vous me plaignez, malheureux que vous êtes. Et vous
traitez de chimère une philosophie que vous ne connaissez même pas ! O jeune insensé, qui a pu
vous égarer à ce point que vous croyiez avaler et avoir dans les entrailles l’être souverain et
éternel ! ».
14
Paul Vernière, Spinoza et la Pensée Française avant la Révolution, p. 34
15
Le terme « panenthéisme » aurait été, selon Gueroult, plus exact (Spinoza 1, p. 223 : « Par
l’immanence des choses à Dieu est jeté le premier fondement du panthéisme, ou, plus exactement,
d’une certaine forme de panenthéisme. Ce n’est pas le panthéisme proprement dit, car tout n’est
pas Dieu. Ainsi, les modes sont en Dieu, sans cependant être Dieu à la rigueur, car, postérieurs à la
substance, produits par elle, et, à ce titre, sans commune mesure avec elle, ils en diffèrent toto
genere »). La remarque de Gueroult est sans doute très juste -encore qu’il aurait peut-être fallu
préciser que Dieu, chez Spinoza, est tout autant « dans » les modes que les modes sont « en » Dieu
(puisque, comme le précise E V 24, « plus nous connaissons les choses singulières, plus nous

R
ÉCEPTION ET
S
ENS
G
ÉNÉRAL DU
S
PINOZISME
5
de Spinoza, même s’il nous est aujourd’hui si familier que nous le croyons souvent
bien plus ancien qu’il n’est) pour la caractériser. D’autre part, si l’on considère la
critique des textes sacrés développée dans le Traité Théologico-Politique, la remise
en cause de l’authenticité de nombreux passages de l’Ancien Testament, enfin la
proposition, toujours dans le Traité Théologico-Politique, d’une religion fondée sur
des « dogmes de la foi universelle »
16
, on ne peut que conclure que Spinoza, s’il
n’était pas athée à proprement parler, l’était certainement au sens que l’on pouvait
donner à ce terme au XVII
è
: ne pas appartenir à une Église, ne pas pratiquer, et ne
pas accorder de valeur spirituelle aux cultes ni aux rites. De ce point de vue, le
personnage du Christ, en effet central, est chez Spinoza de toute évidence d’abord
un homme, et ensuite un philosophe, le « plus grand des philosophes » : mais, un
peu à la manière de ce que fera Nietzsche plus tard, dans L’Antéchrist, Spinoza
n’accorde aucune valeur à la dimension doloriste de la religion chrétienne (surtout
catholique) : il n’est de l’essence d’aucune chose singulière, et donc il n’est pas de
l’essence du Christ, de mourir sur la croix, et la religion, à leurs yeux, a donc
déplacé indûment le centre de gravité des Évangiles de la vie du Christ (et de la
Prédication du Royaume), vers sa mort (et vers la Passion)
17
.
On peut donc comprendre dans quelle mesure, bien que ne parlant quasi
que de Dieu, Spinoza ait pu être enrôlé dès le début parmi les adversaires de la
religion. Il attire, durant sa vie, l’intérêt des libertins, comme Saint Evremond ; on
lui attribue une entrevue (finalement annulée, quoique programmée) avec le Prince
de Condé, le protecteur de Molière dans l’affaire du Tartuffe ; la première traduction
du Traité Théologico-Politique paraît un an après la mort de Spinoza, donc en
1678 : publiée sous de faux noms chez de faux éditeurs, elle est en français, et due à
Gabriel de Saint-Glain, qui lui aussi faisait partie de ce milieu libertin. Cette
imputation initiale d’athéisme a duré jusqu’à aujourd’hui, et permet de comprendre
comment Spinoza a continué à nourrir des pensées essentiellement athées : certains
développements contemporains du marxisme (Althusser, Negri), mais aussi des
philosophies aussi originales que celles de Deleuze ou de Badiou, tandis qu’il
continue à faire horreur à quelqu’un comme Lévinas (et à toute forme de pensée,
frémissante ou gémissante, pour laquelle la « totalité » n’est encore jamais assez)
18
.
connaissons Dieu »). Le terme « panenthéisme » ne s’est cependant pas imposé (sans doute en
raison, pensons-nous, de son côté trop compliqué et insuffisamment euphonique), tandis que
« panthéisme » est entré dans le vocabulaire courant, comme dans l’histoire de la pensée.
16
TTP XIV: fidei universalis dogmata (G [=éd. Gebhardt] III 177 14) . Ces dogmes sont
exposés par Spinoza en 7 points aux pages 177-178.
17
Pour une critique des thèses de Nietzsche, et une réévaluation des rôles respectifs du Christ
et de Saint Paul, voir le récent livre d’Alain Badiou, Saint Paul et la Naissance de l’Universalisme,
aux PUF (1997).
18
Voir la dernière phrase de la Première Section de Totalité et Infini ( 1961) : « la pensée et
la liberté nous viennent de la séparation et de la considération d’Autrui -cette thèse est aux
antipodes du spinozisme » ; et surtout, dans le recueil Difficile Liberté, l’article intitulé « Le cas
Spinoza » (1955/6) : « Nous sommes entièrement de l’avis de notre regretté et admirable ami Jacob
Gordin : il existe une trahison de Spinoza. Dans l’histoire des idées, il a subordonné la vérité du
judaïsme à la révélation du Nouveau Testament. Celle-ci, certes, se dépasse par l’amour
intellectuel de Dieu, mais l’être occidental comporte cette expérience chrétienne, fût-ce comme
étape. Dès lors saute aux yeux le rôle néfaste joué par Spinoza dans la décomposition de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%