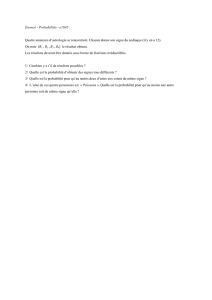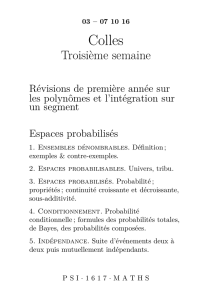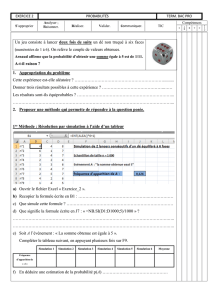Les fondements philosophiques du concept de probabilité

Les fondements philosophiques du concept
de probabilité
X. De Scheemaekere
CEB Working Paper N° 09/025
Université Libre de Bruxelles - Solvay Brussels School of Economics and Management
Centre Emile Bernheim
ULB CP145/01 50, avenue F.D. Roosevelt 1050 Brussels BELGIUM
e-mail: [email protected] Tel. : +32 (0)2/650.48.64 Fax : +32 (0)2/650.41.88

Les fondements philosophiques du
concept de probabilité
Xavier DE SCHEEMAEKERE

ii
Remerciements
Nous tenons à remercier tout particulièrement Marc Peeters, pour ses précieux
conseils, ainsi qu’Ariane Szafarz, qui nous a introduit à la philosophie des
probabilités.

iii
Table des matières
1. Introduction
1.1 La philosophie des probabilités……………………………………………...
1.1.1 Quelques arguments……………………………………………….
1.1.2 La double face du concept de probabilité…………………….…....
1.2 Les axiomes du calcul des probabilités……………………………………...
1.3 Structure……………………………………………………………………..
1.4 Méthodologie………………………………………………………………..
2. La théorie classique
2.1 De Pascal à Laplace………………………………………………………….
2.2 Le principe d’équipossibilité………………………………………………...
3. La théorie logique
3.1 Une relation a priori…………………………………………………………
3.1.1 John Maynard Keynes…………………………………………….
3.1.2 Rudolf Carnap……………………………………………………..
3.2 Le principe d’indifférence…………………………………………………..
3.2.1 Les paradoxes……………………………………………………..
3.2.2 Les solutions………………………………………………………
3.3 La nature de l’incertitude sous-jacente………………………………………
3.3.1 Clarence Irving Lewis……………………………………………..
3.3.2 Von Kries, Waismann,Wittgenstein……………………………….
3.4 Principe d’indifférence et mathématiques…………………………………...
4. La théorie subjective
4.1 Emile Borel………………………………………………………………….
4.2 Frank Plumpton Ramsey…………………………………………………….
4.2.1 Critiques de Keynes………………………………………………..
4.2.2 Le subjectivisme de Ramsey………………………………………
4.2.3 Subjectivisme et fréquentisme……………………………………..
4.3 Bruno de Finetti……………………………………………………………...
4.3.1 Un probabilisme radical…………………………………………...
4.3.2 La notion d’échangeabilité………………………………………...
5. La théorie fréquentielle
5.1 Robert Ellis et John Venn……………………………………………………
5.2 Richard von Mises…………………………………………………………...
5.2.1 La théorie des probabilités en tant que science……………………
5.2.2 La notion de collectif………………………………………………
5.3 Fréquences finies et fréquences limites……………………………………...
5.3.1 La théorie fréquentielle finie………………………………………
5.3.2 La théorie fréquentielle limite……………………………………..
5.3.3 Quelques arguments contre la théorie fréquentielle……………….
5.4 Les mathématiques et le concret…………………………………………….
5.4.1 L’origine des notions mathématiques……………………………...
5.4.2 L’échec d’une axiomatique………………………………………..
1
1
1
5
6
7
8
9
9
12
16
17
17
21
22
23
26
30
30
35
39
43
43
44
44
47
50
51
52
53
62
62
64
64
65
67
67
69
70
74
74
77

iv
6. La théorie de la propension
6.1 Charles Sanders Peirce………………………………………………………
6.2 Karl Raimund Popper………………………………………………………..
6.2.1 Un monde fait de propensions……………………………………..
6.2.2 Popper versus Pierce……………………………………………….
6.2.3 La propension des événements uniques…………………………...
6.2.4 La propension à long terme………………………………………..
6.3 Propension et probabilité : critiques…………………………………………
6.3.1 Le paradoxe de Humphreys………………………………………..
6.3.2 Quelques arguments contre la théorie de la propension…………...
7. Problèmes métaphysiques
7.1 Probabilité et possibilité……………………………………………………..
7.2 Probabilité et nécessité………………………………………………………
7.3 Probabilité et modalité………………………………………………………
8. Conclusion
Appendices
A.Une lettre de Kolmogorov à Fréchet………………………………………….
B. La probabilité conditionnelle et le théorème de Bayes……………………….
B.1 La probabilité conditionnelle………………………………………..
B.2 Le théorème de Bayes……………………………………………….
Bibliographie
79
79
81
81
86
89
91
92
92
94
100
100
102
103
106
110
110
111
111
111
113
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
1
/
122
100%