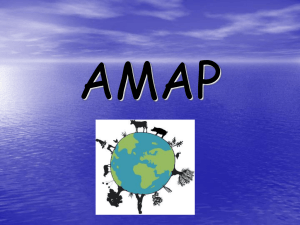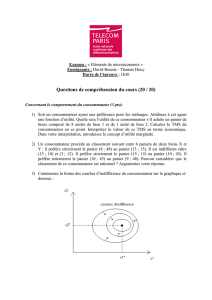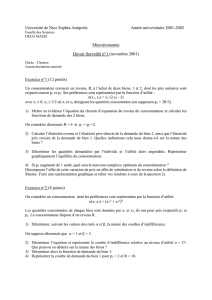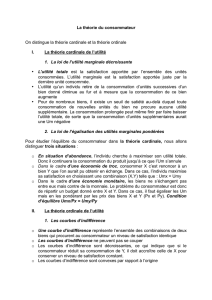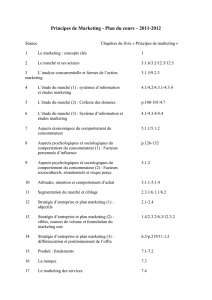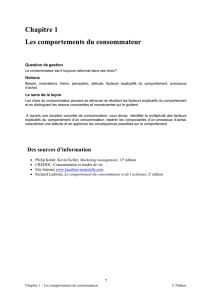Notes de cours chap2 Fichier - UHA

1
Micro-Économie
Economie Gestion L1 (S2)
Antoine Bureth ([email protected])
!
!
!
CHAPITRE!2!:!Théorie!du!comportement!du!consommateur!et!de!la!demande!.........!2!
§1!Théorie!de!l’utilité!et!de!la!préférence!..........................................................................................!2!
1.1.!Utilité!cardinale!et!lois!de!Gossen!..............................................................................................................!4!
1.2.!Utilité!ordinale!et!courbes!d’indifférences!.............................................................................................!6!
1.3.!Dérivées!partielles!et!taux!marginal!de!substitution!.....................................................................!11!
§2!La!maximisation!de!l’utilité!...........................................................................................................!15!
2.1.!Introduction!du!système!de!prix!:!construction!de!la!droite!de!budget!.................................!15!
2.2.!L’équilibre!du!consommateur!..................................................................................................................!16!
2.2.1.!Variation!du!revenu!................................................................................................................................................!19!
2.2.2.!Variation!en!prix!.......................................................................................................................................................!21!
!

2
!CHAPITRE!2!:!Théorie!du!comportement!du!consommateur!et!de!la!
demande!
Certains acteurs économiques perçoivent un revenu en vendant des ressources ou l’usage de
leurs ressources. D’autres perçoivent un revenu en organisant la production. D’autres enfin
perçoivent un revenu par transferts de revenus : la source du revenu monétaire importe peu et
seul compte le fait que leur argent est dépensé en biens de consommation. Dès lors, tous
entrent dans la catégorie des consommateurs.
Chaque acteur détermine comment répartir son revenu sur une vaste gamme de biens
disponibles. Comme il faut choisir entre plusieurs besoins, il faut pouvoir dire lequel doit être
satisfait en premier. Il faut donc exprimer des préférences fondées sur l'utilité ou la
satisfaction procurées par la consommation des différents biens et services. La perception par
le consommateur de sa fonction d’utilité est donc au centre de son processus de décision, i.e.
de sa demande individuelle.
L’agrégation de ces décisions constitue la demande du marché, expression de la manière dont
la société veut répartir (allouer) ses ressources. L’objet de ce chapitre est donc d’étudier les
mécanismes de formation de la demande. En quelques mots, la théorie de la demande porte
sur comportement d’un individu disposant d’un revenu monétaire donné et cherchant à
satisfaire des besoins par l’acquisition de biens et services ayant un prix. En d’autres termes,
le consommateur a un objectif - satisfaire des besoins - et il est soumis à une contrainte - son
pouvoir d’achat qui dépend du revenu dont il dispose et des prix des produits. C’est ce
programme que formalise la théorie micro-économique.
§1!Théorie!de!l’utilité!et!de!la!préférence!
Les économistes savent parfaitement que les "préférences" du consommateur ne tombent pas
du ciel, et que les "goûts" individuels sont socialement construits donc susceptibles d’être
influencés.
Pour essayer de construire une représentation du comportement du consommateur face aux
décisions qu’il doit prendre il faut cependant raisonner "toutes choses égales par ailleurs" ce
qui revient à traiter les préférences comme si elles étaient entièrement données (elles sont
exogènes). C'est seulement dans les développements plus avancés qui ne sont pas abordés
dans ce cours que l'interdépendance des préférences est introduite (il faut bien prendre en
compte, la mode, le mimétisme, la distinction...).
Un grand nombre de produits sont offerts aux choix du consommateur. Ce dernier constitue un
panier de consommation en choisissant des quantités de certains produits. Le consommateur

3
est supposé être capable de classer ses préférences c'est-à-dire d’indiquer s’il préfère
consommer le panier A ou le panier B.
Pour indiquer la préférence du consommateur entre le panier A au panier B on écrit :
si le panier A est préféré ou équivalent au panier B
si A est strictement préféré à B
si A est équivalent (indifférent) à B
Le choix du consommateur est complètement déterminé s’il connaît un classement (et
seulement un) des biens par rapport à ses préférences. Pour atteindre son objectif – la
maximisation de son utilité pour un revenu monétaire donné – l’agent doit être capable de
comparer différents ensembles de biens (on parle de panier de biens), et ces comparaisons
reposent sur trois hypothèses de base qui caractérisent la rationalité du consommateur1:
1 Le problème de la rationalité est un problème de fond en économie, et déborde largement le
cadre de cette discipline, en se plaçant au confluent de matière variées comme la psychologie,
la sociologie, la neurologie, etc. Il n'y a actuellement pas d'outil satisfaisant à un niveau
général. Si la rationalité "parfaite" a permis d'obtenir de nombreux résultats, elle parait
relativement mal adapté à l'étude de certains problèmes comme par exemple l'analyse des
choix inter-temporels.
- les modèles souffrent souvent d'un déterminisme excessif. Le supplément d'information est
délivré par l'environnement (pas d'apprentissage dans et par l'action). De plus, le lien entre les
actions présentes et les conséquences futures est immédiat.
- de plus, l'invariance des préférences oblige à prendre en compte l'apprentissage par une
croissance de la variété de comportements prédéterminés. Il n'y a pas d'auto-construction des
agents.
Or, si l'environnement est instable, le problème posé en termes de choix n'apparait pas
nécessairement clairement. Dans le prolongement, les conséquences sont souvent difficiles à
attribuer à des actions.
De manière lapidaire, deux écoles se côtoient actuellement; d'une part les tenants de la
rationalité "substantive" (équilibre général") et d'autre part, les chercheurs qui se basent sur la
notion de rationalité procédurale (l'agent est une unité décisionnelle en construction, dont
l'étude requiert la compréhension des processus de décision bien plus que des décisions elles-
mêmes). Mais dans ce dernier cas, la problématique se différencie de l'étude de l'équilibre
"standard": on s'intéresse entre autres plus aux mécanismes de création de ressources qu'à
l'allocation des ressources. L'analyse s'appuie alors sur le concept de rationalité contextuelle
(contingence des objectifs, organisation, compétences, etc.) et systémique (l'agent dispose de
pans de conceptualisation "pré-fabriqués").

4
- On pose un principe de non-saturation, qui signifie que si la quantité d'un bien augmente,
l'utilité que retire le consommateur augmente aussi. Cela n'exclut pas le principe de l'utilité
marginale décroissante, càd qu'au fur et à mesure que la consommation d'un bien augmente,
l'utilité que procure la dernière unité consommée va décroissant (bien que l'utilité totale
augmente).
- Pour toutes les alternatives possibles, le consommateur sait quelles sont les combinaisons
de biens qu'il préfère à d'autres (hypothèse extrêmement forte qui fait de l'agent économique
un "super-ordinateur", traitant une information parfaite dans le modèle "pur"). De plus les
préférences sont supposées stables dans le temps toutes choses restant égales par ailleurs.
- si un consommateur préfère X à Y et Y à Z, il préfère X à Z. Avec cette dernière hypothèse
de transitivité, on considère que les préférences constituent un pré-ordre total. (NB:
l'économie expérimentale a montré que la transitivité des préférences n'était pas toujours
vérifiée, notamment du fait de la nature contextuelle des choix).
1.1.!Utilité!cardinale!et!lois!de!Gossen!
Les économistes à la fin du 19° siècle admettaient que l'utilité des biens était mesurable,
comme les poids ou les longueurs. Le consommateur est capable de chiffrer l'utilité que lui
procure la consommation de chaque bien, autrement dit il est à même de procéder à une
mesure cardinale de l'utilité (pour Jevons, la théorie économique se résume au calcul des
plaisirs et des peines).
exemple d'illustration d'une mesure cardinale de l'utilité:
quantités consommées utilité totale utilité marginale
1 1 1
2 5 4
3 8 3
4 10 2
5 11 1
6 11,5 0,5
Sur cet exemple, on voit tout d’abord que l’utilité que retire le consommateur est croissante
avec sa consommation. Mais cette croissance de l’utilité va en s’amenuisant avec
l’augmentation de la quantité consommée. On peut alors en déduire le comportement du
consommateur. Le consommateur n’en achètera plus si l’utilité qu’il perd en achetant une
unité supplémentaire (qui correspond à la perte de son pouvoir d’achat) est plus grande que
l’utilité que lui procure la consommation de cette unité supplémentaire. Supposons que
l’utilité d’un euro soit de 3 unité d’utilité, et que le prix unitaire de ce bien soit de 1 €. Le
consommateur décidera d’acheter 3 unités, mais pas plus. En revanche, si le prix passe à 0,5€,

5
sa consommation augmentera et passera à 4 unités – une baisse du prix entraine une hausse de
la quantité demandée.
On retrouve ici les lois de Gossen2.
Loi 1 : lorsqu’un individu consomme une unité supplémentaire d’un bien, son utilité augmente
mais d’un montant toujours plus petit. En d’autres termes, son utilité marginale est
décroissante. Dans les faits, il ne s'agit pas à proprement parler d'une loi qui serait
démontrable, et elle souffre de quelques exceptions (les biens qui réclament une certaine
accoutumance pour générer une satisfaction, par exemple : dans ce cas l'utilité est d'abord
faible voire négative avant de croitre) mais globalement elle est bien vérifiée. Par ailleurs, elle
n’est pas nécessaire pour la théorie du consommateur.
Loi 2 : Pour maximiser sa satisfaction, le consommateur doit égaliser les utilités marginales
pondérées par les prix ("rapport qualité/prix").
Algébriquement, on obtient l’expression suivante :
Soit trois biens, X, Y et Z,
Umx Umy Umz leurs utilités marginales respectives,
et px, py, pz leurs prix respectifs.
Umx Umy Umz
À l'optimum, on a : –––– = –––– = ––––
px py pz
Exemple chiffré :
Soit un consommateur disposant d’un budget de 28 EUR.
Il consomme deux biens : des pommes et du pain, symbolisés respectivement par x et y.
Le prix du kg de pommes est de 6 EUR, et le prix du kg de pain, 2 EUR.
Les utilités marginales sont les suivantes :
Quantité Utilité marginale de X Utilité marginale de Y
1 30 40
2 20 30
3 12 Perte 15
4 Gain 5 8 Perte
5 3 4
6 2 3
7 1 2 Gain
8 0,5 1
Compte tenu du budget du consommateur, la combinaison optimale (obtenue par tâtonnement) est le panier:
x* = 3 et y* = 5.
2 Heinrich Gossen peut être considéré comme l'un des fondateurs de la théorie néo-classique
du consommateur. Il est l'auteur d'un seul ouvrage, publié à compte d'auteur en 1854.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%