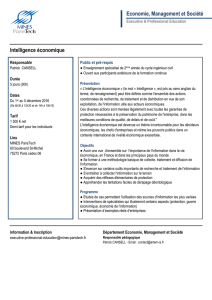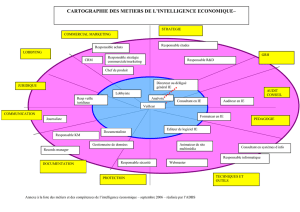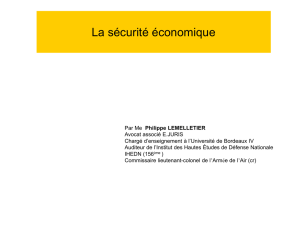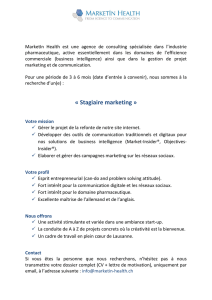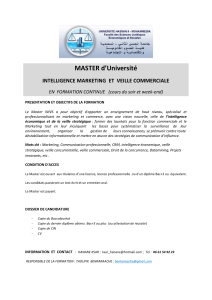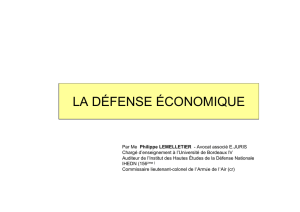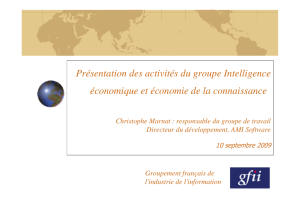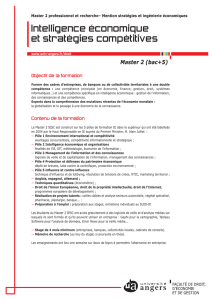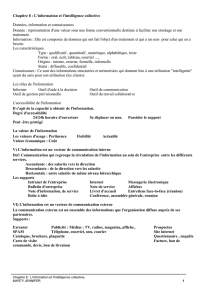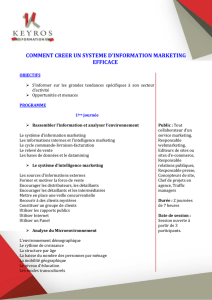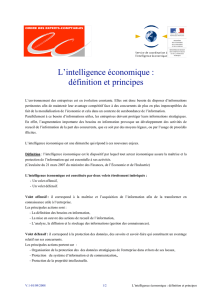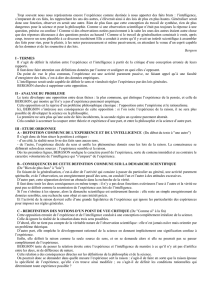L`évolution créatrice

L’évolution créatrice
Henri BERGSON
1907
éd° PUF (2007)
coll. Quadrige
édition critique Le choc Bergson sous la direction de Frédéric WORMS
Introduction
VI-VII limite de notre intelligence
notre pensée, sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la vraie nature de la vie, la
signification profonde du mouvement évolutif. Créée par la vie, dans des circonstances déterminées, pour agir
sur des choses déterminées, comment embrasserait-elle la vie, dont elle n’est qu’une émanation ou un aspect ?
Déposée, en cours de route, par le mouvement évolutif, comment s’appliquerait-elle le long du mouvement
évolutif lui-même ? Autant vaudrait prétendre que la partie égale le tout, que l’effet peut résorber en lui sa cause,
ou que le galet laissé sur la plage dessine la forme de la vague qui l’apporta. […] En vain nous poussons le
vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop rigides surtout pour ce
que nous voudrions y mettre. Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se
sent d’ailleurs mal à son aise sur ce nouveau terrain. […]
[…] une intelligence tendue vers l’action qui s’accomplira et vers la réaction qui s’ensuivra, palpant son
objet pour en recevoir à chaque instant l’impression mobile, est une intelligence qui touche quelque chose de
l’absolu. L’idée nous serait-elle jamais venue de mettre en doute cette valeur absolue de notre connaissance, si la
philosophie ne nous avait montré à quelles contradictions notre spéculation se heurte, à quelles impasses elle
aboutit ? Mais ces difficultés, ces contradictions naissent de ce que nous appliquons les formes habituelles de
notre pensée à des objets sur lesquels notre industrie n’a pas à s’exercer et pour lesquels, par conséquent, nos
cadres ne sont pas faits.
IX théories de la vie & de la connaissance
C’est dire que la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l’une de
l’autre. Une théorie de la vie qui ne s’accompagne pas d’une critique de la connaissance est obligée d’accepter,
tels quels, les concepts que l’entendement met à sa disposition : elle ne peut qu’enfermer les faits, de gré ou de
force, dans des cadres préexistants qu’elle considère comme définitifs. Elle obtient ainsi un symbolisme
commode, nécessaire même peut-être à la science positive, mais non pas une vision directe de son objet. D’autre
part, une théorie de la connaissance, qui ne replace pas l’intelligence dans l’évolution générale de la vie, ne nous
apprendra ni comment les cadres de la connaissance se sont constitués, ni comment nous pouvons les élargir ou
les dépasser. Il faut que ces deux recherches, théorie de la connaissance et théorie de la vie, se rejoignent, et, par
un processus circulaire, se poussent l’une l’autre indéfiniment.
Chapitre 1
4-5 durée
La durée est le progrès continu du passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant. Du moment que le
passé s’accroît sans cesse, indéfiniment aussi il se conserve. La mémoire, comme nous avons essayé de le
prouver, n’est pas une faculté de classer des souvenirs dans un tiroir ou de les inscrire sur un registre. Il n’y a pas
de registre, pour de tirer, il n’y a même pas ici, à proprement parler, une faculté, car une faculté s’exerce par
intermittences, quand elle veut ou quand elle peut, tandis que l’amoncellement du passé sur le passé se poursuit
sans trêve. En réalité le passé se conserve de lui-même, automatiquement. Tout entier, sans doute, il nous suit à
tout instant : ce que nous avons senti, pensé, voulu depuis notre première enfance est là, penché sur le présent qui
va s’y joindre, pressant contre la porte de la conscience qui voudrait le laisser dehors. Le mécanisme cérébral est
précisément fait pour un refouler la presque totalité dans l’inconscient et pour n’introduire dans la conscience

que ce qui est de nature à éclairer la situation présente, à aider l’action qui se préparer, à donner enfin un travail
utile. Tout au plus des souvenirs de luxe arrivent-ils, par la porte entrebâillée, à passer en contrebande. Ceux-là,
messagers de l’inconscient, nous avertissent de ce que nous traînons derrière nous sans le savoir. […] Que
sommes-nous en effet, qu’est-ce que notre caractère, sinon la condensation de l’histoire que nous avons vécue
depuis notre naissance, avant notre naissance même, puisque nous apportons avec nous des dispositions
prénatales ? Sans doute nous ne pensons qu’avec une petit partie de notre passé ; mais c’est avec notre passé tout
entier, y compris notre courbure d’âme originelle, que nous désirons, voulons, agissons.
6-7 création
Le portrait achevé s’explique par la physionomie du modèle, par la nature de l’artiste, par les couleurs
délayées sur la palette ; mais, même avec la connaissance de ce qui l’expliquer, personne, pas même l’artiste,
n’eût pu prévoir exactement ce que serait le portrait, car le prédire eût été le produire avant qu’il fût produit,
hypothèse absurde qui se détruit elle-même. Ainsi pour les moments de notre vie, dont nous sommes les artisans.
Chacun d’eux est une espèce de création. Et de même que le talent du peintre se forme ou se déforme, en tout cas
se modifie, sous l’influence même des œuvres qu’il produit, ainsi chacun de nos états, en même temps qu’il sort
de nous, modifie notre personne, étant en même temps qu’il sort de nous, modifie notre personne, étant la forme
nouvelle que nous venons de nous donner. On a donc raison de dire que ce que nous faisons dépend de ce que
nous sommes ; mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons, et que nous
nous créons continuellement nous-mêmes.
7 raison propre à chacun
Cette création de soi par soi est d’autant plus complète, d’ailleurs, qu’on raisonne mieux sur ce qu’on
fait. Car la raison ne procède pas ici comme en géométrie, où les prémisses sont données une fois pour toutes,
impersonnelles et où une conclusion impersonnelle s’impose. Ici, au contraire, les mêmes raisons pourront dicter
à des personnes différentes, ou à la même personne à des moments différents, des actes profondément différents,
quoique également raisonnables. A vrai dire, ce ne sont pas tout à fait les mêmes raisons, puisque ce ne sont pas
celles de la même personne, ni du même moment. C’est pourquoi l’on ne peut pas opérer sur elles in abstracto,
du dehors, comme en géométrie, ni résoudre pour autrui les problèmes que la vie lui pose. A chacun de les
résoudre du dedans, pour son compte.
10 mathématisation de la matière
la matière a une tendance à constituer des systèmes isolables, que se puissent traiter aisément
géométriquement. C’est même par cette tendance que nous la définirions. Mais ce qu’est qu’une tendance. La
matière ne va pas jusqu’au bout, et l’isolement n’est jamais complet. Si la science va jusqu’au bout et isole
complètement, c’est pour a commodité de l’étude. Elle sous-entend que le système, dit isolé, reste soumis à
certaines influences extérieures. Elle le laisse simplement de côté, soit parce qu’elle les trouve assez faibles pour
les négliger, soit parce qu’elle se réserve d’en tenir compte plus tard. Il n’en est pas moins vrai que ces
influences sont autant de fils qui relient le système à un autre plus vaste
11 durée de la matière
Rien n’empêche […] d’attribuer aux systèmes que la science isole une durée et, par là, une forme
d’existence analogue à la nôtre, si on les réintègre dans le Tout. Mais il faut les y réintégrer.
13 définition
Une définition parfaite ne s’applique qu’à une réalité faite : or, les propriétés vitales ne sont jamais
entièrement réalisées, mais toujours en voie de réalisation ; ce sont moins des états que des tendances. Et une
tendance n’obtient tout ce qu’elle vise que si elle n’est contrariée par aucune autre tendance : comment ce cas se
présenterait-il dans le domaine de la vie, où il y a toujours […] implication réciproque de tendances
antagonistes ?
17 tendance mécanistique
L’instinct mécanistique de l’esprit est plus fort que le raisonnement, plus fort que l’observation
immédiate. Le métaphysicien que nous portons inconsciemment en nous, et dont la présence s’explique […] par
la place même que l’homme occupe dans l’ensemble des êtres vivants, a ses exigences arrêtées, ses explications
faites, ses thèses irréductibles : toutes se ramènent à la négation de la durée concrète. Il faut que le changement
se réduise à un arrangement ou à un dérangement de parties, que l’irréversibilité du temps soit une apparence
relative à notre ignorance, que l’impossibilité du retour en arrière ne soit que l’impuissance de l’homme à
remettre les choses en place.

20 intelligence
Quant à l’idée que le corps vivant pourrait être soumis par quelque calculateur surhumain au même
traitement mathématique que notre système solaire, elle est sortie peu à peu d’une certaine métaphysique que a
pris une forme plus précise depuis les découvertes physiques de Galilée, mais qui [..] fut toujours la
métaphysique naturelle de l’esprit humain. Sa clarté apparente, notre impatient désir de la trouver raie,
l’empressement avec lequel tant d’excellents esprits l’acceptent sans preuve, toutes les séductions enfin d’elle
exerce sur notre pensée devraient nous mettre en garde contre elle. L’attrait qu’elle a pour nous prouve assez
qu’elle donne satisfaction à une inclination innée. Mais [..] les tendances intellectuelles, aujourd’hui innées, que
la vie a dû créer au cours de son évolution, sont faites pour tout autre chose que nous fournir une explication de
la vie.
22 temps mathématique
le monde sur lequel le mathématicien opère est un monde qui meurt et renaît à chaque instant, celui-là
même pensait Descartes quand il parlait de création continuée. Mais, dans le temps ainsi conçu, comment se
représenter une évolution, c’est-à-dire le trait caractéristique de la vie ? L’évolution, elle, implique une
continuation réelle du passé par le présent, une durée qui est un trait d’union. En d’autres termes, la
connaissance d’un être vivant ou système naturel est une connaissance qui porte sur l’intervalle même de durée,
tandis que la connaissance d’un système artificiel ou mathématique ne porte que sur l’extrémité ?
29 science
Notre intelligence, telle que l’évolution de la vie l’a modelée, a pour fonction essentielle d’éclairer notre
conduite, de préparer notre action sur les choses, de prévoir, pour une situation donnée, les événements
favorables ou défavorables qui pourront s’ensuivre. Elle isole donc instinctivement, dans une situation, ce qui
ressemble au déjà connu ; elle cherche le même, afin de pouvoir appliquer son principe que « le même produit le
même ». En cela consiste la prévision de l’avenir par le sens commun. La science porte cette opération au plus
haut degré possible d’exactitude et de précision, mais elle n’en altère pas le caractère essentiel. Comme la
connaissance usuelle, la science ne retient des choses que l’aspect répétition. Si le tout est original, elle s’arrange
pour l’analyser en éléments ou en aspects qui soient à peu près la reproduction du passé. Elle ne peut opérée que
sur ce qui est censé se répéter, c’est-à-dire sur ce qui est soustrait, par hypothèse, à l’action de la durée. Ce qu’il
y a d’irréductible et d’irréversible dans les moments successifs d’une histoire lui échappe.
30-31 vie & déterminisme
nous ne contestons pas l’identité fondamentale de la matière brute et de la matière inorganisée.
L’unique question est de savoir si les systèmes naturels que nous appelons des êtres vivants doivent être
assimilés aux systèmes artificiels que la science découpe dans la matière brute, ou s’ils ne devraient pas plutôt
être comparés à ce système naturel qu’est le tout de l’univers. Que la vie soit une espèce de mécanisme, je le
veux bien. Mais est-ce le mécanisme des parties artificiellement isolables dans le tout de l’univers, ou celui du
tout réel ? Le tout réel pourrait bien être […] une continuité indivisible : les systèmes que nous y découpons n’en
seraient point alors, à proprement parler, des parties ; ce seraient des vues partielles prises sur le tout. Et, avec
ces vies partielles mises bout à bout, vous n’obtiendriez même pas un commencement de recomposition de
l’ensemble, pas plus qu’en multipliant les photographies d’un objet, sous mille aspects divers, vous n’en
reproduirez la matérialité. Ainsi pour la vie et pour les phénomènes physico-chimiques en lesquels on prétendrait
la résoudre. L’analyse découvrira sans doute dans les processus de création organique un nombre croissant de
phénomènes physico-chimiques. Et c’est à quoi s’en teindront les chimistes et les physiciens. Mais il ne suit pas
de là que la chimie et la physique doivent nous donner la clef de la vie.
Un élément très petit d’une courbe est presque une ligne droite. Il ressemblera d’autant plus à une ligne
droite qu’on le prendra plus petit. A la limite, on dira, comme on voudra, qu’il fait partie d’une droite ou d’une
courbe. En chacun de ses points, en effet, la courbe se confond avec sa tangente. Ainsi la « vitalité » est tangente
en n’importe quel point aux forces physiques et chimiques ; mais ces points ne sont, en somme, que les vues
d’un esprit qui imagine des arrêts à tels ou tels moments du mouvement générateur de la courbe. En réalité, la
vie n’est pas plus faite d’éléments physico-chimiques qu’une courbe n’est composée de lignes droites.
39-40 mécanisme & finalisme
Dans une pareille doctrine, on parle encore du temps, on prononce le mot, mais on ne pense guère à la
chose. Car le temps y est dépourvu d’efficace, et, du moment qu’il ne fait rien, il n’est rien.
Le mécanisme radical implique une métaphysique où la totalité du réel est posée en bloc, dans
l’éternité, et où la durée apparente des choses exprime simplement l’infirmité d’un esprit qui ne peut pas

connaître tout à la fois. Mais la durée est bien autre chose que cela pour notre conscience, c’est-à-dire pour ce
qu’il y a de plus indiscutable dans notre expérience. Nous percevons la durée comme un courant qu’on ne saurait
remonter. Elle est le fond de notre être et, nous le sentons bien, la substance même des choses avec lesquelles
nous sommes en communication. En vain, on fait briller à nos yeux la perspective d’une mathématique
universelle ; nous ne pouvons sacrifier l’expérience aux exigences d’un système. C’est pourquoi nous repoussons
le mécanisme radical.
Mais le finalisme radical nous paraît tout aussi inacceptable. […] Le finalisme ainsi entendu n’est qu’un
mécanisme à rebours. Il s’inspire du même postulat, avec cette seule différence que, dans la course de nos
intelligences finies le long de la succession tout apparente des choses, il met en avant de nous la lumière avec
laquelle il prétend nous guider, au lieu de la placer derrière. Il substitue l’attraction de l’avenir à l’impulsion du
passé. Mais la succession n’en reste pas moins une pire apparence comme d’ailleurs la course elle-même.
44-46 mécanisme & finalisme
L’erreur du finalisme radical, comme d’ailleurs celle du mécanisme radical, est d’étendre trop loin
l’application de certains concepts naturels à notre intelligence. Originellement, nous ne pensons que pour agir.
C’est dans le moule de l’action que notre intelligence a été coulée. La spéculation est un luxe, tandis que l’action
est une nécessité. Or, pour agir, nous commençons par nous proposer un but ; nous faisons un plan, puis nous
passons au détail du mécanisme qui le réalisera. Cette dernière opération n’est possible que si nous savons sur
quoi nous pouvons compter. Il faut que nous ayons extrait, de la nature, des similitudes qui nous permettent
d’anticiper sur l’avenir. Il faut donc que nous ayons fait application, consciemment ou inconsciemment, de la loi
de causalité. D’ailleurs, mieux se dessine dans notre esprit l’idée de la causalité efficiente, plus la causalité
efficiente prend la forme d’une causalité mécanique. Cette dernière relation, à son tour, est d’autant plus
mathématique qu’elle exprime une plus rigoureuse nécessité. C’est pourquoi nous n’avons qu’à suivre la pente
de notre esprit pour devenir mathématiciens. Mais, d’autre part, cette mathématique naturelle n’est que le soutien
inconscient de notre habitude consciente d’enchaîner les mêmes causes aux mêmes effets ; et cette habitude elle-
même a pour objet ordinaire de guider des actions inspirées par des intentions ou, ce qui revient au même, de
diriger des mouvements combinés en vue de l’exécution d’un modèle : nous naissons artisans comme nous
naissons géomètres, et même nous ne sommes géomètres que parce que nous sommes artisans. Ainsi
l’intelligence humaine, en tant que façonnée aux exigences de l’action humaine, est une intelligence qui procède
à la fois par intention et par calcul, par la coordination de moyens à une fin et par la représentation de
mécanismes à formes de plus en plus géométriques. […]
[…] [les principes de finalité et de causalité mécanique] s’accordent encore à faire table rase du temps.
La durée réelle est celle qui mord sur les choses et qui laisse l’empreinte de sa dent. Si tout est dans le temps,
tout change intérieurement, et la même réalité concrète ne se répète jamais. La répétition n’est donc possible
que dans l’abstrait : ce qui se répète, c’est tel ou tel aspect que nos sens et surtout notre intelligence ont détaché
de la réalité, précisément parce que notre action, sur laquelle tout l’effort de notre intelligence est tendu, ne se
peut mouvoir que parmi des répétitions. Ainsi, concentrée sur ce qui se répète, uniquement préoccupée de souder
le même au même, l’intelligence se détourne de la vision du temps. Elle répugne au fluent et solidifie tout ce
qu’elle touche. Nous ne pensons pas le temps réel. Mais nous le vivons, parce que la vie déborde
l’intelligence.
47-48 l’action, au-delà des mécanisme & finalisme
Dès que nous sortons des cadres où le mécanisme et le finalisme radical enferment notre pensée, la
réalité nous apparaît comme un jaillissement ininterrompu de nouveautés, donc chacune n’a pas plutôt surgi pour
faire le présent qu’elle a déjà reculé dans le passé : à cet instant précis elle tombe sous le regard de l’intelligence,
dont les yeux sont éternellement tournés en arrière. Tel est déjà le cas de notre vie intérieure. A chacun de nos
actes on trouvera sans peine des antécédents dont il serait, en quelque sorte, la résultante mécanique. Et l’on dira
aussi bien que chaque action est l’accomplissement d’une intention. En ce sens le mécanisme est partout, et la
finalité partout, dans l’évolution de notre conduite. Mais, pour peu que l’action intéresse l’ensemble de notre
personne et soit véritablement nôtre, elle n’aurait pu être prévue, encore que ses antécédents l’expliquent une
fois accomplie. Et, tout en réalisant une intention, elle diffère, elle, réalité présente et neuve, de l’intention, qui
ne pouvait être qu’un projet de recommencement ou de réarrangement du passé. Mécanisme et finalisme ne sont
donc ici que des vues extérieures prises sur notre conduite. Ils en extraient l’intellectualité. Mais notre conduite
glisse entre les deux et s’étend beaucoup plus loin. Cela ne veut pas dire […] que l’action libre soit l’action
capricieuse, déraisonnable. Se conduire par caprice consiste à osciller mécaniquement entre deux ou plusieurs
partis tout faits et à se fixer pourtant enfin sur l’un d’eux : ce n’est pas avoir mûri une situation intérieure, ce
n’est pas avoir évolué ; c’est, si paradoxale que cette assertion puisse paraître, avoir plié la volonté à imiter le
mécanisme de l’intelligence. Au contraire, une conduite vraiment nôtre est celle d’une volonté qui ne cherche
pas à contrefaire l’intelligence et qui, restant elle-même c’est-à-dire évoluant, aboutit par voie de maturation
graduelle à des actes que l’intelligence pourra résoudre indéfiniment en éléments intelligibles sans y arriver
complètement : l’acte libre est incommensurable avec l’idée, et sa « rationalité » doit se définir par cette

incommensurabilité même, qui permet d’y trouver autant d’intelligibilité qu’on voudra. Tel est le caractère de
notre évolution intérieure. Et tel est aussi, sans doute, celui de l’évolution de la vie.
48-49 raison « platonique »
Notre raison, incurablement présomptueuse, s’imagine posséder par droit de naissance ou par droit de
conquête, innés ou appris, tous les éléments essentiels de la connaissance de la vérité. Là même où elle avoue ne
pas connaître l’objet qu’on lui présente, elle croit que son ignorance porte seulement sur la question de savoir
quelle est celle de ses catégories anciennes qui convient à l’objet nouveau. Dans quel tiroir prêt à s’ouvrir le
ferons-nous rentrer ? De quel vêtement déjà coupé allons-nous l’habiller ? Est-il ceci, ou cela, ou autre chose ?
et »ceci » et « cela » et « autre chose » sont toujours pour nous du déjà conçu, du déjà connu. L’idée que nous
pourrions avoir à créer de toutes pièces, pour un objet nouveau, un nouveau concept, peut-être une nouvelle
méthode de penser, nous répugne profondément. L’histoire de la philosophie est là cependant, qui nous montre
l’éternel conflit des systèmes, l’impossibilité de faire entrer définitivement le réel dans ces vêtements de
confection que sont nos concepts tout faits, la nécessité de travailler sur mesure. Plutôt que d’en venir à cette
extrémité, notre raison aime mieux annoncer une fois pour toutes, avec une orgueilleuse modestie, qu’elle ne
connaîtra que du relatif et que l’absolu n’est pas de son ressort : cette déclaration lui permet d’appliquer sans
scrupule sa méthode habituelle de penser et, sous prétexte qu’elle ne touche pas à l’absolu, de trancher
absolument sur toutes choses. Platon fut le premier à ériger en théorie que connaître le réel consiste à lui trouver
une son Idée, c’est-à-dire à le faire entrer dans un cadre préexistant qui serait déjà à notre disposition, – comme
si nous possédions implicitement la science universelle. Mais cette croyance est naturelle à l’intelligence
humaine, toujours préoccupée de savoir sous quelle ancienne rubrique elle cataloguera n’importe quel objet
nouveau, et l’on pourrait dire, en un certain sens, que nous naissons tous platoniciens.
50-51 finalisme & harmonie
[La philosophie de la vie où nous nous acheminons] nous représentera le monde organisé comme un
ensemble harmonieux. Mais cette harmonie est loin d’être aussi parfaite qu’on l’a dit. Elle admet bien des
discordances, parce que chaque espèce, chaque individu même ne retient de l’impulsion globale de la vie qu’un
certain élan, et tend à utiliser cette énergie dans son intérêt propre ; en cela consiste l’adaptation. L’espèce et
l’individu ne pensent ainsi qu’à eux – d’où un conflit possible avec les autres formes de la vie. L’harmonie
n’existe donc pas en fait ; elle existe plutôt en droit : je veux dire que l’élan originel est un élan commun et que,
plus on remonte haut, plus les tendances diverses apparaissent comme complémentaires les unes des autres. Tel
le vent qui s’engouffre dans un carrefour se divise en courants d’air divergents, qui ne sont tous qu’un seul et
même souffle. L’harmonie, ou plutôt la « complémentarité », ne se révèle qu’en gros, dans les tendances plutôt
que dans les états. Surtout (et c’est le point sur lequel finalisme s’est le plus gravement trompé), l’harmonie se
trouverait plutôt en arrière qu’en avant. Elle tient à une identité d’impulsion et non pas à une aspiration
commune.
73-74 types de causes
Mais dans quel sens faut-il entendre [..] le mot cause ? Sans entreprendre une analyse exhaustive de
l’idée de causalité, nous ferons simplement remarquer que l’on confond d’ordinaire trois sens de ce terme qui
sont tout différents. Une cause peut agir par impulsion, par déclenchement ou par déroulement. […] En réalité,
c’est dans le premier cas seulement que la cause explique son effet ; dans les deux autres, l’effet est plus ou
moins donné par avance et l’antécédent invoqué en est – à des degrés divers, il est vrai – l’occasion plutôt que la
cause.
85 l’objet de la philo réunit les vues de la science
En soumettant […] les diverses formes actuelles de l’évolutionnisme à une commune épreuve, en
montrant qu’elles viennent toutes se heurter à une même insurmontable difficulté, nous n’avons nullement
l’intention de les renvoyer dos à dos. Chacune d’elles doit correspondre à un certain point de vue sur le
processus d’évolution. Peut-être faut-il d’ailleurs qu’une théorie se maintienne exclusivement à un point de vue
particulier pour qu’elle reste scientifique, c’est-à-dire pour qu’elle donne aux recherches de détails une direction
précise. Mais la réalité sur laquelle chacune de ces théories prend une vue partielle doit les dépasser toutes. Et
cette réalité est l’objet propre de la philosophie, laquelle n’est point astreinte à la précision de la science,
puisqu’elle ne vise aucune application.
90 la vie n’associe pas mais dissocie et dédouble
[le mécanisme] veut, lui aussi [avec le finalisme], que la nature ait travaillé comme l’ouvrier humain, en
assemblant des parties. Un simple coup d’œil jeté sur le développement d’un embryon lui eût pourtant montré
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%