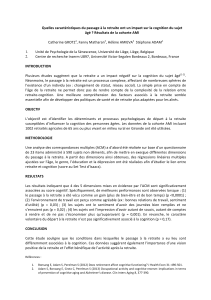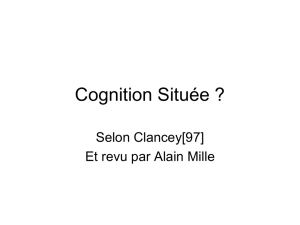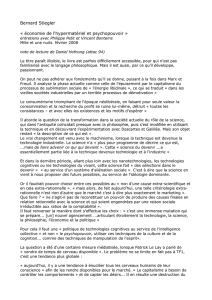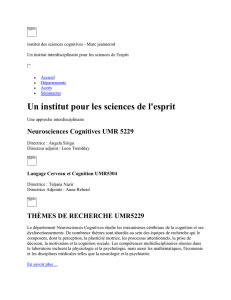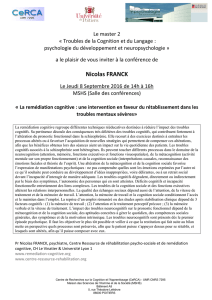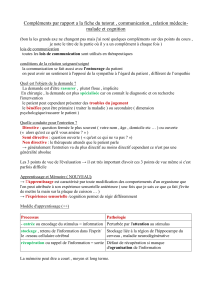Chapitre 1. Savoir

- p 1 -
Quel savoir pour l’éthique ?
Action, sagesse et cognition
Francisco Varela La Découverte/Poche Paris, 2004
Chapitre 1. Savoir-faire et savoirs
Exposé de la question
Je partirai du principe que l’éthique se rapproche plus de la sagesse que de la raison : il
s’agit de comprendre ce qu’est être bon plutôt que d’avoir un jugement correct dans une
situation particulière. Je ne suis pas seul à penser ainsi car il semble qu’aujourd’hui, dans une
large mesure, le point focal du débat se soit déplacé des questions méta-éthiques vers la
confrontation entre les tenants d’une moralité critique, détachée, fondée sur des principes qui
nous disent ce qui est juste, et les tenants d’une éthique fondée sur la mise en œuvre d’une
doctrine qui identifie le bien.
On peut voir dans ce débat une reprise de l’opposition classique entre Moralität et
Sittlichkeit. D’un côté, nous avons des penseurs de premier plan, héritiers de la tradition
kantienne du jugement moral, je pense à Jürgen Habermas ou à John Rawls. De l’autre côté,
dans la lignée de Hegel, nous avons un camp dont les représentants les plus éloquents sont des
philosophes, tel Charles Taylor qui énonce clairement la position contraire dans son Sources
of the Self
1
: « La philosophie morale contemporaine, surtout dans le monde anglophone, s’est
concentrée presque exclusivement sur la moralité, à tel point que certains des liens
fondamentaux que je veux décrire dans cet ouvrage sont incompréhensibles selon ses termes.
La philosophie morale a eu tendance à privilégier ce qu’il est juste de faire au détriment de ce
qu’il est bien d’être, à insister sur la définition du contenu de l’obligation plutôt que sur la
nature de la vie vertueuse. Par ailleurs, elle n’accorde aucun rôle conceptuel à la notion du
bien comme objet de notre amour ou de notre fidélité, ou […] comme centre privilégié de
notre attention ou de notre attachement1. »
Je tirerai abondamment parti de certaines contributions récentes de la phénoménologie
et du pragmatisme mais, en ce qui concerne les idées sur ce qu’il est bien d’être, je juge tout
aussi intéressant l’apport considérable de ce que j’appellerai la triade des traditions de
sagesse : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Entre autres choses, il s’agira pour
moi de mettre en lumière cet apport non occidental et d’adopter ainsi un point de vue
comparatif sur l’expérience éthique. J’y reviendrai plus en détail.
Pour commencer, et en restant approximatif, je dirai que l’individu sage (ou vertueux)
est celui qui sait ce qu’est le bien et qui le fait spontanément. C’est cette spontanéité de la
perception-action que nous devons examiner d’un point de vue critique, en prenant le contre-
pied de l’attitude habituelle face au comportement éthique, où l’on commence par étudier le
contenu intentionnel pour arriver à la rationalité des jugements moraux.
Cette distinction importante a néanmoins été occultée non seulement par les
philosophes et les savants qui se réclament de la pensée de Kant et de Husserl, mais aussi par
ceux qu’intéressent au premier chef les différents aspects de l’apprentissage et du
comportement. Jean Piaget, pour ne citer que lui, dit au début du Jugement moral chez
l’enfant : « C’est le jugement moral que nous nous sommes proposés d’étudier, et non les
conduites ou les sentiments moraux. » Dans les dernières pages du même ouvrage, on peut
lire ceci : « La logique est une morale de la pensée, comme la morale est une logique de
1
. Charles TAYLOR, Sources of the Self : The Making of the Modern Identity, Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 1989, p.3.

- p 2 -
l’action. […] C’est la raison pure qui commande à la fois la réflexion théorique et la vie
pratique […]. »
2
Nous devons cependant nous poser une question : pourquoi confondre le
comportement éthique et le jugement moral ? La réponse que la majorité des gens apportent à
cette question correspond au point de vue occidental orthodoxe, et non à ce qu’ils font dans la
vie quotidienne. Ce point est capital. Considérons une journée normale. Vous marchez
tranquillement dans la rue , en réfléchissant à ce que vous devez dire à une prochaine réunion.
Vous entendez le bruit d’un accident, ce qui vous incite immédiatement à voir si vous pouvez
être d’un quelconque secours. Ou bien, vous arrivez au bureau et, constatant l’embarras de
votre secrétaire sur un certain sujet, vous détournez la conversation par une remarque
humoristique. Les actes de ce type ne sont pas le fruit du jugement ou du raisonnement, mais
une aptitude à faire face immédiatement aux évènements. Tout ce que nous pouvons dire,
c’est que nous accomplissons ces gestes parce que les circonstances les ont déclenchés en
nous. Il s’agit pourtant de véritables actions éthiques ; en fait, elles représentent le type le plus
courant de comportement éthique dont nous faisons preuve dans la vie de tous les jours.
On a pourtant tendance à opposer ce type de comportement éthique ordinaire à la
situation où l’on éprouve un « je » central qui est la cause de l’action volontaire, délibérée.
Par exemple, en lisant dans le journal un article sur la guerre civile qui dévaste l’ex-
Yougoslavie, j’appelle un ami car je veux contribuer à une campagne de secours aux victimes.
Ou bien, inquiet des difficultés scolaires de mon enfant, je réfléchis à un mode d’action et je
prends la résolution d’être plus présent dans son travail. Dans ces situations, nous sentons que
l’action est « nôtre », nous pouvons en fournir la raison puisque nous espérons par elle
atteindre un but précis. Et si on nous le demandait, nous n’aurions aucun mal à nous justifier ;
en effet, il suffirait d’attribuer à notre comportement le but éminent que nous nous sommes
fixé.
Certes, notre conduite éthique et morale dépend en partie de ces jugements et de ces
justifications. Ce que je veux dire, c’est que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas passer
rapidement sur le premier type de comportement éthique ordinaire, sous prétexte qu’il tient
uniquement du « réflexe ». Pourquoi ne pas commencer par ce qui est ordinaire et voir où cela
nous mène ? Nous soulignerons donc ici la différence entre le savoir-faire et les savoirs, entre
la capacité à faire face immédiatement et la connaissance intentionnelle ou les jugements
rationnels
3
.
Les deux questions principales et corrélées que je veux étudier dans cet ouvrage sont
donc celles-ci :
1) De quelle manière faut-il comprendre le savoir-faire éthique ?
2) Comment s’élabore-t-il et se développe-t-il chez l’être humain ?
2
. Jean PIAGET, Le Jugement moral chez l’enfant, PUF, « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1932,
8ème éd. 1995, p.vii et p. 322. Ces passages sont cités par Hubert L. DREYFUS et Stuart DREYFUS, « Toward a
Phenomenology of Ethical Expertise », in J. OGILVY (éd.), Revisioning Philosophy, Suny Press, New York,
1991.
3
Cette observation capitale s’inspire surtout de mes idées sur le rôle central de la coordination sensori-motrice
dans la cognition (voir Humberto R. MATURANA et Francisco J. VARELA, The Tree of Knowledge, New
Science Library/Shambhala, Boston, 2ème éd. ; trad. Franç. François-Charles Jullien, avec la collab. D’Hélène
Trocmé-Fabre, L’Arbre de la connaissance : racines biologiques de la compréhension humaine, Addison-
Wesley France, 1994), ainsi que ma propre expérience dans les doctrines de sagesse exposées infra. J’ai toutefois
une grande dette à l’égard d’Hubert Dreyfus pour ses travaux récents sur la phénoménologie des aptitudes et leur
importance éthique. Voir Hubert L. DREYFUS et Stuart DREYFUS, « What is morality ? A phenomenological
account of the development of ethical expertise, in D. RASSMUNSSEN (éd.), Universalism versus
Communitarialism, MIT Press, Cambridge, Mass., 1990, et « Toward a Phenomenology of Ethical Expertise »,
in J. OGILVY (éd.), Revisioning Philosoph, op. cit. Dans les pages qui suivent, je me suis fortement inspire de
ces deux articles en ce qui concerne certaines citations philosophiques capitals choisies par Dreyfus.

- p 3 -
Le faire-face immédiat
et les sciences de la cognition
Pour répondre à la première question, il nous faut d’abord voir comment cette
méconnaissance du faire-face immédiat se traduit dans les sciences mêmes qui se consacrent à
l’étude de l’esprit et de la connaissance, je veux parler des sciences de la cognition.
Problèmes anciens, formes nouvelles
« Rationaliste », « cartésienne » ou « objectiviste » : ce sont là certains des qualificatifs
appliqués à la tradition dominante dont nous sommes imprégnés depuis les Temps modernes.
Pourtant, lorsqu’on réexamine la connaissance et la cognition, le meilleur qualificatif est, me
semble-t-il, abstraite : rien ne caractérise mieux les unités de connaissance jugées les plus
« naturelles ». C’est cette tendance à passer dans l’atmosphère raréfiée de ce qui est général et
formel, logique et bien défini, représenté et planifié, qui rend notre monde occidental si
familier.
Nous allons voir que des indices solides montrent, d’une part, que les disciplines
diverses que l’on regroupe sous le nom de sciences de la cognition acceptent peu à peu l’idée
que les choses ne se présentent pas du tout de cette façon, et, d’autre part, qu’un changement
paradigmatique ou épistémologique radical se développe rapidement. On trouve au cœur
même de cette opinion naissante la conviction que les connaissances sont essentiellement
concrètes, incarnées, vécues. La connaissance est contextualisée, et son unicité, son aspect
historique et son contexte ne sont pas un « bruit » qui couvre la compréhension de sa véritable
essence, à savoir celle d’une configuration abstraite. Le concret n’est pas une étape vers
quelque chose d’autre : c’est la manière dont nous arrivons et le lieu où nous demeurons.
Pour illustrer cette notion, le mieux serait peut être d’évoquer la transformation
progressive des idées dans le domaine très pragmatique de l’intelligence artificielle (IA).
Dans les trois premières décennies (1950-1980), la recherche étaient entièrement tributaire du
paradigme computationnaliste : la connaissance opère au moyen de règles de type logique et
grâce à la manipulation symbolique, idée qui trouve aujourd’hui sa concrétisation parfaite
dans les ordinateurs numériques. A l’origine, on essayait de résoudre des problèmes très
généraux, comme la traduction d’un langage naturel ou l’élaboration d’un programme
universel de résolution de problèmes. On considérait que ces expériences, où l’on essayait
d’égaler l’intelligence d’un expert de haut niveau, s’attaquaient aux vrais problèmes de la
cognition. Etant donné qu’elles échouaient régulièrement, la seule façon de progresser était
d’être moins ambitieux : en effet, les tâches les plus ordinaires, même celles qu’accomplissent
des insectes minuscules, sont tout simplement impossibles à reproduire au moyen de
stratégies informatiques. En fin de compte, on est arrivé progressivement à la conclusion que
la clé du succès en IA consistait à comprendre ce que l’incarnation contextualisée des actes
simples signifie réellement.
4
Durant toutes ces années, en fait, des lignes de recherche fondatrices ont résolument
adopté l’idée qu’il fallait comprendre la cognition en fonction de la manière dont la
signification naît de ce tout autonome qu’est l’organisme. C’est là que nous retrouvons Jean
Piaget, à qui l’on doit une indication fondamentale sur la manière de transformer cette
hypothèse en axe de recherche fécond : étudier la constitution d’un objet de la perception à
travers l’ontogenèse, étudier la manière dont les enfants façonnent leur monde grâce aux actes
4 . Pour un recueil d’articles traitant expressément de cette critique, voir L. STEELS and R. BROOKS (eds.),
The Artificial Life Route to Artificial Intelligence : Building Embodied, Situated Agents, LEA, Hillsdale, N.
Jersey, 1995 et ma propre contribution dans ce recueil.

- p 4 -
sensori-moteurs. La nouveauté indiscutable de cette thèse, c’est que la cognition –même dans
ce qui semble ses manifestations d’ordre supérieur – est fondée sur l’activité concrète de tout
l’organisme, c’est à dire sur le couplage sensori-moteur. Le monde n’est pas quelque chose
qui nous est donné : c’est une chose à laquelle nous prenons part en fonction de notre manière
de bouger, de toucher, de respirer et de manger. C’est ce que j’appelle la cognition en tant
qu’énaction, car l’énaction connote cette production par la manipulation concrète. J vais
maintenant expliquer cette notion.
Micromondes et micro-identités
Imaginez que vous marchiez dans la rue, peut être pour aller à un rendez-vous. C’est la
fin de la journée et vous ne pensez à rien de particulier. Vous êtes détendu, dans ce que nous
pouvons appeler la disponibilité d’esprit du simple promeneur. Vous mettez la main à la
poche et vous découvrez soudain que votre portefeuille n’est pas là où il se trouve
habituellement. Rupture : vous vous arrêtez, vous êtes perturbé, votre tonalité émotionnelle
change. Avant que vous n’ayez le temps de vous en apercevoir, un nouveau monde surgit :
vous voyez clairement que vous avez laissé votre portefeuille dans le magasin où vous venez
d’acheter des cigarettes. Votre état d’esprit se mue en inquiétude d’avoir perdu des documents
et de l’argent, votre disposition à agir vous fait revenir rapidement au magasin. Vous faites
peu attention aux arbres et aux passants ; vous veillez uniquement à ne pas perdre de temps.
Notre vie est faite de ce type de situations, qu’il s’agisse des situations les plus
banales, comme celle que je viens de décrire, ou des attitudes éthiques plus intéressantes que
j’ai évoqué plus haut. Nous fonctionnons toujours dans l’urgence d’une situation donnée : le
monde où nous vivons est si présent que nous ne réfléchissons pas à ce qu’il est ni à la
manière dont nous l’habitons. Lorsque nous nous asseyons à table avec un parent ou un ami,
nous disposons immédiatement de tout un savoir-faire complexe – manipulation des couverts,
position du corps, pauses dans la conversation – sans avoir à réfléchir. Nous pourrions dire
que notre moi-déjeunant est transparent
5
. Nous finissons de déjeuner, nous retournons au
bureau et nous entrons dans un nouvel état d’esprit, avec un mode de conversation différent,
des postures différentes et des jugements différents.
Nous avons une disposition à agir pour chacune des situations spécifiques vécues. Les
nouveaux comportements et les transitions, ou les ponctuations, qui les articulent
correspondent à des microruptures que nous vivons continuellement. Parfois, les ruptures ne
sont pas vraiment « micro », mais d’ordre macroscopique, comme lorsqu’un choc soudain ou
un danger surviennent.
Je désignerai ces types de disposition à agir sous le nom de micro-identités avec leurs
micromondes correspondants. Ainsi la manière dont nous nous manifestons est indissociable
de la manière dont les choses et autrui nous apparaissent. Nous pourrions nous lancer
maintenant dans un peu de phénoménologie et identifier certains des micromondes typiques
dans lesquels nous vivons au cours d’une journée normale. Cependant, l’important n’est pas
d’en dresser le catalogue mais de remarquer leur récurrence : d’une certaine manière, c’est en
étant capable d’agir comme il convient que nous incarnons un flux de transitions récurrentes
entre des micromondes. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de situations où la récurrence
ne s’applique pas. Ainsi, lorsque nous allons pour la première fois dans un pays étranger, il y
a une absence très nette de disposition à agir et de micromondes récurrents. Beaucoup
d’activités simples, comme converser ou manger, doivent être accomplies de manière
réfléchie, voire entièrement apprises. En d’autres termes, les micromondes/micro-identités
5
. La notion de transparence est longuement développée dans un ouvrage non publié de F. FLORES et M.
GRAVES (Logonet, Berkeley, 1990). Je remercie F. Flores de m’avoir permis de lire cette œuvre en cours. J’en
ai tiré un grand profit pour mon argumentation.

- p 5 -
sont historiquement constitués. Cependant, la vie quotidienne, ordinaire est faite de ces
micromondes déjà constitués qui composent notre identité.
Si nous quittons le domaine de l’expérience humaine pour nous tourner vers celui des
animaux, nous pouvons appliquer le même type d’analyse au niveau comportemental. Un cas
extrême est instructif : les biologistes savent depuis un certain temps que les invertébrés ont
un répertoire de comportements succinct. Le cafard, par exemple, n’a que quelques modes
fondamentaux de locomotion : marche lente, marche rapide, course. Néanmoins, ce répertoire
comportemental élémentaire lui permet de se déplacer convenablement dans n’importe quel
environnement connu de la planète, qu’il soit naturel ou artificiel. Pour le biologiste, la
question fondamentale est donc celle-ci : comment l’animal décide-t-il du mode de
locomotion à adopter dans des circonstances données ? Comment se fait la sélection
comportementale pour que l’action soit la bonne ? Comment l’animal a-t-il le sens commun
d’évaluer une situation donnée et de l’interpréter comme une situation où il doit courir et non
marcher lentement ?
Dans ces deux cas très différents – l’expérience humaine durant une rupture et le
comportement simple de l’animal lors de la transition entre deux comportements -, nous
avons affaire, sur un plan certes très différent, à un problème commun. A chacun de ces points
de rupture , ce que l’agent cognitif sera ensuite n’est pas décidé extérieurement ni
prédéterminé. Il ‘agit d’une émergence de sens commun, de configurations autonomes d’une
attitude appropriée crée par tout le vécu de l’agent. Dès qu’un comportement a été choisi ou
que l’on fait surgir un micromonde, il est possible de mieux analyser son mode d’opération et
sa stratégie optimale. Il se trouve que la clé de l’autonomie réside dans le fait qu’un système
vivant trouve le chemin approprié vers le moment suivant, en utilisant ses ressources pour agir
comme il convient. Et ce sont les ruptures, les charnières qui articulent les micromondes, qui
sont la source de l’autonomie et de la créativité dans la cognition vivante. Il faut donc
examiner ce sens commun sur une micro-échelle, car c’est pendant les ruptures que la
naissance du concret a lieu.
La connaissance comme énaction
J’aimerai éclaircir ces questions en expliquant plus en détail ce que j’entends par le
mot « incarné ». A cet effet, j’insisterai sur les deux points : 1) la cognition dépend des
expériences qu’implique le fait d’avoir un corps doté de différentes capacités sensori-
motrices ; 2) ces capacités s’inscrivent dans un contexte biologique et culturel plus large.
Ces deux points ont déjà été esquissés plus haut lorsque j’ai parlé de la rupture et du
sens commun, mais j’aimerai étudier plus en détail leur spécificité corporelle, et souligner une
fois encore que, dans la cognition vécue, les processus sensoriels et moteurs, la perception et
l’action, sont fondamentalement inséparables et qu’ils ne sont pas simplement liés de manière
contingente comme des couples entrée-sortie.
Afin de préciser ma pensée, je vais expliquer d’abord ce que j’entends par approche
énactive de la cognition
6
. En quelques mots, l’approche énactive insiste sur deux notions
corrélées : 1) la perception consiste en actions guidées par la perception ; 2) les structures
cognitives émergent des schémas sensori-moteurs récurrents qui permettent à l’action d’être
guidée par la perception. Ces deux notions deviendrons de plus en plus claires au fur et à
mesure que nous avancerons.
Commençons par la notion d’action guidée par la perception. Lorsqu’il s’agit de
comprendre la perception, le courant computationnaliste dominant prend habituellement un
6
. Voir Francisco J. VARELA, Connaître : les sciences cognitives, Seuil, Paris, 1989 ; Francisco J. VARELA,
Evan THOMPSON et Eleanor ROSCH, The Embodied Mind : Cognitive Science and Human Experience (trad.
Franç. L’Inscription corporelle de l’esprit : sciences cognitives et expérience humaine), op. cit.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%