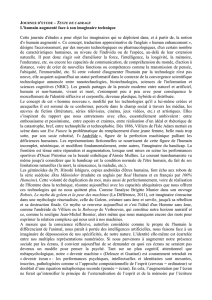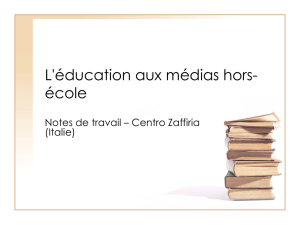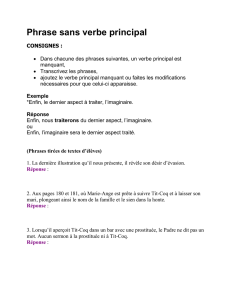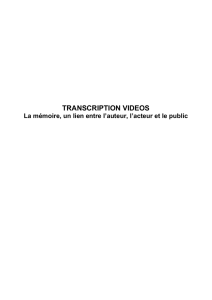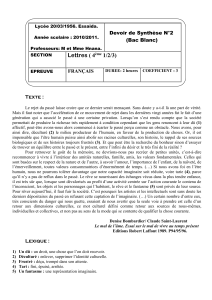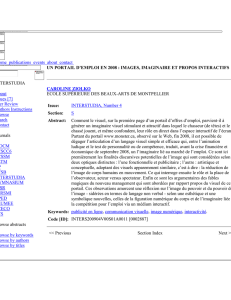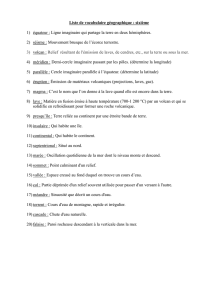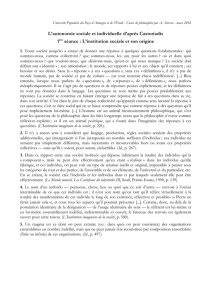Cours du 06 Mai 2010. 2h La psychologie sociale clinique. A) Du

Cours du 06 Mai 2010. 2h
La psychologie sociale clinique.
A) Du groupe au collectif
Du « je » au « nous »
L’objet premier de la psychologie sociale est le sujet en situation sociale, celui qui se trouve
confronté aux autres (au pluriel) et aux situations (structures et dynamiques), dont il est à la
fois initiateur, acteur et produit.
Une psychologie sociale clinique peut se définir comme l’analyse des processus par lesquels
le sujet en situation sociale donne sens à son expérience. En parler en termes de relation à
l’autre ne suffit pas, il ne s’agit pas seulement du trio « je, tu, il » qui au-delà de la relation
duelle, n’a rien de social et nous ramène au fameux triangle et à une problématique
oedipienne à dimension inéluctablement sexuelle et familiale. La relation aux autres, c’est
l’inscription réussie ou ratée, en tout cas conflictuelle, dans le « nous », lequel relève de
l’unité sociale (société, organisation, groupe).
La psychologie sociale ne se réduit pas aux interactions entre individus ni à un inter
psychique, différencié de l’intrapsychique mais ne faisant appel qu’à la figure de l’autre au
singulier, symbolique ou imaginaire. La psychologie sociale n’est pas seulement une
extension de la psychologie individuelle qui étudierait l’individu ou même le sujet dans ses
représentations ou les comportements suscités par la présence de ses semblables.
« Je » sujet narcissique
Sujet d’énonciation, en proie au manque, aux tensions du désir et aux angoisses, qui le
divisent, le sujet individualisé, qui dit « je » est narcissique, largement imaginaire – mais pas
seulement puisqu’il a une réalité organique-, englué dans les représentations, il réclame de la
satisfaction, il hait les autres susceptibles de le priver de la jouissance et d’existence, cela se
traduit par la revendication et la compétition sous couvert de justice, dignité, liberté, sécurité,
et peut aboutir à la violence (constat qui peut être fait dans la clinique du travail). En même
temps, il veut être aimé et reconnu, il a un besoin incoercible d’être au milieu des semblables
et d’être aidé par eux sous couvert de solidarité, de fraternité et de coopération. Les deux
tendances se mêlent comme Eros et Thanatos qui se retrouvent dans l’entremêlement d’une
sorte de pulsion « sociale » (je veux dire ici qui vise les autres) ambivalente.
Il persévère à dire « je », toujours lésé, frustré, exigeant, requérant. Tantôt le « nous » de ses
unités d’appartenance porte ses revendications, tantôt il les écrase. Le « nous » oblige à la fois
à faire le deuil du « je » et le conforte en le dilatant à la mesure du groupe dans lequel il vient
se fondre. Double mouvement qui porte le sujet de la dépendance fusionnelle à la violence
destructrice, entre les deux on peut lire toutes les formes possibles du pouvoir, de la
coopération consentie à la tyrannie totalitaire.
« Nous » sujet social
La solidarité des semblables que l’on trouve dans la plupart des espèces animales, donnant
lieu à des partages d’information et à des comportements de protection, est sans doute à la
base du lien social, mais se manifeste chez l’humain à travers des dynamiques et des modes
de structuration très variés, construits : pacifiques ou agressifs, souples ou rigides.
Ainsi, la psychologie sociale a affaire non seulement au sujet dans son expérience des
situations sociales, mais aussi à ce sujet improbable appelé le « sujet social », celui qui
prétend s’énoncer à la première personne du pluriel, « Nous », qu’il ne suffit pas de tenir pour
la somme des individus qui s’y reconnaissent. C’est un « sujet pluriel » où chaque individu

reste un élément autonome tout en faisant partie du tout, reflet de l’ensemble. Il est dans
l’incapacité de constituer définitivement l’unité cohérente et cohésive à laquelle il prétend
(société, groupe institué, équipe), toujours déchiré par sa propre diversité, faite de différences
et de divergences, rêvant d’une unanimité impossible, condamné pour atteindre les buts
nécessaires à sa survie comme à celle des individus qui le composent, à laisser usurper sa
parole, son énonciation, c'est-à-dire le pouvoir.
Dans les interactions propres à la vie en société se pose tout de suite la question du pouvoir,
de la gestion des relations pour la coopération. Le sujet social, pluriel, est dans une double
tension : pour participer de l’identité unifiante de l’ensemble et pour faire valoir la singularité
des identités de chaque membre. Il est ainsi voué à une triple aliénation : celle de chacun dans
sa névrose, puis dans l’unité d’ensemble, celle de l’unité fictive obligée de laisser usurper la
parole par des « porte-parole ». C’est l’ouverture sur les jeux et stratégies, les politiques,
l’ouverture justement sur le questionnement politique : des légitimés du pouvoir, des modes
de gestion du collectif, des problèmes d’autorité et de places respectives, des modes de
complémentarité. Les positions sont induites par les représentations liées à l’histoire du sujet
et à son organisation personnelle (scénarios fantasmatiques, défenses, indentifications et
projections), mais aussi issues de la réalité des situations dans lesquelles il se trouve et, enfin
des systèmes culturels imaginaires et symboliques dont il est imprégné ou qui sont à sa
disposition. La perspective purement intrapsychique ne suffit plus à analyser les dynamiques
et les processus.
La particularité du sujet social est de n’être définitivement que symbolique et imaginaire.
Certes le sujet narcissique, n’est qu’imaginairement unifié, il est divisé, mais il a un corps
pour s’incarner, une unité organique pour donner une matérialité à son unité, s’exprimer de sa
seule voix, quitte à nier sa division réelle. Le « nous » reste symbolique (il peut s’instituer) et
imaginaire (identifications et projections), même s’il peut se contempler dans ses productions,
celle-ci sont métaphoriques, reflet de son unité, matérielles mais images de celle-ci. Le
« nous » souffre de l’impossibilité radicale d’une unanimité (d’une même voix, d’une même
bouche). Il reste le lieu de tiraillement entre chaque moi et les autres, leur cortège de
différences, diversités et divergences. « Le peuple : une entité, un agrégat d’individus aux
aspirations différentes, opposées. Personne n’est peuple, cette entité sans unité. . »
Peut-on parler d’une rupture de logique dans le passage du « Je » au « Nous » ? Le « Nous »
dépossède le « Je » mais l’enrichit, le précipite mais l’entraîne. Ce que le « Nous » introduit
de nouveau (de rupture), c’est la dimension stratégique et politique :
Stratégique : le jeu (mobilité) des positions réciproques, leur maniement autour des
enjeux, des mises et des gains ou pertes, le déchiffrement des motivations et intentions
de l’adversaire, de l’allié, des dominants et des subordonnés dans les dimensions
subjectives, sociales et matérielles.
Politique : la problématique du pouvoir dans ses dimensions imaginaires, symboliques,
mais aussi matérielles (de réalité) par lesquelles ‘organise la coopération.
Le sujet social est en proie au conflit, pas seulement sur le mode œdipien, même si celui-là est
sous-jacent. Il s’agit surtout d’établir les critères selon lesquels les places sont prises ou
attribuées, étant que nous sommes dans l’horizontalité du social et non dans la verticalité
familiale ou les places et les interdits sont déterminés par le sexe et l’ordre des générations.
Le sujet social est voué au conflit du pouvoir comme à l’invention des formes du lien.
L’ambivalence des pulsions s’exerce dans le champs social de la relation aux autres : besoin
d’identité assurée par les appartenances, nécessité de coopération, solidarité viscérale devant
l’adversité, identifications et dépendances, mais aussi peur et haine. Alternances entre
extrêmes : fusion amoureuse et violence haineuse.

Le lien social (cause et effet) permet d’échanger (entre différents suffisamment semblables
pour qu’il y ait au moins accord à un moment) pour une praxis qui suppose communauté de
buts, continuité dans le temps, mais aussi division de l’acte, affectation de résultats. Ces
contradictions se dépassent par nécessité grâce à une socialité existentielle et biologique et
grâce à l’organisation et au contrôle exercé à travers les diverses formes du pouvoir, qui
engendrent frustrations et violences plus ou moins grandes suivant les formes (aucune ne les
évite). Cette dynamique est sans cesse renouvelée. Le sujet social est constitué d’un certain
nombre d’individus réunis dans un espace-temps structuré, voire institué, pour une pratique
orientée par des objectifs communs, pouvant, au-delà, partager une culture, une histoire, des
valeurs, des projets qui lui confèrent une unité identitaire. Il est constitué d’individus se
reconnaissants solidaires dans un même destin, de mêmes fins, une même praxis
(transformation de la réalité).
Le sentiment de reconnaissance coïncide avec l’expérience des individus d’être semblables et
accueillis dans la singularité. Le sujet peut se définir par son aptitude et son aspiration à
élaborer et à énoncer le sens qu’il veut donner à sa trajectoire (histoire, actualisations,
projets), les membres d’une unité sociale sont également associés pour procéder à la
construction du sens qui rende compte du projet commun.
A l’occasion du pouvoir se pose le problème du leader, meneur ou chef : est-il ce qui
condense le « Nous » grâce à son « moi fort et indépendant », son charisme, et qui, par le jeu
des identifications, ramasse la mise des énergies libres et des émotions flottantes, ou est-il
suscité par le collectif qui cherche un support, un représentant, une figure, une incarnation
pour ses élans narcissiques et pour abriter ses pulsions inavouables (ce peut-être alors le plus
fragile, comme le pense Bion pour les groupes), ou encore pour s’organiser de façon
constructive, y compris dans la « servitude volontaire » ? Ou faut-il considérer qu’il y a deux :
une rencontre d’une figure concrète avec des aspirations à l’état encore imaginaire qui
aboutissent en une condensation symbolique où, surenchérissant sur le transfert, la figure
endosse (responsabilité, autorité) ce dont elle est investie et l’énonce (discourt législateur) ?
La personne centrale n’est pas toujours nécessaire. Il y a des unissons (impératif du verbe
unir !) qui reposent sur une identification latérale dans un même destin de persécuté, sans
chef ; on peut en reconnaître une dans l’expression « Nous les petits ». Au lieu de l’amour
d’un leader qui déclenche le processus d’identification de l’idéal du moi…(être aimé de lui
qui aime d’un amour égal), c’est un vécu d’abandon (absence de chef qui aime, d’amour et de
protection) qui soude par identification latérale. Le « Nous » exprime les frères qui se
reconnaissent dans la misère, dans un même destin malheureux. C’est ce « nous » qui se
retrouve dans les réunions d’anciens combattants. On peut donc avoir une solidarité par
absence et manque, non par présence d’un leader. Celui-ci peut venir secondairement donner
encore plus de liant, voire d’élan et de structure centralisatrice, enfin un discourt fédérateur.
Quelles sont les voies de résolution dans ce nœud de conflit-compromis-complémentarité
permanent et nécessaire ? Dans les sociétés les différents régimes politiques, dans les
entreprises les différents modes de gestion et de management sont autant de traitements du
dilemme.
Dans l’entreprise parfois aujourd’hui, l’efficience (urgence, organisation et rentabilité) prime
sur le sens, donc ce sont l’autorité et l’intériorisation de normes et d’objectifs proposés de
l’extérieur (contraintes de la réalité de la production économique) qui sont privilégiées.
D’autre part, quelles ne sont pas les tragédies qu’engendrent les crises de l’unité sociale,
fragilisant les identités qu’elles n’étayent plus, en livrant les individus au désarroi et à la
violence ?
La société moderne navigue entre un individualisme, véritable culte du sujet, la prééminence
du désir et de l’exhortation à l’adhésion solidaire (à la cité, à l’entreprise) à des unités
sociales (identifications sollicitées, propositions d’images identitaires) contredites par la

volatilité et la flexibilité de l’emploi. C’est plutôt là que sont les ruptures logiques, en forme
de double (triple) bind : « Soyez autonomes, soyez attachés, soyez flexibles. »
Comment garantir, en même temps, les « Je » et le « Nous » ? Comment ne pas asservir le
« Nous » dans les entraves du pouvoir ? Où est le pouvoir légitime, au sein du collectif ou
dans les mains du représentant lieu-tenant ?
La solution passe sans doute essentiellement par la garantie de la parole, c’est-à-dire le débat,
l’expression des conflits, régulée. Encore faut-il en avoir le temps !
On aborde là les problématiques contradictoires du sens et de l’efficience : privilégier la
parole, l’expression relative à l’expérience ou répondre aux exigences de la production et de
la rentabilité inscrites dans l’urgence ?
L’imaginaire collectif assure une suffisante cohérence et sous-tend les projets, les objectifs,
les volontés d’agir, les conduites professionnelles. En tant qu’il est discriminant, le système
imaginaire est aussi une disposition qui va permettre l’action. Il est ce à partir de quoi le
groupe détermine ses conduites et oriente sa praxis. Il conditionne des représentations
secondaires et permet aux membres de s’y reconnaître.
La faillite de l’imaginaire collectif
Il y a crise lorsque les transformations sociales font entrer de nouvelles significations qui
viennent faire effraction dans les constructions collectives antérieures ; lorsqu’elles
introduisent en particulier, de façon brutale, des contenus déniés, contenus qui devaient
précisément se trouver exclus du champ représentatif dans la constitution de l’unité qui font
brutalement retour, opérant un travail de déliaison. La crise révèle alors le caractère
imaginaire de l’unité qui tenait à la nécessité de laisser dans l’ombre des éléments de réalité et
leurs significations externes ou internes dont la prise en compte se révèle menaçante pour la
construction groupale. Ces bouleversements remettent en question la qualité des systèmes
défensifs érigés par les groupes pour préserver une certaine cohérence et une suffisante
cohésion. L’unité se fondait sur un pacte dénégatif (R. Kaës, 1989) dont les fonctions
structurantes et dynamiques éclatent et dont la fonction défensive devient inopérante. Les
éléments déclencheurs font ainsi ressurgir la violence qui était refoulée dans la construction
imaginaire du groupe. En attaquant les fonctions organisatrices et défensives, ce sont les
contenants, les liens et l’espace de créativité qui sont touchés.
Ainsi la construction du groupe tient-elle avant tout de la qualité de l’investissement d’un
objet commun en vertu de quoi les perceptions, les représentations ne peuvent être autrement
ou autre chose que ce qu’elles sont. Ces dernières, sur lesquelles repose la construction
collective, excluent les représentations ou réalités qui viendraient les contredire, celles qui,
extérieures à leur champ, sont l’envers constructif, son négatif. La fonction de l’imaginaire
collectif est ainsi de fournir, par la création de ce scénario partagé, une réponse adaptive dans
les organisations. L’interaction entre psyché et société est saisie à différents niveaux :
l’institution et l’organisation comme structure d’appel imaginaire ; l’individu comme
organisation affective mobilisable dans ses différentes composantes ; le groupe comme
création d’images communes.
B) Le groupe : un lieu pour être en relation avec soi et les autres
L’attrait du négatif ou la tendance à disqualifier
L’autre et ce qu’il représente
Pour chacun, autrui joue toujours le rôle d’un modèle, d’un idéal ou d’une référence
identificatoire positive, d’un allié, d’un associé ou d’un protecteur. Autrui peut représenter un
rival, un concurrent, un adversaire, un ennemi, un persécuteur, un supérieur, un inférieur, un
égal. Il peut être à la place du prédécesseur, d’un successeur, d’un contemporain. A moins

qu’autrui ne joue à nos yeux le rôle d’un procureur ou d’un juge, d’un tyran, d’un maître
dominateur ou qu’on le conçoive comme être à assujettir. Autrui peut représenter un « objet »
d’amour, de haine, d’estime, d’admiration. Par rapport à une propriété, une qualité, un statut
dont il est détenteur, autrui peut être objet d’envie ; par rapport à un tiers, il peut être objet de
jalousie.
Fondamentalement, autrui est un être en trop, dès que sa présence oblige au partage de l’objet
que le sujet veut être le seul à connaître ou retrouver, pour en conserver l’exclusivité, lorsqu’il
ne sait jouir que par celle-ci.
Enfin, cet autre peut représenter ce que l’on voudrait être et devenir ou ce que l’on veut avoir.
Or, comme cet autre-là, ce grand Autre, hors des états d’extase, d’aveuglement amoureux ou
de délire messianique, n’existe pas, l’autre réel est forcément décevant.
Problématique de l’être et de l’avoir et rapport au pouvoir
Il y a ceux qui vivent plutôt selon la problématique de l’être et qui assument, sans se sentir
amoindris, les différences de sexe, d’âge, de génération, de statut social, de savoir théorique
ou de compétence active. Pour ceux-là, le travail de confrontation à l’altérité, de transmission
et d’apprentissage est stimulant ; vivre et grandir en valent la peine.
Il y a ceux qui vivent selon la problématique de l’avoir et qui ressentent toute différence
comme incompréhensible et injuste, car ils se conçoivent comme grands avant d’avoir grandi.
Pour ceux-là, celui qui a quelque chose qu’ils n’ont pas ne peut l’avoir acquis que par la ruse
et ne le détient que par vol ou recel.
Pour ceux-là, l’autre n’est pas, il n’est que par l’objet détenu et réifié. Dès lors, le vol et la
spoliation sont permis. Ceux-là fonctionnent sur le fantasme d’une toute puissance imaginaire
de l’autre acquise par le seul recel de l’objet. Ainsi fabriqué, l’autre est intéressant, puisqu’en
le spoliant ou le dévorant on peut fantasmatiquement s’approprier ses qualités et être à son
tour un nanti. Pour atteindre ce but, il suffit d’organiser un lynchage, puis un repas totémique,
sans scrupule, car l’objet, bien que convoité, est curieusement réduit à une chose sans
importance en même temps que l’on dépouille de son humanité celui que l’on assimile à un
simple conteneur de l’objet. Dans cette conception, où l’autre est réduit à un rapport de
détention de l’objet sans qualité en soi, ce qui est important, c’est que l’autre n’ait pas,
puisque, bien sûr, l’objet est inaccessible dans la seule logique psychique de l’avoir. Apaiser,
très provisoirement, le manque à être est permis en retirant à l’objet et à autrui toute qualité.
Pour se donner l’illusion d’être plus, il suffit que l’autre soit moins. Nous sommes là en pleine
destructivité. C’est pourquoi l’interdit anthropophagique et de tuer ainsi que celui de l’inceste
sont au fondement de la société et de l’Etat de droit.
L’autorité, le pouvoir, la parole, font partie de ces « objets » fortement convoités. N’entend-
on pas dire couramment dans les groupes « prendre le Pouvoir » ou « prendre la Parole », ou
« prendre la Place de » comme si exercer une influence, tenir un discourt, s’asseoir sur un
fauteuil ou parler dans un groupe, étaient prendre la chose à quelqu’un qui en aurait depuis
toujours l’exclusivité ? C’est comme si l’on ne pouvait pas prendre simplement un pouvoir, le
sien, une parole ou une place, la sienne, ou comme s’il n’y avait jamais nulle part de place
pour plus d’un.
Il s’agit là de deux logiques psychologiques hétéronomes : celle de l’être et de l’effort pour
apprendre par un véritable travail psychique et culturel de transformation ou d’altération
personnelle et d’échange et celle radicalement différente du prendre et de l’avoir, où l’on
accumule sans se transformer, sans donner en retour, où l’on ne doit rien à personne, où l’on
ne fait que stocker en soi des enveloppes vides, prendre des apparences censées conduire au
prestige, parce que l’on ne peut rien contenir, quoi que l’on mette dedans.
La théorie d l’unicité de la place sociale enviable
 6
6
 7
7
1
/
7
100%