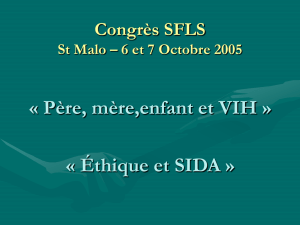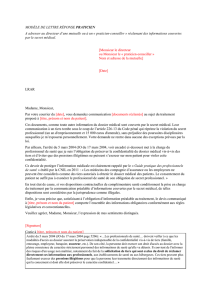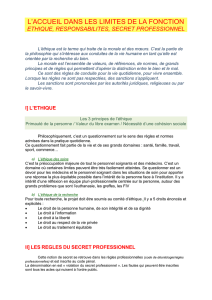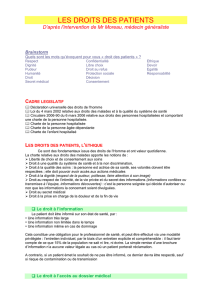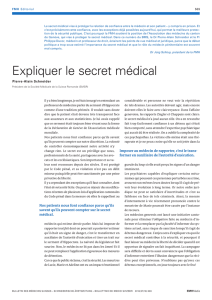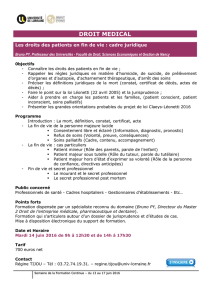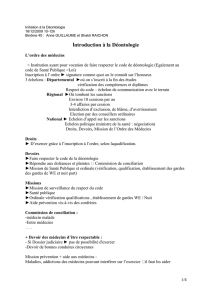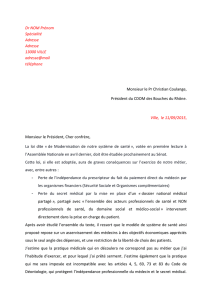SecretMédicalItinér0711

1
Le secret médical a pour but de préserver les intérêts du patient, ce dernier
en est le maître et doit le rester
Enjeux actuels
Dr Jean Martin
Les principes et la loi
La confidentialité est depuis Hippocrate et son Serment (dont on relèvera en passant qu’il est
une référence déontologique mais n’a pas de statut officiel en Suisse) un principe majeur de
l’activité médicale et de soins. Son importance est manifestée par le fait que, dans les pays à
système juridique d’inspiration française, il est inscrit dans le code pénal (article 321 du Code
suisse) et que son non-respect est punissable en conséquence ; dans les régimes anglo-saxons,
son statut juridique est nettement plus faible voire flou.
Le secret médical a pour but essentiel de protéger le patient de la curiosité indue de tiers. Le
professionnel (ceci s’applique aux médecins, pharmaciens et à tous « leurs auxiliaires » - c’est
le terme du code, qui peut aujourd’hui être ressenti comme péjoratif…) n’est délié du secret -
et donc peut parler à d’autres - que si l’une des conditions suivantes est remplie :
- le patient donne son accord à la transmission - c’est la règle d’or,
- une disposition légale l’oblige à parler/annoncer (cas de certaines maladies
infectieuses) ou lui en donne la faculté, s’il l’estime utile (sans avoir à demander
l’accord du patient)
- dans des cas où le professionnel juge devoir transmettre une information mais que le
patient n’est pas d’accord ou pas en mesure de se déterminer, le médecin peut être
délié par une autorité désignée dans chaque canton (on passe généralement par le
médecin cantonal).
A noter, chose qui surprend parfois, que le médecin - ou autre intervenant concerné - n’est pas
du tout automatiquement délié vis-à-vis des proches, sauf dans le cas des enfants où il doit
informer les parents ou représentants légaux. Il convient de se souvenir que les intérêts de ces
proches peuvent diverger de ceux du patient, voire être en conflit… Faire usage de la « règle
d’or » : demander son accord au patient.
Formule à retenir : « Le patient est le maître du secret médical, le médecin en est le
dépositaire ». Ce principe n’a pas toujours été observé dans les générations précédentes, où le
médecin jugeait souvent (arbitrairement…) de ce qu’il disait au patient et/ou aux proches,
tendant à penser qu’il savait mieux que le malade lui-même ce qui était bon pour lui. Avec
l’émergence, et l’inscription dans les lois des droits des patients, on a vu depuis 25 ans
environ un changement de paradigme dans les relations entre soignés et soignants. Y compris
avec l’accès libre du malade à son dossier médical. Intéressant de savoir que, pour marquer
cette primauté du patient, nos compatriotes alémaniques parlent du « secret du patient »
(Patientengeheimnis), plutôt que de secret médical.
Récemment, des questions difficiles posées autour du secret médical

2
Ce secret reste-t-il d’actualité ? Bien entendu : le patient doit pouvoir compte sur le fait que le
thérapeute garde strictement pour lui et dans son dossier les informations sur ce qui se passe
et est dit dans la consultation (dans le colloque singulier, rencontre entre une confiance, une
science et une conscience, selon une formule française). Toutefois, des questions délicates ont
été posées, par exemple au moment de l’émergence du virus VIH et du sida dans les années
1980. La médecine ne disposait d’aucun traitement et le virus se transmettait par des
comportements très privés (relations sexuelles spécialement, cas échéant clandestines). Le
praticien était confronté à un dilemme quand consultait le membre séropositif d’un couple et
que se marquait, à l’évidence, un besoin d’avertir le partenaire, menacé dans sa santé et sa vie.
Néanmoins, la médecine française a continué à suivre une doctrine stricte (absolue ?) du
secret, refusant d’envisager l’information du partenaire alors que, en Suisse, la position
déontologique a été que, s’agissant d’un couple stable (où on a en principe le droit d’attendre
la fidélité de l’autre), il fallait faire en sorte que le conjoint soit informé.
Des cas difficiles émergent avec les avancées de la biomédecine, en particulier de la
génétique. Par exemple, la maladie de Huntington est une affection héréditaire entraînant une
démence précoce dans la quarantaine, menant à la mort et pour laquelle n’existe aucun
traitement. Or, on peut aujourd’hui savoir dès l’enfance si on est porteur du gène responsable.
Il y a d’abord, hors secret médical, une première question éthique : convient-il de proposer ce
test à un jeune pour, en cas de résultat positif (gène malade), faire peser sur lui le poids d’une
« condamnation » à une mort ultérieure dans des circonstances pitoyables ? Cela demande un
conseil génétique approfondi et sensible, où la décision est prise totalement librement par la
personne. Où le secret médical intervient, c’est vis-à-vis des enfants d’une personne testée et
trouvée positive. Devraient-ils être avertis du fait que leur père ou mère va présenter une telle
démence et peut leur avoir transmis le gène en cause, qui mènerait plus tard chez eux à la
maladie qu’ils pourront eux-mêmes transmettre ensuite. La personne trouvée positive peut
donc légitimement refuser qu’une telle information soit donnée à d’autres mais on voit que
cela pose de graves questions. Interrogation comparable s’agissant d’un(e) fiancé(e).
D’autres situations sont de plus en plus présentes, en rapport aussi avec les avancées des
moyens d’investigation de la médecine. Ainsi, les employeurs ont un intérêt (légitime en soi)
à disposer de collaborateurs en bonne santé. Ont-ils un droit à l’accès à des indications sur la
santé de candidats à un emploi : non. Ont-ils même le droit de leur poser des questions
incisives sur leur santé (physique, mentale) ? La question est beaucoup débattue. Il y a des cas
évidents : difficile d’engager un apprenti conducteur de bus ou pilote d’avion qui a très
mauvaise vue. On peut comprendre aussi que, dans des fonctions qui demandent une
formation longue et coûteuse, on souhaite que la personne ne soit pas rapidement limitée par
la maladie… mais cela vient contredire des notions d’égalité des chances voire d’égale dignité
de chacun.
Autre cas où on voit que l’autorité publique doit disposer de données médicales, l’octroi ou le
maintien du permis de conduire. D’un point de vue de sécurité comme de santé publique, il
n’est clairement pas souhaitable que des personnes que leur état de santé rend dangereuses au
volant puissent conduire. D’où les examens périodiques dont les conclusions sont transmises à
l’autorité.
Secret médical et assurances
Dans l’assurance publique offerte/garantie à tous le résidents du pays (AVS, LAMal
notamment), il n’est pas question que des facteurs de maladie potentielle des personnes

3
puissent être invoqués à leur détriment. Mais la situation est très différente s’agissant de
l’assurance privée (-maladie complémentaire, -vie) : dans cette industrie, l’objectif est d’offrir
à un candidat la prime optimale, la plus basse possible, en fonction – précisément – de ses
chances de devenir malade plus vite ou plus souvent que d’autres, ou de mourir
prématurément. De manière logique dans une économie libérale, l’assureur va chercher à en
savoir le plus possible sur les caractéristiques du candidat, pour offrir une prime basse aux
personnes à moindre risque, mais une prime élevée à celles à haut risque (de maladie ou
décès). La solidarité sociale ne joue là aucun rôle. C’est la « chasse aux bons risques », que
l’on a vu se développer aussi, malheureusement, dans le cadre LAMal. D’où des exigences de
l’assureur privé d’accès à des données du dossier médical. Le candidat restant libre de refuser
cet accès, l’assurance elle restant libre alors de décliner d’entrer en matière. Or, par exemple,
des jeunes adultes ont souvent impérativement besoin d’une assurance-vie pour obtenir des
prêts en vue de lancer une entreprise.
Les médecins traitants sont ainsi confrontés à des dilemmes. Je me souviens bien de conseils
que des confrères me demandaient alors que j’étais médecin cantonal, à propos de patients
séropositifs VIH mais en bonne santé actuelle, et qui avaient besoin de contracter une
assurance-vie qui leur serait refusée si leur séropositivité était révélée. Nous débattions de ces
situations particulières ; aussi délicates qu’elles soient, je conseillais systématiquement de ne
pas être tenté de mentir - même pour le « bien du patient ».
Dans l’assurance-maladie sociale et universelle (LAMal), les efforts qui s’accentuent chaque
jour de maîtrise des coûts entraînent des demandes des caisses de remise ou confirmation
d’éléments couverts par le secret médical. Quand au fond, ces demandes ont leur légitimité :
les assureurs mais aussi la collectivité (nous sommes tous des contribuables) ont intérêt à ce
que les moyens disponibles soient utilisés de manière optimale, qu’il n’y ait pas (je force un
peu le trait) de gaspillages indétectables sous couvert de secret médical, de prestations non
nécessaires fournies pour calmer des patients revendicateurs ou proposées par des praticiens
pour améliorer leur revenu. Cet aspect d’éthique sociale ne doit pas toutefois justifier des
démarches excessives (fouineuses) des assureurs. Ici, le rôle des médecins-conseils des
assurances est crucial ; il importe que leur soit garantie une totale indépendance et que eux
seuls – et leurs collaborateurs directs soumis au secret médical – aient accès à ce données, et
pas des gestionnaires financiers.
En guise de conclusion
Le secret médical (« secret du patient ») reste un droit, fondé dans l’éthique médicale et dans
la loi, qui ne doit pas être touché dans son principe. Il faut voir néanmoins que, dans des
contextes qui ont leurs légitimités (diverses), il y a des circonstances où le patient est sollicité
de donner accès à des informations couvertes par le secret médical. Il est le décideur à cet
égard et peut refuser cet accès, mais doit alors compter avec de possibles conséquences du
refus. Il y a là tout un domaine avec des dimensions d’éthique sociétale et politique, de
volonté de maîtrise des coûts de santé (qui - mais c’est un autre sujet - ne peuvent qu’aller en
croissant), de libre marché (dans l’assurance privée) ; des débats qui vont certainement nous
accompagner dans les années à venir.
Une référence complète qui garde son actualité : Jean Martin et Olivier Guillod. Secret
médical. Bulletin des médecins suisses, 2000, vol. 81, p. 2047-2052.

4
1
/
4
100%