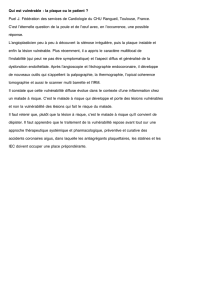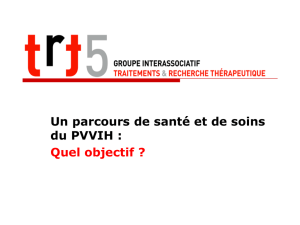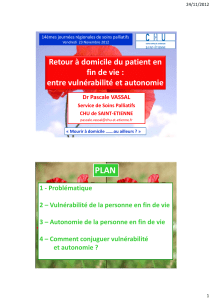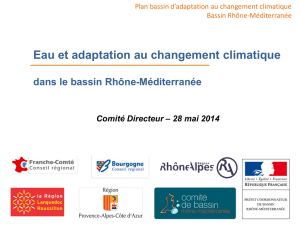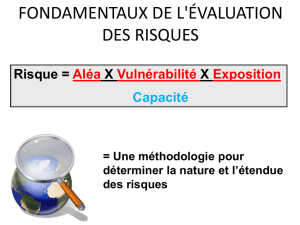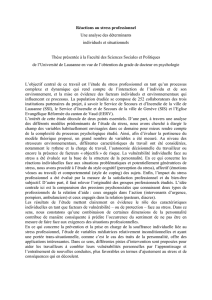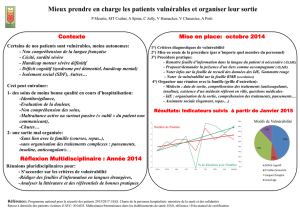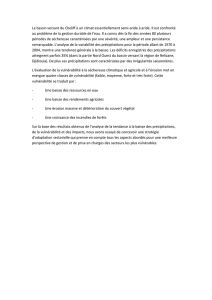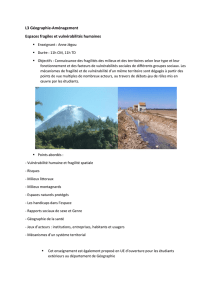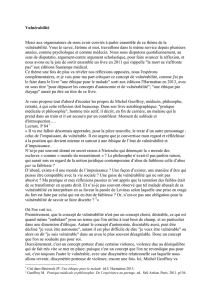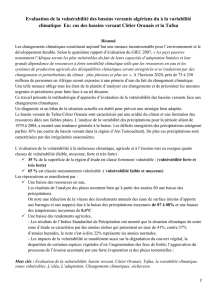respect, soin et vulnérabilité

1
Guillaume Le Blanc, « penser la fragilité », Revue Esprit, Mars-Avril 2006, p.249-263.
Fiche de lecture par J. Tardif université de Nice [email protected]
Philosophe , professeur à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. A récemment
publié « La vie psychique de la maladie », Esprit, janvier 2006 et l'Esprit des sciences
humaines, Paris, Vrin, 2005.
Avec Judith Butler (Voir à ce sujet Vie précaire, Paris, Éd. Amsterdam, 2005 et Humain,
inhumain, Paris, Êd. Amsterdam, 2005), nous pouvons penser que les formes mêmes de
définition des limites de l'humanité ne sont pas assurées et qu'il existe dès lors une précarité
fondamentale dans le fait même d'être humain qui mérite d'être exhibée au lieu d'être
contournée au profit d'une seule enquête ontologiques qui se restreindré à l'analyse de la
"phénoménologie de l'homme capable" (Parcours de reconnaissance, Paris Stock, 2004,
chap.II).
Questonné comme une "ontologie de l'être et de la puissance" (Ricoeur, Soi-même comme un
autre, paris, Le seuil 1990. p.352.) en tant "qu'investigation de l'être du soi à la
réapropriation des quatres acceptations primitives de l'être qu'Aristote place sous la
distinction de lacte et de la puissance. Toutes nos analyses invitent à cette exploration dans la
mesure où elles font signe en direction d'une certaine unité de l'agir humain" (ibid., p.351).
Cette entrée oblitère la variablité de figures de l'entrée dan l'humain et ne permet pas de
revenir sur la fragilité anthropologique de l'inscription dans l'humain. Portée à son point
extrême, la précarité désigne la reconduction de toute vie à la mort comme horizon ultime
(G. Canguilhem, « Les maladies », dans Écrits sur la médecine, Paris, Le Seuil, 2002, p 47)
C'est précisément vers cette interrogation que nous convie Ricoeur dans son analyse de la
naissance et de la mort. Dans Soi-même comme un autre, Ricœur a souligné, à la suite de
Heidegger, la contemporanëité des deux interrogations : la « vie finissante » et la « vie com-
mençante » peuvent être placées dans un jeu de miroirs proprement anthropologique qui
concerne, dans un même mouvement, la précarité de la vie et la précarité de l'humain.
Heidegger, Être et temps, Paris, Gallimard, 1986. § 72 “le Dasein factice existe à l'état
naissant et c 'est dans la naissance qu’il meurt déjà aussi au sens ou son être est d'être vers la
mort [.. ] c’est dans l’unité de l’être jeté et de lêtre vers la mort, qu’il la fuie ou qu'il y
marche, que s'entretiennent naissance et mort à la mesure du Dasein" p.438 à 439
La réflexion sur le « droit à la vie » de l'embryon et la méditation sur la « vérité due aux
mourants (Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p.313-315) » laissent entendre une
fragilité de la définition de l'humain dans la double limite de son apparition et de sa
disparition. Ricœur propose ainsi de compléter une phénoménologie des « capacités humaines
» par une ontologie des seuils d'actualisation de l'humain (ibid. P.316). Ce qui est
particulièrement intéressant, c'est que cette ontologie des seuils rouvre ce qu'une ontologie de
l'être pourrait trop rapidement refermer : replacé dans une ontologie des seuils, l'humain se
voit repensé en sa précarité originelle, celle-là même qui affleure dans l'ambiguïté de toute
apparition liée à l'engendrement et dans la violence de la disparition.
Contre toute fermeture ontologique trop rapide, il importe de considérer, sur un plan
également ontologique, que la vie humaine est précaire. Reprenant Canguilhem sur ce point
pour qui « l'existence de la maladie comme fait biologique universel, et singulièrement
comme épreuve existentielle chez l'homme, suscite une interrogation, jusqu'ici sans réponse

2
convaincante, relative à la précarité des structures organiques» (C. Canguilhem, « Les
maladies » art. Cité p.47).
L'involontaire de la vie en son engendrement, atteste d'un sens ontologique de la précarité qui
ne porte pas seulement sur la limite d'une vie singulière, mais plus radicalement sur le
caractère flottant de l'entrée dans l'humain révélé par la passivité irréductible qu'implique le
fait d'être en vie.
"La vie est plus que la spontanéité des motifs et des pouvoirs ; elle est " une certaine nécessité
d'exister que je ne peux plus m'opposer pour la juger et la maîtriser. Je ne peux pas aller
jusqu'au bout de cet acte d'exil qu'est la conscience de cette appréciation et de cette
souveraineté que sont la motivation et l'effort ; la vie échappe de toute part à ce
jugement et à ce commandement auquel elle est secrètement présente. La vie n'est pas
seulement la partie basse sur laquelle je règne" (P. Ricoeur, le Volontaire et l'involontaire,
Paris, Aubier, 1950, p.385).
Ce qui est remarquable dans cet extrait, c'est que Ricœur articule l'inscription de l'humain
dans la vie au double motif d'une dépossession de la vie humaine par la nécessité biologique
de la vie et d'une relance constante de la tâche éthique comme effort, problématique et
valeureux, pour être l'auteur de sa vie. L'attestation de soi, désignée comme l'une des
tâches de la « petite éthique » dans Soi-même comme un autre, comme déploiement des
capacités humaines, sur fond de laquelle une reconnaissance de soi (au sens de
l'identification) devient possible (Parcours de la reconnaissance, op. cit., chap. II.
Se reconnaître dans ses capacités, attester de soi en attestant de ses capacités ne vaut que dans
les limites d'une vie comprise comme toujours déjà précaire. Si l'homme peut parvenir à être
le « centre de perspective » de sa vie (le Volontaire et l'involontaire, op, cit., p. 386), ce ne
peut être qu'au prix d'un effort lui-même enlevé sur fond d'un involontaire premier, et dès lors
marqué par une fragilité intrinsèque qui renvoie à la figure de la vulnérabilité.
PORTRAIT DE L'HOMME ORDINAIRE EN HOMME VULNÉRABLE
La vulnérabilité ne saurait être regardée uniquement sous l'angle d'une fragilisation de
l'humain comme effet d'une précarité persistante mais elle doit être entendue également
comme motif du travail éthique, comme la matière de tout travail sur soi. L'éthique ne
s'oriente du côté des formes de la capabilité humaine à l'origine d'une attestation de soi et
d'une reconnaissance de soi que pour autant qu'elle cherche à répondre de la désorientation de
la vie humaine engendrée par les différentes formes de fragilisation de la vie humaine. «
Condition et tâche, telle apparaît l'autonomie fragilisée par une vulnérabilité constitutive de
son caractère humain» (Ricœur, le Juste 2, op. cit., introduction, p.25.) L'autonomie est certes
fragilisée par la vulnérabilité mais la vulnérabilité est ce qui constitue l'autonomie en
autonomie humaine. Ainsi ne faut-il pas comprendre l'autonomie comme une alternative à la
vulnérabilité mais comme son approfondissement critique. L'autonomie est fragilisée par la
vulnérabilité pour autant cependant qu'elle est relancée par elle comme le motif de la
tâche critique visée dans l'attestation de soi déployée dans les différents registres des
capacités humaines telles que le pouvoir-dire, le pouvoir-faire, le pouvoir-raconter et
l'imputabilité.
« Autonomie et vulnérabilité », titre d'une conférence prononcée en 1999 et reproduite dans le
juste 2, peut représenter une sorte de blason philosophique pour lequel l'enjeu est précisément
l'articulation et l'établissement d'un point de jonction entre l'autonomie et la vulnérabilité.
"C'est la vulnérabilité qui fait que l'autonomie est une condition de possibilité ibid p85»
La possibilité même de l'indépendance repose sur une juste compréhension des formes

3
de dépendance. Ceci signifie non seulement que seul un être fragile peut être appelé à
devenir autonome mais qu'une vie humaine est à la fois vulnérable et autonome. « C'est le
même homme qui est l'un et l'autre sous des points de vue différents (ibid p.86)». Une
anthropologie de l'homme capable ne peut alors être élucidée que si elle est également une
anthropologie de l'homme vulnérable. Le vocabulaire des capacités doit être ainsi corrélé à
celui des incapacités. C'est à une telle démarche que s'emploie Autonomie et vulnérabilité ».
Cette liaison des capacités et des incapacités articule à nouveaux frais les dimensions du
volontaire et de l'involontaire, de l'activité et de la passivité présentes dès les premiers livres
de Ricoeur.
La vulnérabilité s'intercale entre la passivité et la faillibilité (Finitude et culpabilité, l'Homme
faillible. Paris, Aubier, 1960, Conclusion « Le concept de faillibilité », p. 157). Elle reverse
l'expérience de la passivité et de la faillibilité sur le compte d'une compréhension de la
précarité des vies et contribue ainsi à brouiller l'évidence des figures de l'humain. La passivité
de l'involontaire et la faillibilité du pouvoir moral doivent être retraduites dans une
compréhension de la vie vulnérable dont elles ne sont plus désormais que des dimensions
particulières. La conscience de soi, sur le premier versant, est toujours en arrière d'elle-même.
Précédée par "l'imputation pré-réflexive de soi" (P. Ricoeur, le Volontaire et l'involontaire,
op. cit., p. 57) à l'oeuvre dans les émotions et les passions, elle se comprend dès lors comme
effort de reprise, comme réappropriation de l'involontaire dans le volontaire. La conscience
morale de soi, sur le second versant, est révélée par l'expérience de la faiblesse morale sous
laquelle le mal est conduit à « la limitation spécifique de l'homme » engendrée par l'incapacité
de se réapproprier positivement sa finitude. On voit dès lors comment dépossession de soi
dans l'involontaire et faiblesse morale peuvent apparaître comme des cas d'espèce de la
vulnérabilité. Elles indiquent des formes spécifiques de dépendance ouvertes par
l'expérience anthropologique.
Il ne faudrait pas en tirer la conclusion que l'autonomie est hors de portée mais qu'elle
doit être au contraire articulée à la pluralité des formes de dépendance d'une vie. C'est
de l'intérieur de l'épreuve du négatif que le désir d'autonomie prend sens. La contingence de
l'existence « exhibe [ainsi] le négatif enveloppé dans tous les sentiments de précarité, de
dépendance, de défaut de subsistance, de vertige existentiel qui procèdent de la méditation
sur la naissance et sur la mort ibid p.155». La vulnérabilité peut dès lors être comprise
comme la réserve anthropologique des différentes figures du négatif qui déjoue
l'évidence trop lumineuse de l'appel inconditionné à l'autonomie. En elle, c'est la
possibilité même de l'homme capable qui se voit d'emblée fragilisée. La vulnérabilité
rouvre ainsi les différentes figures de la puissance humaine aux formes symétriques de la «
non-puissance » ou de la « puissance moindre (P. Ricœur, le juste 2, op. cit., p. 89) "
LES FIGURES DE LA VULNÉRABILITÉ :
De la fragilité affective de l'homme faillible à la vulnérabilité de l'homme précaire dans
le Juste 2, le sens de la fragilité s'est transformé. La fragilité ne désigne plus une région
de l'existence humaine (la vie affective) mais elle qualifie la totalité des capacités
humaines ainsi replacées dans l'épreuve des incapacités. La catégorie de vulnérabilité
entérine cet élargissement de la signification de la fragilité. C'est pourquoi il importe de
référer toutes les capacités humaines à leurs incapacités réciproques. C'est précisément la
précarité de ces capacités qui ouvre la scène de la vulnérabilité en sa relation à l'autonomie.
Pour Ricœur, le « couple capacité-incapacité » peut être reçu comme « la forme la plus
élémentaire du paradoxe de l'autonomie et de la vulnérabilité (ibid p.91) ». Parce que la
capacité humaine est toujours doublée (au sens de la doublure) d'une incapacité contre

4
laquelle elle trouve à se déployer, l'autonomie apparaît comme la tâche engendrée par
l'épreuve de la vulnérabilité.
Certes il serait possible d'objecter à Ricoeur que cette possibilité de mise à distance du négatif
se distribue socialement de manière très inégale. N'existe-t-il pas en effet un leurre à
considérer l'expérience de l'autonomie comme travail sur le négatif dans le seul registre
moral ? La grammaire de la vulnérabilité peut-elle être une grammaire morale sans être
en même temps une grammaire sociale ? Comme l'affirme Bourdieu, ne faut-il pas
soutenir que l'expérience morale, pour devenir effective, doit toujours être, en même
temps, une expérience sociale et politique ("Bref, la morale n'a quelque chance d'advenir
[...1 que si l'an travaille à créer les moyens institutionnels d'une politique de la morale",
Raisons pratiques, Paris, Le Seuil, 1994, p.243) ?
Le « Soi-auteur » (P. Ricœur, le juste 2, op. cit., p. 98. 28. Ibid., p.8.) ne peut venir que d'un
travail de réappropriation du soi fortement ébranlé dans la vulnérabilité. Le registre des
incapacités fait alors signe vers la possibilité d'un réarmement des capacités grâce à l'éthique.
Situé à l'intérieur de la polarité « des pouvoirs et des nonpouvoirs » qui font de l'homme un
être à la fois agissant et souffrant (ibid p.8), le travail éthique peut dès lors engendrer une
capacité supplémentaire qui est celle de « l'imputabilité ».
Le coeur de l'idée d'imputabilité repose en effet sur le fait d'être tenu soi-même « pour
l'auteur véritable de ses propres actes". Le travail éthique vise cette imputabilité comme
son objet propre. Il peut y parvenir en s'efforçant de dénouer les complexes de puissance et de
non-puissance qui fragilisent les visées d'autonomie. Ainsi l'imputabilité est-elle à la lettre
l'issue du travail éthique dont la légitimité provient de l'inscription des capacités dans les
figures des incapacités.
Il importe donc de faire correspondre aux différents pouvoirs de l'homme les formes
d'impuissance dans lesquelles ils se trouvent situés afin que le travail éthique puisse être
clairement perçu comme travail en direction du pouvoir contre l'impuissance. Les trois pou-
voirs fondamentaux que Ricoeur envisage sont « le pouvoir de dire », « le pouvoir d'agir » et
« le pouvoir de rassembler sa propre vie dans un récit intelligible et acceptable ibid p.88 ».
Ces trois pouvoirs ne peuvent être repris positivement qu'à la condition qu'ils soient
ressaisis par un ultime pouvoir, l'imputabilité, sous une forme réflexive propre à l'im-
putabilité qui prend l'allure d'un énoncé - « Je crois que je peux » - et qui implique la
possibilité d'un retour sur ses capacités. « À première vue nous faisons un saut qualitatif en
passant de l'idée de capacité à celle d'imputabilité ibid p.96 » C'est dire que les capacités, non
seulement, sont plurielles mais qu'elles sont également partielles dans la mesure où elles
risquent d'être fragilisées de l'intérieur même de leur déploiement, du fait de la précarité
ontologique de l'homme. Ainsi les capacités de pouvoir dire, de pouvoir faire et de pouvoir
(se) raconter doivent-elles être mises en rapport avec les incapacités linguistiques, pratiques et
narratives qui leur correspondent.
La fragilisation des capacités humaines n'est pas un fait naturel mais renvoie à
l'institution humaine et aux inégalités qu'elle engendre. Le développement des
incapacités correspond alors à un certain traitement de l'homme par l'homme dont le
corrélat est le développement historique des figures de la fragilité Ricœur l'évoque à
propos de la capacité langagière. "Immédiatement nous saute aux yeux cette inégalité
foncière des hommes quant à la maîtrise de la parole, inégalité qui est moins une donnée de
la nature qu'un effet pervers de la culture lorsque l'impuissance à dire résulte d'une exclusion
effective hors de la sphère langagière" (ibid p90).

5
Dans le même mouvement, le développement des inégalités dans le déploiement du registre
des capacités, suscité par l'entrée dans l'humanité, laisse clairement percevoir la tâche d'une
politique de l'égalisation des capacités humaines. La distribution inégale des capacités
linguistiques révèle, a contrario, que l'une « des toutes premières modalités de l'égalité des
chances concerne l'égalité au plan du pouvoir parler, du pouvoir dire, expliquer, argumenter,
débattre ibid .90 ». Le fait que la capacité linguistique vienne à manquer en révèle la valeur.
Cette valeur est double. Elle permet de conférer un sens à l'identité personnelle en
établissant les moyens symboliques d'une insertion de soi dans l'humanité. Elle permet
également d'asseoir l'institution de l'humanité dans le soi. Réciproquement, l'incapacité de dire
ne peut manquer d'apparaître comme une fragilisation du lien qui relie le soi à l'humanité. «
Se croire incapable de parler, c'est déjà être un infirme du langage, excommunié en quelque
sorte (ibid. p.90) ». L'impuissance révélée dans le désaveu de la capacité linguistique exclut
l'homme ainsi fragilisé de la communauté humaine. L'exclusion est donc l'une des formes
paradoxales de l'institution de l'humanité. Le développement de la forme humaine en forme
sociale ne peut manquer d'engendrer des souffrances, du fait de la position des hommes dans
les rapports sociaux qui se révèlent à l'occasion de la fragilisation des capacités humaines
individuelles. Les incapactés correspondent aux transcendantaux historiques négatifs
d'une époque et excèdent ainsi les formes mêmes de la précarité ontologique (ce que
Ricœur nomme « la finitude générale et commune »). Les incapacités sont alors des effets
de la précarité ontologiques mais elles sont aussi des effets de la vulnérabilité sociologique de
l'homme. L'incapacité linguistique a bien pour origine lointaine le fait que « nul n'a la maîtrise
du verbe » mais elle a pour origine proche la vulnérabilité sociale de celui qui est, du fait de
sa position sociale - laquelle peut être, en son paroxysme, une non-position - privé de parole
ou dont la voix n'est pas écoutée.
Dans le même registre, la capacité d'agir est fragilisée par les formes multiples de relations
dissymétriques qui essaiment dans une société.
"Sont à prendre ici en considération les modalités de distribution inégale de la puissance
d'agir, plus particulièrement celles résultant des hiérarchies de commandement et d'autorité
dans des sociétés d'efficacité et de compétition comme les nôtres" (ibid p.91)
Là encore, la précarité ontologique qui assigne un individu aux incapacités de la finitude
« infligées par la maladie, le vieillissement, les infirmités (Ibid., p.91) », suscite une
précarité sociologique signalée par la dépossession de la puissance d'agir. L'inactivité
s'impose alors comme un effet de cette précarité sociale. Trop de gens ne sont pas
simplement démunis de puissance, mais privés de puissance (ibid p.91).
La précarisation de l'emploi et le développement du chômage mettent en crise la
puissance d'agir individuelle et accomplissent à leur tour les processus de
déshumanisation comme symétrique de l'institution de l'humanité.
L'identité personnelle d'un sujet qui peut donner sens à l'autonomie (« Il me paraît difficile de
parler d'autonomie sans parler d'identité », ibid., p. 91) n'a donc rien d'assuré ni de stabilisé.
Sa fragilisation s'accomplit dans la fragilisation de la capacité narrative à se dire. La propriété
narrative de l'ipséité qui est attestée par le modèle narratif du récit de vie ordinaire n'est pas
garantie. S'il existe bien une plasticité de la narration qui fait surgir la puissance narrative
comme puissance humaine par excellence, il existe en retour une violence de l'annulation de
la puissance narrative qui achève le double processus de disqualification et de
déshumanisation du soi. Répondre de soi dans la cohérence d'un récit de vie ne va pas de soi.
Nous ne devons pas perdre de vue la possibilité inverse, celle de l'impuissance à s'attribuer
une identité quelconque, faute d'avoir acquis la maîtrise de ce que nous avons appelé
identité narrative (Ibid., p. 93) D'où vient cette absence de maîtrise ? Elle provient d'une
dispersion temporelle irréductible qui est bien l'une des formes de la violence sociale. Qu'un
homme puisse faire tenir son histoire dans un récit de vie présuppose un apprentissage de
 6
6
 7
7
1
/
7
100%