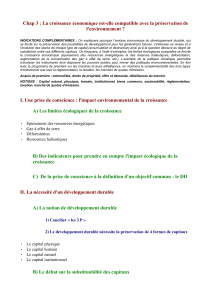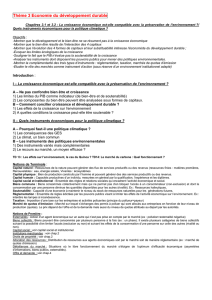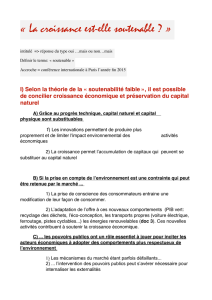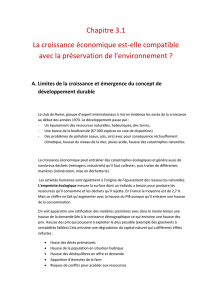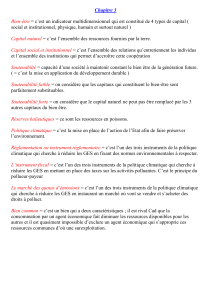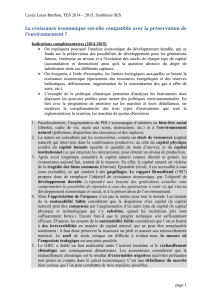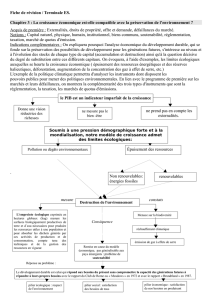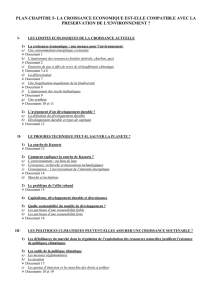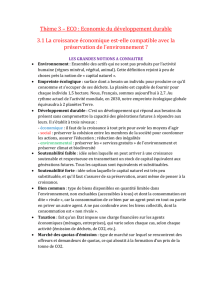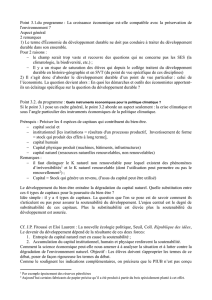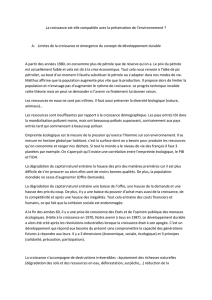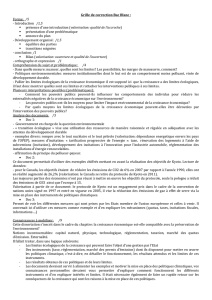3.1 La croissance économique est

3.1 La croissance
économique est-
elle compatible
avec la
préservation de
l’environnement ?
Capital naturel,
physique,
humain,
institutionnel,
biens communs,
soutenabilité,
réglementation,
taxation,
marché de
quotas
d’émission.
On expliquera pourquoi l’analyse économique du développement durable, qui se fonde
sur la préservation des possibilités de développement pour les générations futures,
s’intéresse au niveau et à l’évolution des stocks de chaque type de capital
(accumulation et destruction) ainsi qu’à la question décisive du degré de substitution
entre ces différents capitaux. On évoquera, à l’aide d’exemples, les limites écologiques
auxquelles se heurte la croissance économique (épuisement des ressources
énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la
concentration de gaz à effet de serre etc…). L’exemple de la politique climatique
permettra d’analyser les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour mener
des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les
marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types
d’instruments que sont la réglementation, la taxation, les marchés de quotas
d’émission.
Acquis de première : externalités, droits de propriété, offre/demande, défaillances du
marché.
Notions
Capital naturel : ensemble des ressources que la nature met à notre disposition. Certaines ressources ne
sont pas renouvelables (c’est le cas des énergies fossiles, minerais etc…), et d’autres sont renouvelables
comme les réserves halieutiques, forêts etc…
Capital physique : ensemble des moyens de production installés (équipements industriels, outils de
production…)
Capital humain : ensemble des connaissances et des compétences accumulées par les hommes, qui se
transmet à travers l’enseignement et l’apprentissage (Gary Becker).
Capital institutionnel : ensemble des institutions politiques, institutionnelles ou juridiques qui permettent
d'établir des cadres et contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et
sociales. Il comprend aussi l'ensemble des relations humaines auxquelles l'individu a accès de par sa
position dans un groupe social.
Biens communs : bien non exclusif mais rival, c'est-à-dire un bien dont on ne peut exclure personne de sa
consommation mais dont l'utilisation par un individu est coûteuse ou réduit l'utilisation du bien par
d'autres individus.
Soutenabilité : qualifie le fait qu'un développement soit durable. On distingue ordinairement entre
soutenabilité faible (si on suppose que les différents types de capitaux sont substituables) et soutenabilité
forte (si on suppose que les différents types de capitaux sont complémentaires, c'est-à-dire que l'on ne
peut remplacer du capital d'un type par du capital d'un autre type).
Réglementation : instrument qui vise à édicter des règles, des normes environnementales permettant de
limiter les pratiques sources d’externalités négatives.
Taxation : instrument économique consistant à faire payer aux producteurs leurs activités sources
d'externalités négatives, au profit de la collectivité. Elle vise à faire internaliser aux producteurs le coût
social de leurs activités.
Thème 3 Economie : Economie du développement durable
3.1 La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?

Marché de quotas d’émission : lieu où s’échangent les droits à produire des externalités négatives.
Acquis de première
Externalités : conséquence d’une activité économique qui n’est pas sur le marché et ne tient pas compte
d’une compensation monétaire. On distingue externalités positives (ex : les petites abeilles, installation
d’une station de métro près de chez soi) et externalités négatives (ex : pollution).
Droits de propriété : ensemble des usages possibles attachés à la possession d’un bien (vente, location,
donation…).
Offre et demande : quantité de biens et de services offerts à la vente ou demandés par un acheteur en
fonction d’un prix donné.
Défaillances du marché : situation où le libre jeu de la concurrence débouche sur une situation sous
optimale.
A) Limites de la croissance et émergence du concept de développement
durable.
Etant donné que la population augmente, la consommation du pétrole est elle aussi très importante. Les
ressources en pétrole se font rare et cela peut nous conduire au « pic oil » (stagnation puis diminution de la
production de pétrole et ensuite épuisement de la ressource). La croissance, donc le développement est
également à l’origine de la réduction de la biodiversité, de l’épuisement des ressources naturelles, de la
pollution et du réchauffement climatique.
Certaines ressources se renouvellent mais en parti uniquement, une question sur la soutenabilité se pose
alors. La soutenabilité est la capacité d’une société à maintenir un niveau de bien-être constant.
Thomas Maltus explique le manque de ressources par une augmentation trop importante de la population
dans Essai sur le principe de population (1798), il faut alors réguler la population en limitant les naissances.
La dégradation du capital naturel entraîne un choc d’offre négatif. Les ressources deviennent rares et donc
les prix augmentent considérablement : production d’agro carburants, problèmes financiers (vente des
actions, bulle spéculatives des matières premières). Le prix du baril de pétrole a fortement diminué et cela
est à l’origine d’un ralentissement de la croissance (augmentation de l’offre mais baisse de la demande), on
se heurte donc à la loi des rendements décroissants.
La croissance est donc responsable de la hausse des prix des assurances, augmentation du nombre de
décès à cause de la pollution et enfin du stress hybride.
Pendant la conférence des Nation-Unies à Stockholm en 1972, la question de la soutenabilité de la
croissance est posée. Le rapport de Meadow effectué par le MIT (1970) au Club de Rome souligne les
dangers de la croissance sur l’environnement (Halte à la croissance). La commission Bruntland a publié en
1987 un rapport en faveur du développement durable Notre avenir à tous. Le développement durable
serait donc un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures et se repose sur trois dimensions : économique (gestion des ressources qui permettent
le bien-être pour générer de la croissance), sociale (les richesses doivent être partagées dans le monde
(horizontalement) et dans les générations (verticalement) et écologique (il faut préserver les ressources, les
écosystèmes et la biodiversité). Mais également sur trois principes : la solidarité (entre riches et pauvres), le
principe de précaution (étudier les impacts avant de le mettre en œuvre) et enfin la participation (il faut
impliquer tous les acteurs).

La croissance s’accompagne de destructions irréversibles : épuisement des richesses naturelles (dégradation des sols et
des ressources en eau, déforestation, surpêche,…), réduction de la biodiversité (67 000 espèces animales et végétales
sont en voie de disparition), pollutions, réchauffement climatique,…
Il est évident, à conditions techniques identiques, que si les peuples des pays en développement imitent le mode de vie
des populations occidentales, la planète sera incapable de satisfaire tous les besoins humains.
La dégradation du capital naturel entraine plusieurs conséquences sur les populations : hausse durable des prix des
ressources naturelles, du fait de la réduction progressive de l’offre et de la forte augmentation de la demande de
produits primaires, remise en cause du niveau de vie et de bien-être des populations (coût humain et économique de la
pollution,…), augmentation des inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays, diminution de la cohésion sociale.
A l’initiative du Programme des Nations Unies pour l’environnement, la commission « Brundtland » a publié en 1987 un
rapport intitulé « Notre avenir à tous », en faveur d’un développement durable ou soutenable défini comme « un
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ». Il repose sur trois principes : la solidarité entre les riches et les pauvres pour les
générations actuelles (ce qui revient à éliminer la pauvreté dans le monde) ; la précaution (il faut étudier l’impact de
toute action sur les équilibres économiques, sociaux et écologiques avant de le la mettre en œuvre) ; la participation :
tous les acteurs de la société civile doivent être associés au processus de décision.
Le développement durable ou soutenable intègre trois dimensions : économique (une croissance des richesses doit être
possible par une « gestion optimale » des capitaux) ; sociale (cette richesse doit être équitablement partagée dans le
monde et entre les générations) ; environnementale : les ressources et la planète doivent être préservées.
B) La croissance peut-elle être soutenable ?
Selon Stiglitz, la croissance est compatible avec l’environnement uniquement si les ressources sont
transmises aux générations futures (volume, stock et qualité). On distingue alors plusieurs stocks de
capitaux : capital physique (moyen de production), capital humain (les informations etc…), capital
institutionnel et social (Etat de Droit), capital naturel (ressources naturelles). Etant donné que le capital
naturel ne s’échange pas (n’a pas de valeur marchande), alors on ne peut pas connaître avec certitude le
stock qu’on dispose.
Deux types de soutenabilité existent : soutenabilité faible (les capitaux sont substituables entre eux, les
progrès technique permettent de remplacer le capital naturel, Robert Solow) et la soutenabilité forte (les
capitaux ne sont pas toujours substituables, Club de Rome). Cette question sur la soutenabilité divise les
avis, ceux qui sont en faveur de la soutenabilité faible et les personnes en faveur de la soutenabilité forte.
Les partisans de la soutenabilité faible explique que le tertiaire est une activité relativement peu
gourmande en énergie et en matière première, ce qui nous permet de faire un lien avec la courbe de
Kuznets (que lorsque la richesse augmente, l’accumulation du capital humain et physique permet des
innovations (techniques plus efficaces pour l’exploitation des ressources naturelles et donc des rendements
plus importants).
Tandis que les partisans de la soutenabilité forte expliquent que le capital naturel détermine le bien-être
(facteur qui limite la croissance), les facteurs de productions ne sont pas tous substituables et dénoncent
une vision scientisme. Cependant la croissance est actuellement insoutenable en particulier avec la
démographie. Le progrès technique a un effet rebond c’est-à-dire que si l’on produit des voitures
efficacement, la consommation sera plus faible car le prix sera plus élevé. De plus, le capital naturel est un
bien commun qu’il faut préserver. La Banque Mondiale met en place l’épargne nette ajustée en se reposant
sur l’idée que les capitaux sont substituables. En effet, beaucoup de matières premières peuvent être
substituées comme le pétrole en biomasse par exemple, grâce aux progrès techniques. Au contraire les
capitaux qui ne sont pas substituables doivent être conservés.
Pour la plupart des économistes, le bien-être dépend de la combinaison de quatre formes de capital qui entrent en
interaction les unes avec les autres :
Le capital naturel représente l'ensemble des ressources que la nature met à notre disposition. Certaines de ces
ressources ne sont pas renouvelables (énergies fossiles, minerais...), d'autres sont dites renouvelables, même s'il faut
tenir compte de leur rythme de reconstitution et de l'intensité des prélèvements (réserves halieutiques, forêts, etc.).
Le capital physique produit est constitué des biens de production durables et il s'accroît au rythme de la formation
brute de capital fixe dont il faut déduire la proportion qui, chaque année, est usée ou devient obsolète.

La notion de capital humain est issue des travaux de Gary Becker et recouvre l'ensemble des connaissances et des
compétences accumulées par les hommes; il se transmet à travers l'enseignement et l'apprentissage.
Enfin le capital social recouvre les relations entre les individus, dans la sphère professionnelle et privée, et qui
conditionnent le degré de confiance et de coopération que les individus peuvent mobiliser. On lui adjoint souvent le
capital « institutionnel » qui renvoie à la qualité des structures politiques et sociales.
Avec le développement de l’analyse économique des problèmes environnementaux, se sont opposés deux courants de
pensée: des optimistes notent que les problèmes environnementaux actuels sont moindres qu’avant et que ce qui est
généralement décrit, que la rareté des ressources va s’inverser grâce aux ressources alternatives qui pourront
économiquement se développer et que la croissance économique favorise la qualité de l’environnement au-delà d’un
certain niveau de développement (courbe de Kuznets). On parle dans leur cas de « soutenabilité faible ».
La Banque Mondiale a ainsi mis au point un instrument comptable (épargne nette ajustée) qui repose sur cette idée
que les capitaux sont substituables.
A l’inverse, les partisans de la soutenabilité forte partent du principe que le capital naturel détermine le bien-être de la
population et devient un facteur limitant de la croissance. Les facteurs de production ne sont pas tous substituables
mais relativement complémentaires et les innovations technologiques seules ne peuvent repousser les limites de la
croissance économique. Cette approche va privilégier le principe de précaution, et nécessite donc le maintien dans le
temps du stock de capital naturel car la croissance actuelle est insoutenable.
C) Quels instruments pour les politiques climatiques ?
La croissance est responsable de plusieurs phénomènes comme le changement climatique (élévation de la
température, évènements météorologiques extrêmes (ex : tempêtes, inondations) qui ont pour
conséquence une menace sur la biodiversité, pollution des eaux, une migration environnementales. Mais
également une chute de la production agricole, l’expansion de maladies contagieuses comme le paludisme
etc… Ce dérèglement s’explique par une activité industrielle trop importante (accumulation dans l’air de
gaz à effet de serre, combustion des énergies fossiles) et déforestation.
Les fondements des politiques climatiques
Les productions agricoles provoquent des externalités (conséquence d’une activité économique qui n’est
pas sur le marché et ne tient pas compte d’une compensation monétaire) qui peuvent être positives ou
bien négatives.
Exemple d’externalité positive : installation d’une station de métro près de chez soi, donc valeur de la
maison augmente.
Exemple d’externalité négative : la pollution représente des coûts sociaux qui ne sont pas pris en compte
sur le marché donc le prix du marché ne reflète pas le prix de la production. Et puisque le prix guide les
agents économiques à faire les bons choix, ce dysfonctionnement entraîne des décisions qui ne sont pas
bonnes. Avec la défaillance du marché, les pouvoirs publics doivent intervenir, on essaye donc
d’internaliser les externalités.
Le PIB a des limites dans la prise en compte des questions environnementales, tout d’abord il n’a pas été
créé pour mesurer les activités environnementales mais plutôt pour mesurer la croissance (par Simon
Kuznets en 1934). En effet, il ne comptabilise pas les externalités positives, les services rendus mais les
dépenses de dépollution sont comptabilisées positivement. Ce qui veut donc dire que plus on pollue et plus
le PIB sera élevé et enfin il ne tient pas compte du stock de capital naturel, c’est donc une mesure
imparfaite.
La « tragédie des biens communs » est mise en place par Garrett Hardin en 1868, il explique la disparition
des ressources par la ruine de tous puisque tout le monde veut maximiser ses intérêts sur la terre
commune. Un bien commun est donc un bien rival difficilement excluable (on ne peut exclure personne de
la consommation). Le climat par exemple est victime de la tragédie du bien commun puisque tout le monde
la détériore et donc personne ne peut en bénéficier. Cela ne conduit pas à la satisfaction de l’intérêt
générale : la main invisible ne fonctionne pas puisque on n’est pas sur un marché, pour que la main

invisible fonctionne il faudrait un marché avec des droits de propriétés (rendre les biens excluables). Afin de
préserver les biens communs, l’Angleterre met en place la politique des « hands clovers » c’est-à-dire la
privatisation des terres mais qui ont donc pour conséquence de faire augmenter la pauvreté : exode rural.
Cette loi aurait indirectement poussé à la création du capitalisme. Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie en
1990) apporte une solution efficace c’est celle de la gestion communautaire et de coopération.
Les outils à la disposition des pouvoirs publics
Les instruments économiques (règlementaires) permettent de répondre à la question climatique par deux
façons : la contrainte et l’incitation. Des normes sont alors mises en place : normes d’émission ou de rejet
(seuil maximal d’émission de CO2), normes de procédés (normes de recyclages à anticiper dans la
production), de produit (emballage et recyclage) et de qualité (qualité de l’aire et de l’eau). Cependant,
cette politique de réglementation dispose de limites : ce sont des règles uniformes et qui peuvent donc
pénaliser les artisans en alourdissant trop les coûts et qui peut donc entraîner des fraudes ou des
délocalisations), des effets rebonds de la norme, s’il y a trop de consommation ou de producteur, l’effet de
serre va alors augmenter, et enfin pour faire respecter une norme on doit avoir des moyens de contrôle, or
certains quotas sont difficiles à respecter. En effet, l’Etat fixe un quota et ensuite les entreprises qui n’ont
pas consommé tous leurs quotas d’émissions peuvent le revendre et en retirer des bénéfices, au contraire
ceux qui qui polluent trop vont devoir racheter des quotas pour être dans les normes. Les quotas sont
échangeables sur un marché et ce marché va déterminer un prix par la confrontation de l’offre et de la
demande. Le fonctionnement du marché est expliqué par Ronald Coase en 1960 dans « Problem of social
Coast ». Ainsi, si le marché est efficace, l’entrepreneur va chercher des méthodes non polluantes et sera
incité à faire des choix qui conduisent au non pollution de l’environnement.
Cependant, comme tous les marchés, le marché des quotas d’émission a aussi des limites. Tout d’abord, il y
a un prix fixe, environ 30 euros alors qu’en réalité on est à 5 euros, ce n’est donc pas un système incitatif.
L’UE a donné des quotas trop généreux pour ne pas nuire à la compétitivité des entreprises, il y a donc une
offre abondante, mais une demande faible puisqu’avec le ralentissement de la croissance, les entreprises
produisent peu et achètent aussi moins de quotas. On peut également constater de gigantesques fraudes
(1,5 milliards d’euros au trésor public français, fraude sur la TVA) ce qui témoigne d’une insuffisance de
régulation et de contrôle. Il y a également des politiques fiscales qui passent par la subvention et la taxation.
Pour la subvention, il y a le principe du bonus/malus qui consiste à taxer les véhicules polluants et de
subventionner les véhicules non polluants (mise en place sous le gouvernement de Sarkozy, subvention qui
n’existe plus désormais), mesure incitative. L’Etat prend également en charge une partie du coût pour
modifier les prix relatifs (rendre un véhicule peu polluant moins cher comparé à un véhicule plus cher), il y
a donc une plus grande compétitivité pour pousser les agents à l’achat. Mais elle représente un coût
important pour l’Etat et conduit à une augmentation d’achat de véhicule neufs (effet rebond car volume
d’émission plus important).
Au contraire il y a la taxation, par exemple la taxe carbone qui consiste à taxer les produits
proportionnellement aux émissions de carbone, taxer les émetteurs (voitures et grandes installations
comme les usines). En France, la taxe carbone prévue pour les véhicules polluants n’existe plus en raison du
mécontentement des chauffeurs poids-lourds. Il s’agit du principe pollueur/payeur d’Arthur Cecil Pigou
(taxe Pigou).
Cependant, la taxation des émissions CO2 ont deux limites, tout d’abord il s’agit d’une taxation inégalitaire
entre urbains et ruraux (qui utilisent plus leur véhicule), il faudrait alors compenser ces ménages avec un
« chèque vert » pour réduire le coût élevé de la taxation. De plus, la taxation pourrait déprimer la demande
globale avec la baisse de consommation.
Complémentarité des instruments des politiques climatiques
 6
6
1
/
6
100%