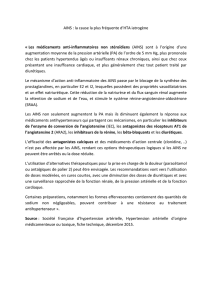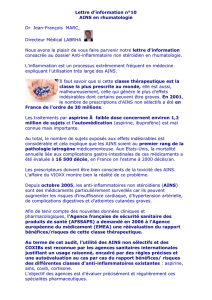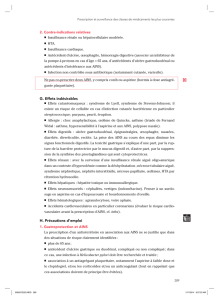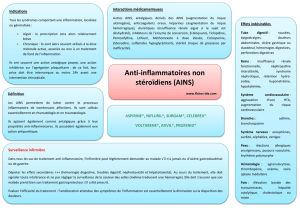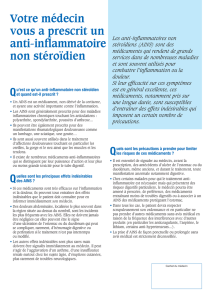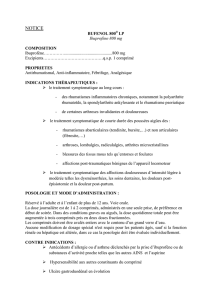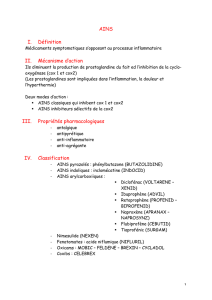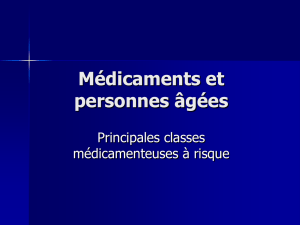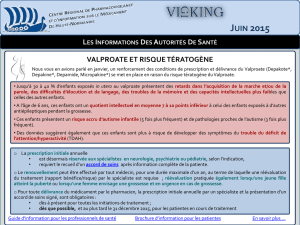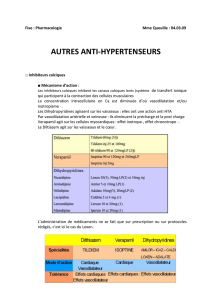AIS - Facultés de Médecine de Toulouse

135
PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE DES ANTIBIOTIQUES
(173)
Jacques AMAR
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Savoir traiter la plupart des infections bactériennes communautaires,
Connaître les signes de gravité nécessitant l’hospitalisation
Connaître les principales indications des différentes classes d’antibiotiques en
fonction de leur spectre antibactérien.
Connaître les indications de l’antibiothérapie probabiliste et à contrario les
situations dans lesquels une documentation bactériologique est indispensable.
PLAN
I - Position du problème et objectifs pédagogiques
II - Démarche thérapeutique
2.1 Indication à un traitement antibiotique
2.2 Abstention thérapeutique
2.3 Antibiothérapie en prophylaxie
2.4 Faut-il faire des prélèvements bactériologiques préalables ?
2.5 Le terrain et les interactions médicamenteuses
2.6 Les autres facteurs à prendre en compte pour la prescription
2.7 Monothérapie ou association
2.8 Le suivi thérapeutique
2.9 Arrêter le traitement
2.10 Après l’arrêt du traitement

136
I - Position du problème et objectifs pédagogiques
Les antibiotiques sont une des familles les plus prescrites : 80% des antibiotiques sont
prescrits pour le traitement d’infection respiratoire d’étiologie majoritairement virale.
Les antibiotiques sont prescrits chez plus de 30% des malades hospitalisés et
représentent 20% des dépenses de médicaments dans les hôpitaux.
La résistance bactérienne directement liée à la pression de sélection exercée par les
antibiotiques atteint des niveaux préoccupants et constitue une menace pour la Santé
publique.
Il est essentiel de savoir ne pas prescrire les antibiotiques en particulier en cas:
-d’infection peu sévère d’étiologie présumée virale
-d’infections urinaires asymptomatiques sur sondes.
II - Démarche thérapeutique
2.1 Indication à un traitement antibiotique
– Argument en faveur d’une maladie infectieuse et d’origine bactérienne.
– Les germes les plus vraisemblablement impliqués sont suspectés sur des éléments
cliniques: E Coli dans l’infection urinaire, streptocoque dans l’érysipèle.
– Les grandes lignes de l’épidémiologie de résistance aux antibiotiques sur les germes
suspectés sont connues.
– Un antibiotique appartenant à une classe habituellement active sur le germe est
utilisée. En plus du spectre, la localisation de l’infection est importante à prendre en
compte dans certains foyers qui limitent la diffusion d’antibiotique (méningites, infection
prostatique ou osseuse).
– Les principaux éléments de terrain utiles à la prescription doivent être connus:
insuffisance rénale, insuffisance hépatique, femme enceinte, immuno - suppression,
allergie.
2.2 Abstention thérapeutique
Dans le cadre des affections communautaires, les situations où l’abstention thérapeutique
doit être la règle sont:
la rhinopharyngite et la bronchite aiguë du sujet sain.
l’angine: elle est virale dans 80% des cas. Depuis la mise à disposition des tests
de diagnostic rapide, on ne traite plus les angines reconnus d’origine virale par ce
test en l’absence de facteur de risque de rhumatisme articulaire aigu :
antécédents de RAA entre 5 et 25 ans associés à des antécédents d’épisodes
multiples d’angine à streptocoque du groupe A ou à la notion de séjours en région
d’endémie (Afrique, DOMTOM) et éventuellement à certains facteurs
environnementaux (conditions sociales, sanitaires ou économiques).
La bactériurie asymptomatique patient sondé ou non ne relève pas d’un
traitement à deux exceptions : la femme enceinte et le transplanté rénal.
Diarrhée aqueuse présumée virale : seul un traitement symptomatique
privilégiant la réhydratation est à proposer.
Source
AFFSAPS-2008
« http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/492953895cf80422
cc6d9691c1a46347.pdf »

137
Source
AFFSAPS-2008
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/492953895cf80422cc
6d9691c1a46347.pdf
2.3 Antibiothérapie en prophylaxie
Ses indications sont bien définies.
-Antibioprophylaxie de l’endocardite
-Chimioprophylaxie de l’entourage du patient atteint de méningite
Elle est toujours de courte durée (48h). Elle obéit à des règles de prescription spécifique
(posologie, rythmes d’administration).
2.4 Faut-il faire des prélèvements bactériologiques préalables ?
En cas d’infection aiguë communautaire courante et bien tolérée, le prélèvement n’est en
général pas indispensable.
2 exceptions: la pyélonéphrite aiguë, la cystite chez la femme enceinte.
Le prélèvement est indiqué le plus souvent en cas de non réponse au traitement initial,
en présence de signe de gravité ou sur un terrain à risque.
En cas d’infection nosocomiale, les prélèvements sont indispensables pour documenter
l’infection et adapter l’antibiothérapie à des bactéries dont le profil de sensibilité aux
antibiotiques est souvent réduit.
2.5 Le terrain et les interactions médicamenteuses
Il doit être connu pour guider la prescription, exemples:
- allergie aux bétalactamines,
- grossesse qui contre indique les fluoroquinolones,
- les tétracyclines contre indiqués chez l’enfant,

138
- sujet âgé: néphrotoxicité accrue des aminosides.
Les principaux effets secondaires doivent être pris en compte exemples:
- néphrotoxicité et ototoxicité des aminosides
- tendinopathie et convulsion: fluoroquinolones
Les principales interactions médicamenteuses doivent être connues exemples :
- rifampicine et antivitamine K
- macrolides et cordarone ou sotalol: majoration du QT.
2.6 Les autres facteurs à prendre en compte pour la prescription
Le coût du traitement.
Le caractère sélectionnant de la famille d’antibiotique.
Choix de la posologie initiale: elle tient compte des facultés d’élimination et de la nature
des agents pathogènes: ex pneumocoque à sensibilité diminuée aux bétalactamines
imposant des posologies élevées.
2.7 Monothérapie ou association
Les associations permettent d’élargir le spectre antibactérien. Elles seront réévaluées une
fois le résultat des prélèvements acquis.
Elles peuvent faciliter ou accélérer l’effet bactéricide, exemple : association avec les
aminosides dans les infections sévères en début de traitement.
Elles permettent d’éviter l’émergence de mutants résistants: mycobactéries, au cours des
infections nosocomiales.
Certains antibiotiques sont proscrits en monothérapie en raison du risque de sélection:
rifampicine, fucidine, fosfomycine.
2.8 Le suivi thérapeutique
Une réévaluation du traitement antibiotique à 48h ou 72h est nécessaire.
Le rôle de proximité du pharmacien peut être utile pour détecter précocement un
accident allergique.
Paramètres de surveillance :
La courbe thermique,
La disparition des signes généraux: frissons ,
La disparition des signes cliniques locaux: toux, douleur.
Dans les situations d’infection communautaire banal, le suivi biologique est inutile.
Lors de la réévaluation à 72H :
Evolution clinique favorable avec apyrexie: on poursuit la traitement antibiotique
éventuellement en le simplifiant, monothérapie, passage à une voie orale, etc..
Evolution défavorable: plusieurs hypothèses :
Diagnostic d’infection bactérienne erroné
Le traitement: mauvaise observance, posologie inadaptée
On peut essayer d’élargir le spectre si l’infection est bien tolérée et le patient
ambulatoire.
Dans les autres cas, il est nécessaire d’avoir des prélèvements.

139
On évoque de principe: une thrombophlébite sur cathéter, une intolérance
médicamenteuse
Surveillance de la tolérance pendant le traitement antibiotique
Essentiellement clinique, elle est parfois biologique avec certaines familles d’antibiotique
en cas de traitement prolongé.
Exemple: aminoside ou glycopeptide imposant une surveillance de la fonction rénale et
des taux sériques
A distance de l’épisode aigu, il faut savoir rechercher un facteur favorisant:
cancer bronchique révélé par une bronchite, uropathie révélée après une pyélonéphrite.
2.9 Arrêter le traitement
Pour la plupart des infections, la durée de traitement est inférieure ou égale à
10 jours.
Des traitements plus prolongés sont justifiés par :
la localisation: endocardite, infection articulaire sur prothèse, abcès cérébral
la bactérie: mycobactérie, listeria, légionelle
2.10 Après l’arrêt du traitement
L’absence de rechute à l’arrêt du traitement constitue le seul critère de guérison.
Les principales causes de rechute sont:
la persistance d’un foyer infectieux inaccessible au traitement médicamenteux (ex
infection osseuse chronique) et/ou la présence d’un corps étranger,
une durée de traitement insuffisant.
AMM et recommandations (ce texte est issu du site de l’AFSSAPS ;
http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Antibiotiques/Bien-utiliser-les-
antibiotiques/(offset)/ »
« Il est possible que ces recommandations nationales ne soient pas strictement en adéquation avec
des AMM d’antibiotiques (libellés d’AMM accessibles sur le site internet de l’Afssaps, rubrique :
Répertoire des spécialités pharmaceutiques). On peut en outre constater que des décisions
européennes relatives à l’information mentionnée dans les AMM de certains antibiotiques, résultant
d’un consensus communautaire, peuvent ne pas prendre en compte pleinement des spécificités
nationales (épidémiologie, pratique médicale). En effet, des libellés d’AMM validés, notamment dans le
cadre d’un consensus européen, contiennent dans la section dédiée aux indications thérapeutiques
une liste de pathologies, sans toujours
comporter de grandes précisions sur les limites d’emploi de l’antibiotique (exemples : absence
d’information sur la reconnaissance d’une efficacité uniquement dans certaines populations, certains
groupes d’âge,
certains grades de sévérité de la pathologie,….) Cette situation est prise en compte dans la rédaction
des AMM des antibiotiques. En effet conformément à la recommandation rédactionnelle européenne,
l’information suivante figure dans toutes les AMM d’antibiotiques: « Il convient de tenir compte des
recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens». La rédaction
prévue pour toutes les AMM d’antibiotiques laisse donc l’opportunité de mieux cadrer l’utilisation de
l’antibactérien au-delà d’une « simple » énumération de maladies. Aussi, les AMM d’antibiotiques ont
une spécificité, puisque le libellé-même de ces AMM intègre le respect de recommandations de bon
usage.
Il est donc important de considérer la complémentarité de deux sources d’information,
celle des AMM et celle des recommandations de bon usage, pour disposer d’une
information optimisée sur un antibiotique tenant compte des spécificités nationales
françaises.
Ces recommandations officielles de bon usage constituent donc un moyen de cadrer l’utilisation de
l’antibiotique en fonction des spécificités nationales et de positionner le médicament dans une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%