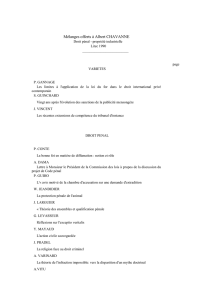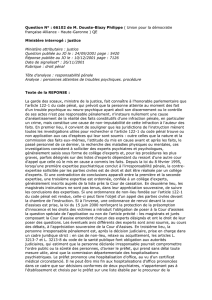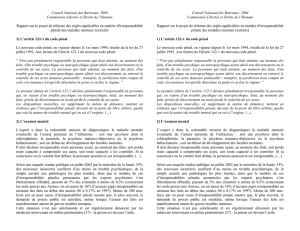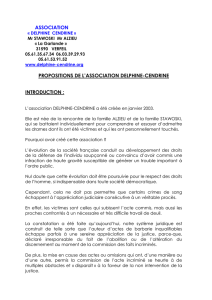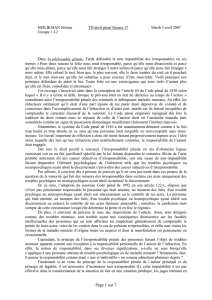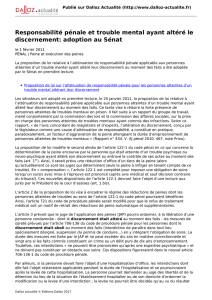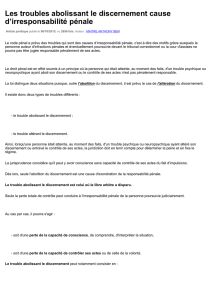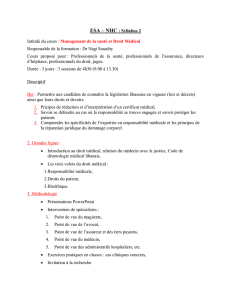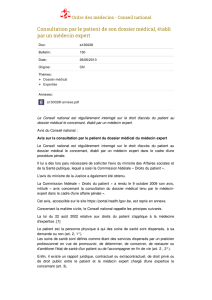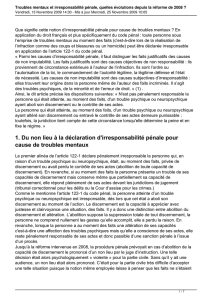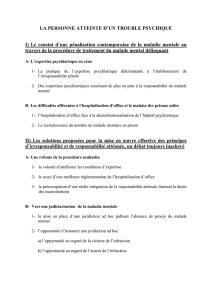Expose_Pers_Atteinte_Trouble_Psychique

1
INTRODUCTION
« La folie ou l’atteinte par les maladies, l’excès de vieillesse sont des excuses à un acte sans
elles tenu pour criminel. » Platon, livre IX.864 des lois.
La responsabilité pénale, principe fondamental de droit pénal, implique que la répression
ne peut être exercée qu’à l’encontre des personnes responsables. Ainsi, le délinquant
n’encourt pas de plein droit une sanction du seul fait qu’il a commis une infraction : encore
faut-il qu’il soit reconnu pénalement responsable.
De manière générale, la responsabilité est définie comme l’obligation de répondre des
conséquences de ses actes. En droit pénal, la responsabilité correspond plus spécifiquement à
l’obligation de répondre ou de rendre compte de ses actes délictueux en subissant une
sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Toutefois, le
concept de responsabilité pénale comprend d’autres notions importantes, parfois complexes. Il
en est ainsi des notions de culpabilité et d’imputabilité. Tandis que la notion de culpabilité
suppose l’accomplissement d’une faute au sens large, intentionnelle, soit non intentionnelle,
la notion d’imputabilité tient à un état de conscience et à une volonté libre du sujet lui-même.
Dans certaines hypothèses, la loi écarte toute déclaration de culpabilité à l’encontre d’un
individu pour lequel il existe des causes de non imputabilité (l’ordre de la loi, le
commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité, la
contrainte, l’erreur de droit) : l’individu est alors considéré comme irresponsable.
Afin de comprendre les cas d’atténuation ou de disparition de la responsabilité pénale, il est
nécessaire de parcourir rapidement son évolution :
Avec la première manifestation du droit criminel, dans les sociétés archaïques, la
responsabilité pénale a été matérialisée par une responsabilité collective, objective et
automatique. Elle correspondait à la période de la vengeance et des guerres privées, et elle
reposait sur la volonté d’établir l’ordre au sein du groupe ou du clan.
Dans les sociétés de l’Antiquité, on relève une évolution de la responsabilité pénale vers une
responsabilité individuelle et personnelle : si l’acte était le critère essentiel du déclenchement
de la responsabilité, la faute de l’auteur n’était pas ignorée.
Au Moyen Âge, le droit canonique a développé cette responsabilité individuelle : l’auteur
d’une infraction ne pouvait être sanctionné que s’il avait été reconnu moralement responsable.

2
Il en ressortait une responsabilité pénale liée à la faute morale, correspondant à la théorie
classique fondée sur le libre arbitre de l’homme, à la liberté morale de l’individu. C’est parce
que l’homme est libre et conscient que la commission de l’infraction implique la faute et par
conséquent, la responsabilité de son auteur. A contrario, lorsque l’homme n’est pas lucide ou
conscient, il ne peut disposer d’une volonté libre et dans ce cas, son comportement ne saurait
être réputé fautif.
Cependant, cette théorie classique a suscité de nombreuses critiques de la part des positivistes
de la fin du XIXe siècle. Lombroso, Garrofalo et Ferri ont estimé qu’un tel système était
irréaliste, formaliste et abstrait, et ils ont remis en cause le fondement même de la
responsabilité pénale, le libre arbitre de l’homme. En effet, si l’individu a un comportement
dangereux pour la société, il doit être déclaré responsable quel que soit son état de conscience.
La responsabilité pénale doit donc être fondée sur l’état dangereux de l’homme et non plus
sur le comportement fautif.
Si la doctrine classique de la responsabilité juridique et morale semblait trop abstraite, celle
des positivistes était excessivement déterministe. C’est avec la défense sociale nouvelle que
la notion de responsabilité pénale va évoluer dans un sens plus pragmatique.
Selon Mr Ancel, la responsabilité pénale doit être recherchée à travers la complexité du
phénomène criminel, et doit être définie, déterminée selon une démarche impliquant la prise
en compte du facteur individuel et du facteur social. Cela revient à admettre une
responsabilité individuelle par rapport à l’acte mais aussi par rapport à la personnalité de son
auteur. Ainsi, pour condamner le délinquant, le juge doit relever la responsabilité de
l’intéressé non seulement selon la référence objective de la loi mais aussi selon les éléments
subjectifs de sa personnalité.
Au delà de ces théories, il convient d’aborder les éléments qui ont guidé les rédacteurs du
Code Pénal. En effet, si l’on a pu considérer au Moyen Âge que les malades mentaux devaient
être traités de la même façon que tous les criminels, voire plus sévèrement car on pensait
qu’ils étaient possédés du démon, la conception morale et rétributive du droit pénal moderne
interdit de les punir. Dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie « aliénante » de l’esprit qui les
prive de leur libre arbitre, il serait injuste et inutile qu’ils assument au plan pénal les
conséquences de leurs actes. Injuste car ils n’ont pas eu conscience qu’ils commettaient une
infraction. Inutile, car ils sont incapables de comprendre le caractère dissuasif de la sanction.
C’est pourquoi les rédacteurs du Code Pénal de 1810 énoncèrent, dans le célèbre article 64,

3
le principe selon lequel « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence
au temps de l’action ».
La formulation de l’article 64 a cependant été très rapidement considérée comme imparfaite
pour trois raisons principales. Elle donnait tout d’abord à penser que la démence avait pour
conséquence la disparition de toute infraction, ce qui est inexact : si la responsabilité pénale
du dément ne pouvait être reconnue, une infraction avait cependant été commise. Elle laissait
croire par ailleurs que cette cause d’irresponsabilité ne concernait que les crimes et les délits,
alors qu’il fut très vite admis par la jurisprudence qu’elle concernait également les
contraventions. Enfin, le terme de « démence » était impropre car il ne correspondait pas à
son acception technique et scientifique, mais recouvrait toutes les formes d’aliénation
mentale.
Sur le fond, la règle posée par l’article 64 soulevait également de très nombreuses critiques,
dont la plus importante était qu’il laissait sans réponse le problème posé par les personnes
atteintes d’un trouble mental insuffisamment grave pour être qualifié d’état de démence, mais
de nature à influencer leur comportement et donc à diminuer leur libre arbitre. En pratique,
ces personnes étaient déclarées pénalement responsables, mais se voyaient accorder les
circonstances atténuantes. Il en résultait qu’elles étaient moins sévèrement condamnées que
des délinquants « normaux », alors même qu’elles présentaient parfois un état dangereux plus
important pour la société en raison de leur trouble mental.
Une modification de l’article 64 passant par l’abandon de son manichéisme, opposant « fou
criminel » au « délinquant sain » s’imposait. Pourtant, jusqu’à l’entrée en vigueur du
nouveau code pénal, les nombreux projets instaurant une dichotomie entre délinquant aliéné
et délinquant anormal n’ont jamais abouti. (1)
___________________________________________________________________________
(1) : outre le cas du « prévenu en état de démence au temps de l’action », le projet de code
pénal de Paul Matter de 1934 énonçait celui de « toute personne alcoolique, toxicomane ou
atteinte d’une infirmité mentale grave ». La proposition de loi des sénateurs Lisbonne et
Comboulives de 1937 envisageait « les délinquants qui sans être atteints d’aliénation mentale
comportant l’internement dans un asile, apparaissent porteurs d’une anomalie mentale
durable, nettement caractérisée, constituant une prédisposition importante à des délits
ultérieurs ». Elle s’inspirait de la loi belge de défense sociale de 1930 tout comme l’avant
projet de la loi de 1955 concernant les délinquants anormaux.

4
Présenté par une commission nationale par le professeur Levasseur, l’avant projet de 1955
fut mis au point à partir des travaux de commissions régionales chargées d’étudier les
législations et expériences étrangères en vue de l’élaboration d’une loi de défense sociale. Il
définit le délinquant aliéné dans son article 1 et le délinquant anormal à l’article 2. (1)
Enfin, l’avant projet de réforme des dispositions générales du Code Pénal, tant dans son
premier rapport diffusé en 1976 que sa présentation définitive de 1978, distingue les
personnes dites punissables, et les personnes non punissables. (2)
Le nouveau Code Pénal, dans son article 122-1 reprend cette distinction entre les effets du
trouble. S’il a entraîné une abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des
faits, l’auteur est pénalement irresponsable (alinéa 1). Si ses facultés mentales ont seulement
été altérées, l’auteur demeure punissable, toutefois la juridiction en tient compte pour la peine
(alinéa 2). (3).
___________________________________________________________________________
(1) : Délinquant anormal : « tout individu qui, par suites de troubles psychiques ou de
déficiences mentales durables altérant ses fonctions supérieures de contrôle, n’est pas
pleinement capable d’apprécier le caractère délictueux de ses actes ou de se déterminer
d’après cette appréciation ». (Art 2). Délinquant aliéné : « tout individu totalement incapable
d’apprécier le caractère délictueux de ses actes ou de se déterminer d’après cette
appréciation ». (Art 1)
(2) : Art 36 al 1 du projet de 1978 : « est punissable l’auteur, l’instigateur ou le complice
atteint, au moment de l’infraction, d’un trouble psychique qui, sans abolir son discernement
ni le contrôle de ses actes, était de nature à influencer son comportement. Art 40 al 1 du projet
de 1978 : « n’est pas punissable celui qui était atteint, au moment de l’infraction, d’un trouble
psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
(3) : Art 122-1 nouveau CP : « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte,
au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;
toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en
fixe le régime. ».

5
L’alinéa 2 est le plus novateur car il envisage l’hypothèse d’un amoindrissement du libre
arbitre. Il suit ainsi les données modernes de la criminologie et de la psychiatrie attestant qu’il
exige un large éventail de troubles psychiques modifiant partiellement le comportement
humain. La « grande charte du droit pénal » accorde donc une place aux délinquants
anormaux.
Les rédacteurs du nouveau Code Pénal n’ont donc pas repris l’ancienne formulation.
Cependant, si les nouvelles dispositions ont rendu caduques les critiques d’ordre rédactionnel
formulées à l’encontre de l’article 64, elles ne suppriment pas totalement les difficultés de
fond qui résultaient du droit antérieur.
L’article 122-1CP a apporté trois sortes de modification : d’une part, il a abandonné la
notion de démence pour retenir celle de trouble psychique ou neuropsychique ; d’autre part, il
précise que, en tant que cause d’irresponsabilité, le trouble mental interdit de réprimer toutes
les infractions, mais ne supprime pas l’existence même de l’infraction ; enfin, il distingue
désormais clairement selon que le trouble mental a aboli ou simplement altéré le
discernement.
Ce souci de différentiation de la part des rédacteurs du nouveau code appelle des précisions
quant aux définitions. En effet, de la nuance entre abolition et altération va découler une
irresponsabilité ou une responsabilité atténuée de l’auteur. L’abolition est le fait de supprimer,
de réduire à néant. En l’occurrence, soit l’individu a perdu la capacité de comprendre,
autrement dit d’interpréter ses actes dans la réalité, soit il a perdu la capacité de vouloir, c'est-
à-dire de contrôler ses actes.
En revanche, les troubles mentaux qui ne font qu’altérer le discernement entravent le contrôle
de ses actes, sans supprimer totalement son libre arbitre.
On notera que la frontière entre les deux notions est parfois ténue et difficile à établir.
Le nouveau code pénal, au terme de l’alinéa 1 de l’article 122-1 du CP exclut de toute
sanction pénale l’auteur d’une infraction atteint d’une abolition du discernement, et cette
décision fait suite à une expertise psychiatrique qui, dès l’instruction ou lors du jugement,
déclare le délinquant non accessible à la sanction pénale. L’auteur sort du champ
d’application du droit pénal et pose par conséquent, moins de difficultés d’ordre procédural.
Cependant, la victime, de fait, est privée de procès, n’acquiert pas le statut de victime, et se
trouve face à un vide, ne pouvant pas effectuer le travail nécessaire à sa reconstruction
psychologique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%