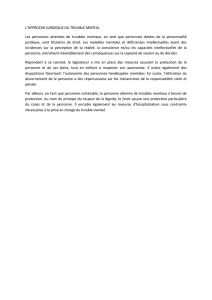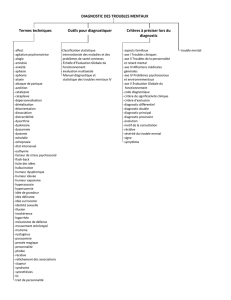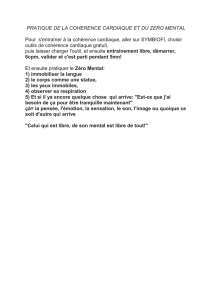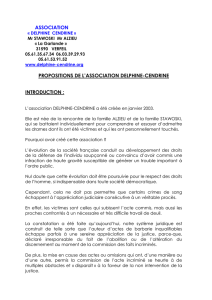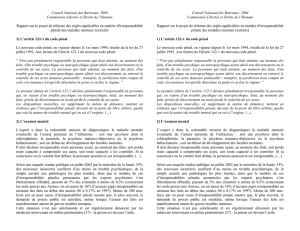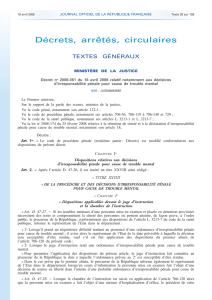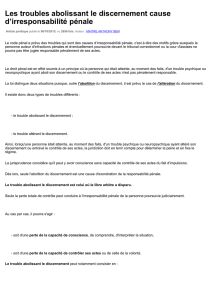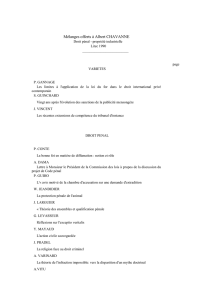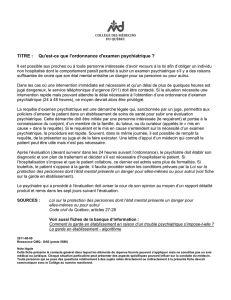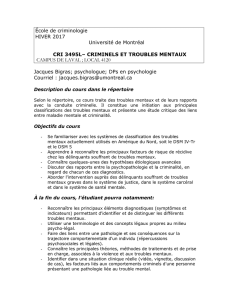PLAN - Faculté de Droit de Nantes

LA PERSONNE ATTEINTE D’UN TROUBLE PSYCHIQUE
I) Le constat d’une pénalisation contemporaine de la maladie mentale au
travers de la procédure de traitement du malade mental délinquant
A- L’expertise psychiatrique en crise
1- La pratique de l’expertise psychiatrique déterminante à l’établissement de
l’irresponsabilité pénale
2- Des expertises psychiatriques concluant de plus en plus à la responsabilité du malade
mental
B- Les difficultés afférentes à l’hospitalisation d’office et le malaise des prisons asiles
1- l’hospitalisation d’office face à la désinstitutionalisation de l’hôpital psychiatrique
2- La recrudescence du nombre de malade mentaux en prison
II) Les solutions proposées pour la mise en œuvre effective des principes
d’irresponsabilité et de responsabilité atténuée, un débat toujours inachevé
A- Une refonte de la procédure souhaitée
1- la volonté d’améliorer les conditions d’expertise
2- le souci d’une meilleure réglementation de l’hospitalisation d’office
3- la préoccupation d’une réelle intégration de la responsabilité atténuée limitant la durée
des incarcérations
B- Vers une judiciarisation de la maladie mentale
1- la mise en place d’une juridiction ad hoc palliant l’absence de procès du malade
mental
2- l’opportunité d’instaurer une juridiction ad hoc
a) l’opportunité au regard de la victime de l’infraction
b) l’opportunité au regard de l’auteur de l’infraction

LA PERSONNE ATTEINTE D’UN TROUBLE PSYCHIQUE
INTRODUCTION
Selon Gérard Cornu, la responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions
commises et de subir les peines prévues par le texte qui les répriment. La responsabilité
pénale suppose donc de l’auteur un acte intentionnel c’est- à -dire commis en conscience et
volonté, celui-ci devant être capable de comprendre et vouloir son acte. C’est seulement à
cette condition que pourra lui être imputée l’infraction. Si tel n’est pas le cas, la justice
décidera que l’auteur n’est pas punissable c’est-à-dire irresponsable. Ne pourra alors lui être
imputée aucune infraction.
Ce concept d’irresponsabilité découle d’un fondement morale du droit pénal selon lequel ce
n’est que sous couvert de discernement et de libre arbitre que des poursuites sont possibles.
Notre droit pénal connaît trois causes d’irresponsabilités, appelées aussi causes subjectives
d’irresponsabilité : le trouble psychique ou neuropsychique qui nous intéresse aujourd’hui, la
contrainte et l’erreur. Le trouble psychique se définit comme une altération des facultés
mentales qui atteint l’intelligence ou la volonté d’un individu.
Traditionnellement, notre droit considère l’individu atteint d’un trouble mental comme
irresponsable. En effet, privé de discernement et de libre arbitre au moment de l’acte, il
apparaîtrait alors injuste et inutile qu’il assume au plan pénal les conséquences de ses actes.
Injuste car il n’a pas eu conscience qu’il commettait une infraction, et inutile car incapable de
comprendre le caractère dissuasif de la sanction.
Le principe d’irresponsabilité pénale n’est pas à proprement parlé inscrit dans le code pénal. Il
découle de l’évidence des articles 122-1 et 122-2 de ce même code.
D’ailleurs, les malades mentaux n’ont pas toujours été considérés de la même manière par le
droit criminel. Ainsi, en droit romain, le fou reste impuni car il n’a pas eu d’intention et est
suffisamment sanctionné par sa maladie. Au contraire, le Moyen Age considérait les fous
comme possédés par le démon et donc soumis aux peines de droit commun. Le principe
d’irresponsabilité fut ensuite repris par le droit canonique puis par le droit laïc au 18ème siècle
grâce à différents travaux comme ceux de Pinel et d’Esquirol qui introduisirent une nouvelle
conception de la folie. Elle devint une maladie mentale dite « aliénante » de l’esprit qui prive
ceux qui en sont atteint de leur libre arbitre et donc de leur responsabilité pénale.
Le code pénal de 1810 a suivi cette nouvelle conception faisant échapper le dément à toute
répression par son article 64 selon lequel : « il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était
en état de démence au temps de l’action. » Cependant, la formulation de l’article 64 s’est
révélée très rapidement inadaptée. En effet, grâce aux progrès de la psychiatrie, le terme
démence s’est vu donné un sens médical précis ne permettant plus de recouvrir toutes les
formes d’aliénation mentale. D’autre part, la formulation « ni crime, ni délit » n’englobait pas
les contraventions et laissait croire qu’aucune infraction n’avait été commise provoquant des
difficultés pour retenir la culpabilité d’éventuels complices de l’aliéné. Enfin, l’article 64 ne
prenait pas en compte le cas des personnes atteintes de troubles mentaux insuffisamment
graves pour être qualifiés d’état de démence mais de nature à influencer le comportement et
donc à altérer le libre arbitre. Ces personnes étaient alors déclarées responsable mais
bénéficiaient parfois de circonstances atténuantes. Cette pratique des magistrats était issue de
la circulaire Chaumier de 1905 qui invitait les juges à adapter la notion de démence aux
progrès de la psychiatrie, en prenant en compte des troubles mentaux qui restaient en dehors

de son domaine d’application lors de la détermination de la peine. Toutefois, ce système était
fortement critiqué en raison de son caractère artificiel et arbitraire.
Les rédacteurs du nouveau code pénal ont donc modifié l’article 64 devenu l’article 122-1.
La notion de démence est alors abandonnée au profit de celle de « trouble psychique ou
neuropsychique » plus large. De même, toutes les infractions sont visées et est prévu
expressément la situation intermédiaire d’un trouble mental ayant seulement altéré et non
aboli le discernement.
L’article 122-1 du code pénal suppose trois conditions pour retenir l’irresponsabilité pénale:
un trouble mental, ayant aboli ou altéré le discernement, et enfin, un trouble mental existant
au moment des faits.
Un trouble mental d’abord, il est vu au sens large par le législateur consacrant ainsi
l’interprétation extensive que la jurisprudence en faisait. Il vise donc tous les troubles
mentaux quelque soit leur origine ou leur nature. Il peut s’agir de lésions congénitales,
psychiques ou accidentels entraînant des formes d’arriération mentale, la détérioration de
capacités mentales ou des troubles du comportement. Ce peut être aussi des maladies
mentales n’impliquant pas de lésions telles la schizophrénie, paranoïa et autres psychoses
maniaco dépressive. Enfin, il peut s’agir de troubles non pathologiques comme le
somnambulisme, un état alcoolique ou un comportement dû à la prise de stupéfiants.
Un trouble mental ayant aboli ou altéré le discernement ensuite.
Pour conclure à l’irresponsabilité totale selon l’alinéa 1, le trouble doit avoir aboli le
discernement ou le contrôle des actes. Selon messieurs Desportes et Le Gunehec cela signifie
la nécessité de perdre soit la capacité de vouloir, c’est-à-dire la capacité des contrôler ses
actes, soit la capacité de comprendre, c’est-à-dire la capacité d’interpréter ses actes dans la
réalité. Seul l’absence d’un de ces deux éléments suffit à engager l’irresponsabilité.
Le trouble mental peut avoir aussi simplement altéré le discernement ou entravé le contrôle
des actes. C’est alors l’alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal qui sera mis en œuvre, la
présence du trouble pourra alors être pris en compte dans le quantum de la peine. Il s’agit de
la situation intermédiaire dans laquelle le trouble mental n’a pas complètement privé
l’individu de discernement pour permettre l’irresponsabilité. Mais c’est aussi la situation la
plus difficile à qualifier pour l’expert notamment car, comment déterminer avec certitude la
frontière entre le délinquant normal et celui dont le discernement est simplement altéré
notamment dans le cas des intoxications volontaires telles l’alcool ou la drogue. L’absorption
de ces produits ne provoque pas une perte totale de contrôle mais entraîne une diminution des
inhibitions sociales et peuvent donc être considérés comme altérant le discernement. Si
l’article 122-1 alinéa 2 interprété à la lettre n’écarte pas la prise en compte de ces
comportements, l’intention du législateur est différente car il incrimine directement la
conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou encore la prise de stupéfiants. Ce qui montre sa
volonté de ne pas faire bénéficier ces comportements d’une atténuation de la répression par
l’article 122-1 et la jurisprudence l’a bien compris puisqu’elle ne considère pas l’ivresse
comme entrant dans le cadre des troubles mentaux.
Enfin, le trouble mental doit avoir existé au moment des faits. Ce qui veut dire aussi qu’il doit
avoir une relation causale avec l’infraction, c’est à cause de lui que l’infraction a été
perpétrée.
A noter que si le trouble mental est postérieur aux faits alors que la procédure est en cours,
celle-ci est suspendue car l’individu se trouve alors dans l’impossibilité de se défendre.

L’instruction peut toutefois se poursuivre sauf s’il s’agit d’interroger le mis en cause. Si la
personne retrouve sa lucidité, la procédure peut alors reprendre.
La preuve de l’irresponsabilité pénale ou de l’atténuation de responsabilité se fera au moyen
de l’expertise psychiatrique.
L’irresponsabilité pour trouble mental pourra être constatée à tous les stades de la procédure.
Si elle intervient lors de l’instruction, une décision de non lieu sera prononcée par le juge
d’instruction. Si elle intervient lors du jugement l’intéressé fera l’objet d’une décision de
relaxe si c’est la tribunal correctionnel ou d’acquittement si c’est la Cour d’Assises. Le
parquet peut aussi décider de classer sans suite l’affaire et renoncer à engager des poursuites
tout en amont de la procédure.
En cas d’irresponsabilité totale, deux options s’offrent alors : soit la personne est remise en
liberté, soit, si elle présente un état de dangerosité suffisant, elle fera l’objet d’une procédure
d’hospitalisation d’office.
Dans le cas d’une responsabilité atténuée, la personne est supposée condamnée moins
sévèrement du fait du trouble mental, elle ira alors en prison s’il s’agit d’une peine privative
de liberté.
Dans tous les cas, la personne demeure cependant civilement responsable de ses actes et des
dommages et intérêts pourront être alloués aux victimes (article 489-2 CC).
Si le mécanisme de l’article 122-1 semble bien rodé, il n’en demeure pas moins qu’il fait face
aujourd’hui à de nombreuses difficultés.
Difficultés qui ont conduit ces dernières années à un phénomène de pénalisation de la
maladie mentale : des expertises psychiatriques en crise, un manque de prise en charge du
malade, un manque de considération des victimes, des prisons devenues des asiles… Le débat
s’est ainsi cristallisé autour de la responsabilité pénale du malade mental, ceux plaidant pour
la citoyenneté du malade et souhaitant le voir assumer ses actes s’opposant à ceux qui
trouvent intolérable de voir un psychopathe passer de longues années en prison alors que ses
actes et son discours paraissent infiltrés d’aliénation.
Voyons donc au travers de la procédure qui permet de mettre en œuvre l’irresponsabilité
pénale, comment celle-ci semble incapable de soustraire efficacement le malade mental de sa
responsabilité et provoquer ce phénomène de pénalisation de la maladie mentale. Ce sera
l’objet de notre grand (I).
Puis voyons quelles solutions ont été proposées aux défaillances du système, qui intéressera
notre grand (II). Solutions qui ont été énoncées au terme d’un rapport de 2005 intitulé « santé
justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive » dirigé par M. Burgelin.
Celui-ci fut lui même inspiré d’un rapport de 2003 de la direction des affaires criminelles et
des grâces relatif à une possible réforme des règles applicables en matière d’irresponsabilité
pénale.
Enfin, nous verrons si ces propositions permettront de tout régler.

I) Le constat d’une pénalisation contemporaine de la maladie mentale au travers de la
procédure de traitement du malade mental délinquant.
A- L’expertise psychiatrique en crise
1- La pratique de l’expertise psychiatrique déterminante à l’établissement de
l’irresponsabilité pénale.
L’existence d’un trouble mental constituant une cause d’irresponsabilité n’est jamais
présumée, il doit être prouvé.
Cette preuve se fera au moyen de l’expertise psychiatrique qui au terme de l’article 156 du
CPP pourra être ordonnée par toute juridiction d’instruction ou par toute juridiction de
jugement soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties.
L’officier de police judiciaire peut également ordonner une expertise psychiatrique en cas
d’enquête de flagrance, elle se fera le plus souvent au cours de la garde à vue. En d’autres
termes, peuvent ordonner une expertise, en matière de crime et de délit, l’officier de police
judiciaire lors de l’enquête de flagrance, le juge d’instruction, la chambre de l’instruction et le
parquet lors de la phase préliminaire, puis le président de la chambre correctionnelle ou le
président de la cour d’assises lors de la phase de jugement. L’expertise psychiatrique est
d’ailleurs obligatoire en matière criminelle. Enfin, en matière contraventionnelle, une
expertise peut être ordonnée par le tribunal de police pour des contraventions de 5ème classe,
mais celles-ci sont rares.
Les éléments qui poussent le magistrat ou la juridiction à recourir à l’expertise psychiatrique
ont souvent trait aux circonstances qui entourent l’infraction ou son contexte. Ce peut être par
exemple l’absurdité du but et des moyens de l’infraction, l’absence de précautions prises par
l’auteur pour échapper aux recherches et aux sanctions ou encore la discordance entre la
conduite du moment et le comportement antérieure.
Quoi qu’il en soit lorsqu’il est désigné par le magistrat, l’expert se doit de remplir sa mission
principale qui sera d’établir ou non l’existence de troubles mentaux chez l’intéressé au
moment des faits afin de conclure ou non à la responsabilité de celui-ci.
En pratique, seront posées à l’expert par le magistrat des questions telles que : la présence ou
non de troubles mentaux chez l’individu, la relation entre ces troubles et les faits reprochés,
s’il existe une abolition ou une altération du discernement, si la personne présente ou non un
état dangereux, son accessibilité à une démarche de soins ou une sanction pénale…
De manière très concrète l’expertise psychiatrique se déroule en trois étapes : l’examen du
dossier pénal, l’examen du sujet et la rédaction du rapport.
L’examen du dossier pénal peut se révéler intéressant pour l’expert en ce qu’il va lui donner
des indications précieuses sur la personnalité de l’individu. Cela pourra être des demandes
fréquentes de changement d’avocat ou encore le ton et le style des courriers personnels, les
enquêtes de personnalité ou expertise médico-légale déjà effectuées, mais aussi des pièces
faisant état des incidents survenues, le cas échéant, au cours de la détention provisoire comme
des violences ou des crises.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%