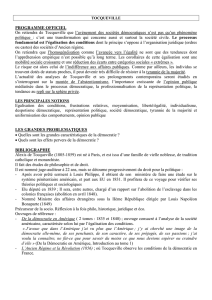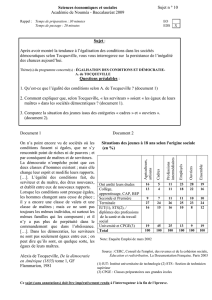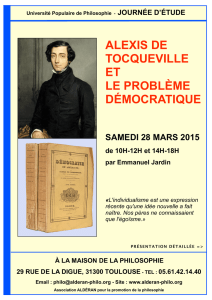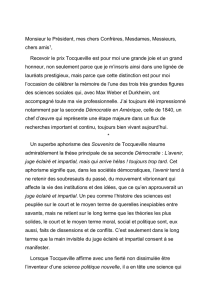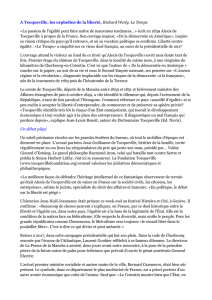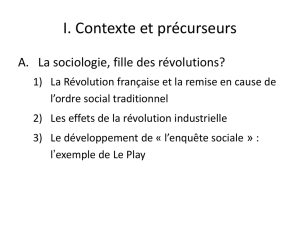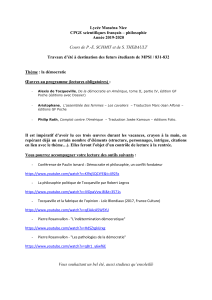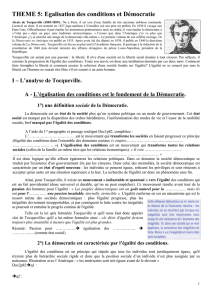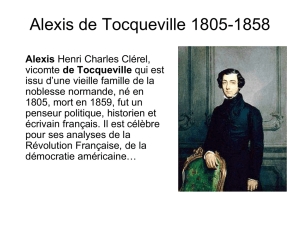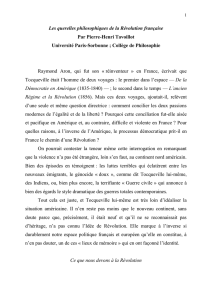Tocqueville et les dangers de l`individualisme

1
1
MASTER 1- Philosophie politique
Cours commun : Pr. Jean-Michel BESNIER
Les pages qui suivent sont destinées à compenser les séances des 7 et 10 mars 2006 qui n’ont
pu avoir lieu. Ces séances devraient être suivies par deux cours sur Nietzsche.
Tocqueville et Nietzsche sont convoqués dans la réflexion proposée par le cours commun (J-
M. Besnier, A. Boyer et A. Renaut) sur la raison pratique dans la mesure où ils occupent une
place de choix dans la mise en question de la subjectivité et de la volonté et, par conséquent
dans celle du point de vue moral. On examine ci-dessous le statut de l’individualisme tel que
Tocqueville est conduit à le décrire et, au-delà, la manière dont les idéaux démocratiques se
trouvent problématisés. Peut-être sera-t-il permis, par la suite, d’aborder le thème
tocquevillien de l’avenir, sachant qu’il est décisif de savoir si l’homo democraticus peut se
dispenser d’associer morale et sens du projet. Par la suite, on examinera le rapport de
Nietzsche aux valeurs et on focalisera l’attention également sur sa prise en charge du thème
de l’avenir.
Tocqueville et les dangers de l'individualisme
Ceci doit être clairement énoncé, faute de quoi l'essentiel de la
philosophie tocquevillienne risque d'échapper : I'individualisme n'est pas une
force mais au contraire une faiblesse. Contrairement à ce que croient souvent
les actuels thuriféraires du libéralisme, opposer l'individu à l'État — quelque
forme que l'opposition revête (privé/public, liberté d'entreprendre/bureaucratie,
etc.) — n'est pas une solution et témoigne même d'un certain aveuglement. S'il
est une leçon claire dans De la Démocratie en Amérique, elle concerne le
destin prévisible de l'individu livré à lui-même et cette leçon conserve
assurément toute sa portée aujourd'hui.
En décrivant la situation propre aux siècles démocratiques, Tocqueville
ne peut s'empêcher d'avouer sa crainte devant l'absence de points de repère,
la disparition des règles pré-tracées que portent les rites et les traditions dans
les sociétés aristocratiques. En démocratie, le citoyen n'a plus la possibilité de

2
2
se situer autrement que par rapport à lui-même; il est devenu sa propre
mesure. Or, cette émancipation par rapport à la tutelle d'un ordre — celui de
l'Ancien Régime — qui imposait son organisation et la fondait sur quelque
réalité transcendante, cette émancipation est lourde à porter. De sorte que
l'individu triomphant apparaît plus démuni et vulnérable que jamais; faute d'être
désormais réceptif à la symbolique, aux rituels et aux lois qui cimentaient jadis
la coIIectivité, il se voit condamné à l'atomisation. Individu, il l'est certes, mais
au sens où l'on désigne par là un représentant, n'importe quel représentant, de
l'espèce humaine; égal à son voisin, il l'est assurément, mais au sens où l'un
vaut l'autre, où nul n'est plus irremplaçable dans un monde réduit à
l'équivalence généralisée des biens et des hommes, ce que Herbert Marcuse
désigne comme "I'univers de l'unidimensionnalité"; libre, enfin, I'homo
democraticus — I'"homo aequalis", selon I'expression utilisée par
l'anthropologue Louis Dumont — le demeure pour autant qu'il parvient à
résister à la foule de ses semblables, au mouvement d'assimilation et
d'homogénéisation des comportements individuels que GiIIes Lipovetsky a
récemment baptisé "I'ère du vide". Mais Tocqueville est bien pessimiste quant
aux chances de l'individu dont il perçoit avec acuité la tendance à surestimer le
poids de la société pour mieux justifier sa faiblesse et son inertie. Avec le
développement des démocraties, le citoyen glissera bientôt de l'enthousiasme
pour la société libératrice aux litanies plaintives : "C'est la faute à la société !"
Car l'individualisme a décidément pour corrélat le sentiment d'une omnipotence
du tout social : "A mesure que les conditions s'égalisent chez un peuple, les
individus paraissent plus petits et la société semble plus grande, ou plutôt
chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd dans la foule, et
l'on n'aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même." (11,
356)
N'en déplaise, encore une fois, à ceux qui attendaient de l'aristocrate
déchu qu'il fasse nécessairement l'apologie de l'individualisme : Tocqueville est

3
3
beaucoup trop soucieux des libertés politiques, c'est-à-dire de l'exercice public
de la volonté, pour ne pas redouter le repli sur soi de l'individu.
De fait, abandonné à lui-même, "n'ayant ni supérieurs, ni inférieurs, ni
associés habituels et nécessaires", I'homme se met à vivre comme une
monade "sans portes ni fenêtres" (Leibniz); il désinvestit la chose publique,
déserte l'espace socio-politique et se laisse peu à peu aIIer à abandonner le
soin des affaires communes au seul représentant visible et permanent des
intérêts coIIectifs, autrement dit : à l'État (cf. II, 359). C'est ainsi que
l'individualisme implique la désaffection des libertés politiques et qu'il impose la
demande d'un État vigilant et prévoyant. Mais comment en serait-il autrement
dans un contexte où chacun fait l'expérience de sa faiblesse et cherche, par
conséquent, à préserver ses intérêts propres en consacrant tout son temps à
leur gestion et promotion ? Parlant de ceux qui vivent en démocratie,
Tocqueville avoue son scepticisme désabusé : "Non seulement ils n'ont pas
naturellement le goût de s'occuper du public, mais souvent le temps leur
manque pour le faire." (II, 359)
L'individualisme finit par être franchement inquiétant dès lors qu'il
encourage les hommes à se reposer sur l'État des soucis coIIectifs. En effet,
jaloux de leur intimité et vivement désireux d'assurer leur confort, ceux-ci vont
bientôt désirer un État fort pour protéger leur personne et leurs biens. Par où
l'on voit combien l'indépendance, loin de signifier l'autonomie, peut au contraire
équivaloir à l'asservissement. La quatrième partie du second volume de La
Démocratie décrit précisément la logique qui conduit de l'individualisme à la
concentration d'un pouvoir de plus en plus tentaculaire : "L'amour de la
tranquillité publique est souvent la seule passion politique que conservent ces
peuples, et elle devient chez eux plus active et plus puissante, à mesure que
toutes les autres s'affaissent et meurent; cela dispose naturellement les
citoyens à donner sans cesse ou à laisser prendre de nouveaux droits au
pouvoir central, qui seul leur semble avoir l'intérêt et les moyens de les

4
4
défendre de l'anarchie en se défendant lui-même." (II, 360)
Voilà comment, en favorisant l'individualisme, la démocratie risque de
faire le lit du despotisme. Avant Tocqueville, il était entendu qu'en se
corrompant la démocratie engendrait son contraire : Aristote avait révélé le rôle
joué par les démagogues dans cette dégénérescence; Montesquieu avait mis
l'accent sur la responsabilité de "I'esprit d'égalité extrême" dans l'installation du
despote. L'auteur de La Démocratie qui connaît ses classiques incrimine avant
tout l'aveugle désir de sécurité et, en cela, il éveiIIe sans doute plus d'un écho
dans notre contemporanéité souvent frileuse. En tous cas, il n'a pas son pareil
pour décrire l'apparition insidieuse du despotisme au sein des démocraties
sans ressort coIIectif ni volonté de s'auto-instituer. Citons par exemple le
portrait qu'il propose, dans L'Ancien Régime et la Révolution (I, 213), des
enfants de 1789 : "Un peuple composé d'individus presque semblables et
entièrement égaux, cette masse confuse reconnue pour le seul souverain
légitime, mais, soigneusement privée de toutes les facultés qui pourraient lui
permettre de diriger et de surveiller elle-même son gouvernement. Au-dessus
d'elle, un mandataire unique, chargé de tout faire en son nom sans la
consulter." De là à l'avènement de l'État absolutiste ou policier, il n'y a qu'un
pas : franchi dès lors que "les occasions d'agir ensemble" ont disparu et que
dominent l'isolement et l'indifférence entre les hommes (cf. II, 131-132).
Au fond, c'est peut-être que l'homme des démocraties attend de l'État
qu'il le désigne comme individu. Peut-être l'État apparaît-il, dans les
démocraties, comme la dernière transcendance qui puisse conférer une
identité... Si tel est le cas, il n'y a jamais trop d'État. Ainsi que l'écrit Marcel
Gauchet; "L'État est le miroir dans lequel l'individu a pu se reconnaître dans
son indépendance et sa suffisance, en se dégageant de son insertion
contraignante dans les groupes réels."
1
Bref, dans cette logique,
I'individualisme s'alimenterait aux efforts tentaculaires déployés par l'Etat
1
M. Gauchet, « Tocqueville, l’Amérique et nous », in Libre, 80-7, éditions Payot., p. 106

5
5
gestionnaire de l'activité des hommes et on comprendrait qu'à terme, rien
n'arrêtera "le bras du gouvernement [qui] va chercher chaque homme en
particulier au milieu de la foule pour le plier isolément aux lois communes". M.
Gauchet résume avec force ce paradoxe qui scelle la solidarité entre
l'affirmation de l'individu et l'emprise croissante de l'État : "Dérisoire entreprise
que d'opposer l'individu à l'État, alors qu'ils sont termes strictement
complémentaires, dont l'apparente rivalité n'est que le moyen de se renforcer
l'un l'autre. Toujours plus d'individu, toujours plus d'État. L'un ne décroîtra pas
sans que l'autre recule." On ne saurait s'exprimer plus clairement.
C'est probablement sur le terrain de la critique de l'individualisme que
Tocqueville nous est le plus contemporain. Le lecteur d'aujourd'hui y déchiffre
ce qui a fécondé pour une bonne part la pensée anti-totalitaire du XXè siècle :
nul mieux que Tocqueville ne saurait iIIustrer le thème de la fragilité des
démocraties et annoncer, derrière la démission des libertés politiques et le
désintéressement de la chose publique, la brèche dans laquelle risque de
s'engouffrer l'État totalitaire. Sa méfiance à l'égard de l'individualisme suffit à
suggérer, comme le dit encore M. Gauchet, que "les démocraties portent en
elles, constitutivement, leur négation totalitaire virtuelle. La possibilité du
totalitarisme est de naissance inscrite dans les démocraties telles qu'elles se
sont développées sur le Vieux Continent". On soupçonnera peut-être les
critiques du totalitarisme de "récupérer" abusivement la pensée de Tocqueville.
Reste qu'il y a certaines pages dans La Démocratie qui témoignent d'une
espèce de vision prémonitoire ou, en tout cas, d'une formulation anticipatrice
de ce que le XXè siècle a dû affronter; par exemple, celle-ci dans laquelle
Tocqueville dévoile la radicale nouveauté de ce qui menace les démocraties
ainsi que son inéluctable imminence : "Je pense (...) que l'espèce d'oppression
dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui
l'a précédée dans le monde; nos contemporains ne sauraient en trouver l'image
dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%