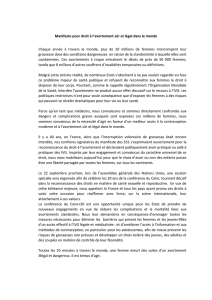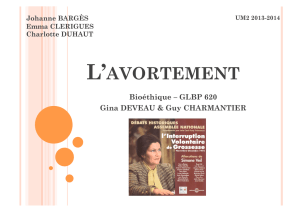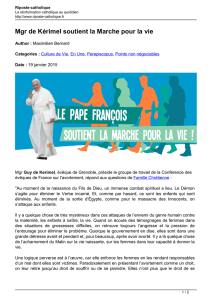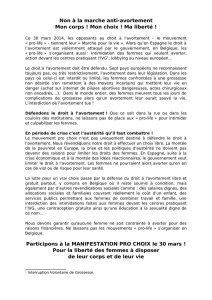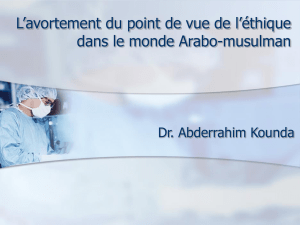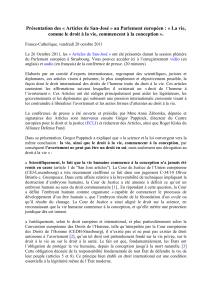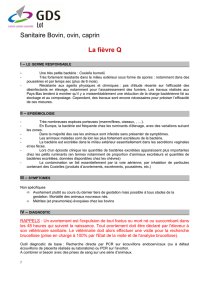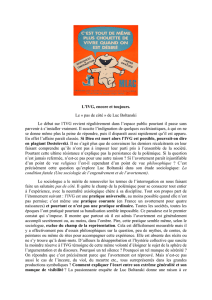connaissance des sciences

CONNAISSANCE DES SCIENCES
La médecine
Trois questions très importantes : le clonage, l’avortement et l’euthanasie (Belgique et
Pays Bas = légalité de l’euthanasie).
Bibliographie :
- Jean Charles SOURNIA, Histoire de la médecine, 1997, Edition La Découverte.
- Bruno HALIOUA, Histoire de la médecine, 2001, Edition Maçon.
- Jacques RUFIE et Jean Jacques SOURNIA, Les épidémies dans l’Histoire de
l’Homme, 1995, Edition Flammarion.
La médecine moderne est inventée par les grecs, notamment Hippocrate.
I. La médecine incantatoire.
La médecine a toujours existé. A la préhistoire, il existait déjà des rudiments
de médecine, les hommes essayaient de soigner leurs blessures. On sait, d’après les
squelettes trouvés, qu’ils savaient réduire les fractures.
Pendant très longtemps, ce sont les prêtres qui ont exercé la médecine. Etaient
malades, tous ceux qui étaient punis, la maladie était une punition divine.
Néanmoins, même à cette époque là, la médecine n’est pas exclusivement exercée par
les prêtres, puisque les actes chirurgicaux sont exercés par les barbiers. La chirurgie a
été pendant longtemps déconsidérée, les médecins refusaient d’opérer les patients
car toucher le malade n’était pas noble. Le médecin avait un savoir et en regardant et
en écoutant le malade, il était capable de dire ce dont le malade souffrait.
On trouve les premières traces de cette médecine en Mésopotamie et
notamment à Babylone sous le règne de Hammourabi (1790-1750 avant JC). A cette
époque, certains Dieux ont une fonction médicale et des démons responsables des
maux. On trouve : un dieu guérisseur, un dieu des eaux, le démon de la fièvre, le
démon des infections,… Les prêtres étaient chargés de découvrir la faute commise et
d’en obtenir l’expiation. Ils procédaient à la lecture des oracles afin de savoir quel
démon était responsable de la maladie, le prêtre sacrifiait un animal, puis lisait dans

son foie afin de faire un diagnostic. On regardait le foie car c’est l’organe de la pensée
et des sentiments. Le prêtre lavait ensuite le malade pour le purifier de ses péchés et
récitait les formules incantatoires. A cette époque, les médecins ont aussi quelques
connaissances médicales puisqu’ils élaborent des potions à partir de plantes aux
vertus médicinales, ils pratiquent la chirurgie (y compris esthétique).
Dans le Code d’Hammourabi, on trouve déjà des dispositions concernant le
corps médical. Le code fixe des sanctions en cas d’erreur médicale et aussi des
honoraires médicaux. Par exemple, si un médecin opère un abcès de l’œil et qu’il
crève l’œil par erreur, alors le médecin est condamné à mort.
A la même période, se développe la médecine Egyptienne qui va mélanger des
connaissances scientifiques réelles avec des pratiques incantatoires. On a retrouvé en
Egypte, des traités de cardiologie, de gynécologie, de pharmacologie,… Ils avaient
compris qu‘il existait un lien entre le pouls et les battements du cœur, et
connaissaient la circulation sanguine. On perd toutes ces connaissances à l’entrée
dans le Moyen Age. Il existe aussi une médecine reliée aux Dieux. Ils considèrent que
les maladies viennent de plusieurs choses : les excès de boissons et de nourriture
(lavement,…), le vent (le vent véhicule des démons qui peuvent apporter des
maladies). Les égyptiens croyaient aussi que les vers étaient des agents pathogènes
qui transmettaient des maladies. On trouvait ces vers dans les matières fécales et
remontaient dans le corps par nos vaisseaux. On retrouve cette imbrication de la
sciences et de la religion dans le rôle joué par certains dieux ( Seth = dieu du mal et
des maladie ; Hator = déesse des femmes et de la fécondité ; Sekhmet = Dieu
responsable des épidémies) d’où le fait que la médecine soit pratiquée par les
médecins et par les prêtres. Il existe à cette époque une spécialité des médecins :
médecins généralistes / médecins spécialisés. Le savoir se transmettait de génération
en génération, on était médecine de père en fils. Les médecins sont responsables de
leurs actes et pouvaient être condamnés à mort. L’apport de la médecine égyptienne

se situe sur le terrain de la connaissance anatomique puisqu’ils ont été les premiers à
comprendre le rôle vital des poumons, à avoir compris que le foie était un organe
indispensable à la digestion et compris le lien entre le pouls et les battements du
cœur. La renommée de la médecine est telle que pendant 3 ans, un jeune médecin
grec va venir faire « un stage » et ce médecin s’appelle Hippocrate. Il va voir
comment les égyptiens soignent et va en retirer de grandes conséquences à son
retour en Grèce.
II. Les Grecs, précurseurs de la médecine moderne.
L’histoire de la médecine grecque est marquée par une rupture entre une
médecine fondée sur la religion et une médecine laïque totalement fondée sur la
religion. Pendant la première période qui va jusqu’au 6ème siècle avant JC, les dieux
sont très présents notamment Esculape ou Asclépios (c’est le fils d’Apollon).
C’est le dieu de la médecine, il était représentait avec un bâton de pèlerin
surmonté d’un serpent ; il se promenait avec son bâton et à se moment là, il rencontre
un serpent qui s’enroule autour du serpent et il l’assomme, à ce moment là un autre
serpent arrive et offre une plante au premier serpent qui le guérit = origine du
caducée. A ce moment là, on pense que seuls les Dieux sont capables de rendre les
hommes malades et donc de les guérir. Il fallait consulter les oracles pour connaître
la maladie dont souffrait le patient et pouvoir éventuellement le guérir. Rituel : le
patient vient au temple, et prend un bain au coucher du soleil et le prêtre sacrifie un
coq ou un moineau à Asclépios, le patient va ensuite se coucher après avoir bu une
tisane qui favorise le sommeil ; pendant la nuit, le prêtre qui a revêtu la tenu
d’Asclépios vient rendre visite au malade pour lui donner un remède. Le lendemain
matin, le patient se réveille et est guéri. En échange, le malade donnait un présent au
temple.
A partir du 5ème siècle va se développer la médecine laïque grâce à ce qu’on
appelle l’Ecole de Cos fondée par Hippocrate Le Grand, appelé parfois : Hippocrate de

Cos. Hippocrate était le fils d’un prêtre médecin issu d’une famille qui pratiquait la
médecine incantatoire selon le mythe d’Asclépios. Hippocrate voyage et à son retour
d’Egypte, il veut rompre avec cette médecine lorsqu’il prend conscience que la
maladie n’a pas d’origine divine mais provient d’un disfonctionnement du corps. Il
fonde alors une école dans laquelle il va enseigner cette médecine laïque et
transmettre tout son savoir scientifique. On mettra très très longtemps avant de
remettre en cause sa médecine.
La médecine d’Hippocrate repose sur plusieurs principes. D’après lui, seules
des connaissances approfondies sur la nature de l’Homme, sur son environnement et
sur leurs relations réciproques permettent d’identifier et de comprendre les
mécanismes des maladies. Il existe donc une interaction entre l’homme et son
environnement. Pour Hippocrate, il était également indispensable de connaître la
cause de la maladie et sa conséquence mais également de regarder les réactions de
défense du corps humain qui étaient selon lui, un moyen de lutter contre l’infection.
Il avait également mis en évidence le fait que la fonction vitale de l’organisme était lié
à la production d’humeur (le sang, la bile,…) et que l’excès de production de ces
humeurs pouvaient entrainer une maladie. Pour lui, cette rupture d’équilibre au sein
du corps humain, pouvait avoir une cause interne au malade : l’âge, des problèmes
congénitaux, la race,… Il pouvait aussi y avoir des causes externes : la qualité de
l’eau, les saisons, le vent,… Hippocrate a aussi monté comment évoluait la maladie
(n’a pas été remis en cause) en distinguant la phase d’incubation, la phase critique et
une phase de résolution au cours de laquelle la maladie s’évacue par les urines et par
les selles.
Hippocrate a également apporté sa vision de l’examen du malade (n’a pas été
remis en cause) qui comprend 4 phases :
- recherche des antécédents du malade
- recherche des troubles généraux de la maladie,
- recherche de signes locaux et visibles,

- le médecin doit examiner méticuleusement le malade pour essayer d’établir
son diagnostic.
Par la suite, l’enseignement d’Hippocrate est contenu dans un recueil Corpus
Hippocraticum et sera transmis pendant tout le 18ème siècle. Hippocrate fixe les actions
du médecin. Pour lui, le médecin doit avoir été formé par des maîtres, il doit
connaître la nature du corps humain, sa composition, son anatomie, et ses réactions
face à la maladie. A ce titre, Hippocrate condamne les charlatans (ceux qui pratiquent
la médecine sans formation) qui sont selon lui un danger pour les patients. Il
considère aussi que le savoir théorique enseigné aux médecins doit être complété par
une expérience pratique. On verra qu’encore au Moyen Age, les premières
universités qui se créées ont un enseignement quasiment théorique. Encore
aujourd'hui, la combinaison entre le théorique et le pratique est difficile à faire
notamment en France. En outre, pour établir son diagnostic, le médecin doit
longuement examiner et interroger le patient afin de lui procurer le traitement le plus
adapté. Cette collection hippocratique propose des indications médicales très
précises sur la manière de faire des pansements, de traiter des plaies, pratiquer des
actes chirurgicaux. Elle contient aussi un répertoire sur la symptomatique des
maladies et leur traitement. La postérité d’Hippocrate est parvenue jusqu’à nous
grâce au fameux serment que les médecins prononcent lors de leur soutenance de
thèse.
A. Le serment d’Hippocrate, précurseur de la déontologie médicale.
Le serment d’Hippocrate préfigure bon nombre de dispositions qui s’imposent
encore aujourd'hui aux médecins, dans l’exercice de leur profession. Dans son
serment Hippocrate :
- il affirme la responsabilité du médecin envers son patient ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%