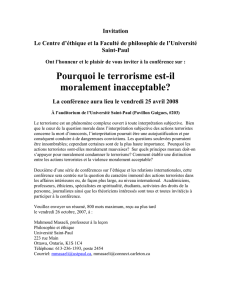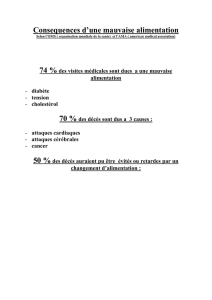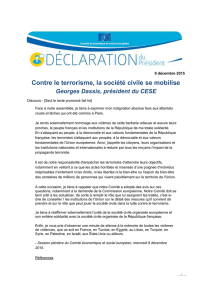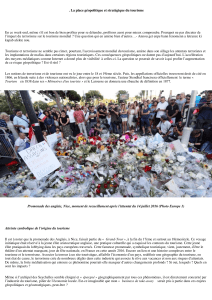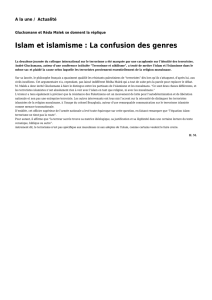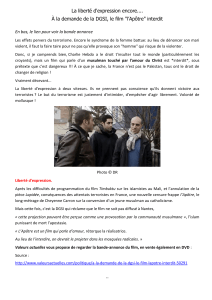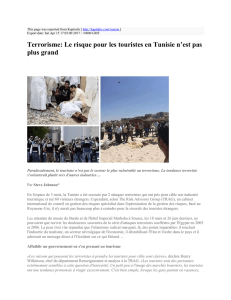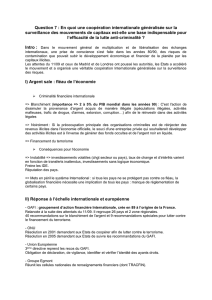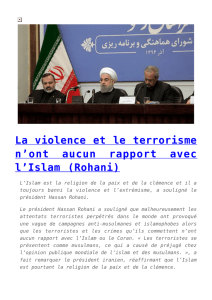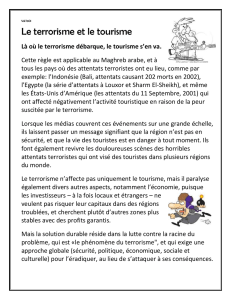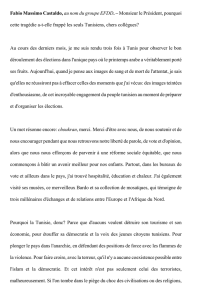IV. Draft Trade Report

ECONOMIE ET
SÉCURITÉ
AV 187
EC (02) 7
Original anglais
Assemblée parlementaire de l’OTAN
LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU
11 SEPTEMBRE 2001 ET LA DIMENSION
ECONOMIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE
TERRORISME
PROJET DE RAPPORT GENERAL
PAUL HELMINGER (LUXEMBOURG)
RAPPORTEUR GENERAL*
Secrétariat international 23 septembre 2002
* Aussi longtemps que ce document n’a pas été approuvé par la Commission de l’économie et
de la sécurité, il ne représente que les vues du rapporteur.
Les documents de l'Assemblée sont disponibles sur son site web, http://www.nato-pa.int

AV 187
EC (02) 7
i
TABLE DES MATIERES Page
I. INTRODUCTION ......................................................................................................... 1
II. EFFETS MACRO-ECONOMIQUES ............................................................................ 1
III. RÉPONSES MACRO-ÉCONOMIQUES ...................................................................... 6
IV. PROTEGER L’INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE .................................................. 7
V. FINANCEMENT DU TERRORISME ........................................................................... 8
VI. AIDE AU DEVELOPPEMENT .......................................................................................... 14
VII. LE ROLE DE L'UNION EUROPEENNE .................................................................... 16
VIII. CONCLUSIONS ................................................................................................................ 17

AV 187
EC (02) 7
1
I. INTRODUCTION
1. Il va sans dire qu’il existe une corrélation fondamentale entre la vitalité inhérente à un pays,
sa capacité à générer des richesses et son aptitude à se défendre. Ces liens complexes sont
cependant parfois sous-évalués, mais généralement pas par les parlementaires, auxquels il échoit,
en fin de compte, de replacer les considérations de sécurité nationale dans le plus large contexte
du bien-être de la nation. C’est également l’une des tâches centrales de cette Commission
2. Les attaques du 11 septembre contre New York et Washington marquent toutefois un
profond changement et montrent concrètement à nos sociétés l’interaction complexe entre la
sécurité nationale et les événements qui surviennent au niveau de l’économie mondiale. Ces
attaques soulèvent un grand nombre de questions liées à la dimension économique de la sécurité :
vulnérabilité de l’économie mondiale à des actions terroristes dévastatrices, nécessité de mieux
protéger les économies nationales face à ces attaques, lutte contre le financement du terrorisme et
recours à des outils économiques pour contrer le terrorisme. Les actes horribles commis par
al Qa'ida attire également l’attention sur la problématique du terrorisme privatisé et le type de
réseaux financiers spécifiques sur lesquels s’appuient les terroristes pour mener à bien leur
sinistre tâche. Ce rapport examine toutes ces questions
II. EFFETS MACRO-ECONOMIQUES
3. Les attaques contre Washington et New York sont survenues à un moment particulièrement
délicat. L’économie américaine était déjà au bord de l’essoufflement. Après avoir connu une forte
augmentation, les marchés des actions étaient orientés à la baisse et les analystes redoutaient, à
raison, de voir l’éclatement de cette bulle entraîner la chute des autres marchés. Aujourd’hui, il est
manifeste que les Etats-Unis sont entrés en récession dès mars 2001 et que, au moment des
attaques, l’économie américaine avait déjà derrière elle 11 mois de baisse de production
(Brian Westbury, “The Economic Costs of Terrorism”, International Information Programs
Electronic Journal, septembre 2002). Ce ralentissement pourrait aussi s'expliquer par l’impact
différé des hausses du prix de l’énergie de l’année précédente. Le 11 septembre, des signes de
ralentissement très net étaient évidents au niveau d’autres indicateurs. Au moment des attaques,
la croissance économique américaine était tombée à 1,2 % sur une base annuelle et l’on redoutait
déjà un déclin de l’économie après des années de très forte croissance. Ce mouvement s’est
cependant accéléré - bien que brièvement - après le 11 septembre. Au total, le PIB américain a
chuté de 1,3 % au 3ème trimestre 2001, mais il est reparti à la hausse (+1,8 %) au quatrième
trimestre avant d’enregistrer un bond de 5,8 % au premier trimestre 2002. La croissance
européenne s’était elle aussi ralentie fortement au cours des mois qui ont précédé les attaques, un
mouvement qui s’est encore amplifié au lendemain du 11 septembre. Mais elle s’était redressée en
fin d’année. En d’autres termes, si les attaques du 11 septembre ont effectivement eu des
conséquences non négligeables, ce sont des tendances plus globales au niveau de l’économie
mondiale qui expliquent le ralentissement général au cours de l’année écoulée.
4. Il est virtuellement impossible d’établir avec précision le coût des attaques du 11 septembre
contre New York et Washington. Nous savons à présent que l’organisation terroriste al Qa'ida n’a
probablement pas dépensé plus de 500 000 dollars pour commettre ce crime, tandis que les
dommages infligés se chiffrent certainement en milliards de dollars. Les dommages les plus
évidents et les plus facilement calculables ont concerné l’infrastructure du district financier de la
ville de New York et les indemnisations sans précédent réclamées aux assurances, qui pourraient
se situer entre 50 et 60 milliards de dollars. Le Bureau américain d’analyse économique estime les
dommages occasionnés à l’infrastructure new-yorkaise et le coût de la perte des quatre avions
impliqués dans les attaques à 15,5 milliards de dollars, un chiffre très important pour les
compagnies d’assurances concernées, mais qui ne représente que 0,2 % du PIB américain pour

AV 187
EC (02) 7
2
l’année 2001 (OECD Economic Outlook, vol. 2001/2, n° 70, décembre 2001). Les opérations de
sauvetage et de nettoyage ont coûté la bagatelle de 11 milliards de dollars alors que le prix en vies
humaines de ces attaques est aujourd’hui estimé à un peu moins de 3000 morts et disparus
(Etude OCDE: the Economic Consequences of Terrorism, OECD Economic Outlook, n° 71, 2002).
Il n’est pas surprenant que le mois de septembre ait été marqué par une chute spectaculaire des
ventes au détail, des commandes de biens de consommation durables et par une nette
augmentation des demandes d’emplois.
5. L’estimation des dommages devient bien sûr plus difficile encore si l’on commence à prendre
en compte des coûts indirects, dont certains peuvent avoir un effet à long terme. Ces coûts
comprennent par exemple la baisse brutale, sinon temporaire, des cours des actions l’automne
dernier, la forte chute des réservations de places d’avion, les mesures et équipements de sécurité
supplémentaires coûteux dans les aéroports et aux frontières, l’augmentation des primes
d’assurance pour la couverture des risques liés aux actes de terrorisme et les nouvelles mesures
de sécurité adoptées par le secteur privé, la hausse soudaine des dépenses de défense, la
campagne en Afghanistan et les coûts de l’extension éventuelle à l’Irak de la guerre contre le
terrorisme.
6. Les compagnies aériennes et d’assurance ont subi de lourdes pertes et sont confrontées à
de nouvelles contraintes de coûts qui risquent de perdurer. Les assurances contre les actes
terroristes ont augmenté de manière sans doute définitive. Les demandes de dédommagement
adressées aux assureurs suite aux attaques avoisinent les 60 milliards de dollars et les coûts de
réassurance dont beaucoup sont supportés par des compagnies européennes, représentent près
des deux tiers de ce total (“Premium Rates”, The Economist, 9 février 2002.) Il est clair que les
assureurs européens ont été aussi touchés par cette catastrophe que leurs homologues
américains. D’autre part, de nombreux biens détruits par les attaques étaient assurés en dehors
des Etats-Unis, ce qui pourrait entraîner un afflux net de capitaux vers les Etats-Unis d’environ
11 milliards de dollars, soit 0,1 % du PIB.
7. Comme nous l’avons précédemment laissé entendre, les attaques du 11 septembre
entraîneront inévitablement une augmentation des taux d’assurances professionnelles à long
terme. Cette industrie a créé une échelle des primes qui accroît le coût des affaires à mesure que
les compagnies sont proches des centres du pouvoir politique et de la puissance financière. Cela
constituera un coût supplémentaire permanent directement issu des attentats, qui entraînera une
augmentation des coûts de production et des prix à la consommation. Si la plupart des analystes
considèrent que l’industrie en général pourra supporter ce coût, le secteur du transport aérien est,
quant à lui, confronté à un dilemme beaucoup plus grave. Les responsables des compagnies
d’assurances estiment désormais qu’il n’est tout simplement pas rentable de couvrir les
compagnies aériennes contre les accidents liés à des actes terroristes. L’industrie a commencé à
retirer la couverture terrorisme et guerre après le 11 septembre en raison des coûts et risques.
Les quelques compagnies d’assurance qui ont réaffirmé une couverture du risque de guerre
quelques semaines après les attentats l’ont fait à des conditions prohibitives et en proposant des
niveaux de couverture inadéquats (passant de 1 milliard et 2 milliards de dollars par avion avant
les attaques à un maximum de 50 millions de dollars). De nombreux réassureurs qui couvrent le
risque associé à la couverture d’assurance ont également renoncé à couvrir le risque terroriste ou
ont augmenté leurs primes dans des proportions prohibitives. Sous la pression des compagnies
aériennes, les gouvernements des Etats-Unis et des pays membres de l’UE sont convenus de
jouer provisoirement le rôle d’assureurs ultimes pour les risques terroristes et de guerre encourus
par les compagnies aériennes. A court terme, les gouvernements ont étendu leurs programmes de
garantie d’urgence. Malgré l’opposition de certains groupes aux Etats-Unis contre cette couverture
fédérale des compagnies aériennes, le département du Transport des Etats-Unis a continué à
émettre des extensions provisoires, de 30 à 60 jours en moyenne, pour le financement des cas
d’urgence par le gouvernement. La Commission européenne a étendu la couverture d’assurance

AV 187
EC (02) 7
3
d’urgence des compagnies aériennes jusqu’à fin octobre 2002. Parallèlement, les gouvernements
souhaitent réduire rapidement leur rôle dans ce scénario pour se retirer finalement du marché de
l’assurance, où une intervention prolongée des autorités publiques risquerait finalement de
provoquer des distorsions et d’étouffer des opportunités pouvant intéresser le secteur privé. A
moyen terme, les gouvernements des Etats-Unis et des pays membres de l’UE soutiennent des
plans de développement de programmes d’assurance mutuelle avec garantie des autorités
publiques.
8. Aux Etats-Unis, un groupe de rétention du risque, connu sous le nom de Equitime, sera
financé par les compagnies aériennes et ré-assuré par le gouvernement, par le biais de
l’administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis (US Federal Aviation Administration - FAA).
On appelle groupe de rétention du risque une compagnie d’assurance détenue et financée par ses
propres membres et constituée, particulièrement, lorsque des assurances commerciales standard
n'ont pu être négociées. Equitime a pour but d’offrir aux compagnies aériennes transportant des
passagers et/ou du fret la possibilité de souscrire une assurance contre le risque de guerre à des
conditions raisonnables (selon les estimations, les primes coûteront environ la moitié de ce que les
compagnies aériennes paient actuellement). Equitime couvrirait les premiers 300 millions de
dollars pour les charges liées au risque de guerre, y compris les actes terroristes, alors que la FAA
apporterait la couverture additionnelle à concurrence de 2 milliards de dollars maximum (un niveau
correspondant à celui qui était pratiqué avant septembre 2001 par les compagnies d’assurance
commerciales). Le gouvernement devrait jouer ce rôle pendant deux ans, le temps de laisser
s’accroître l’excédent au sein d’Equitime et de ramener sur le marché les compagnies d’assurance
privées.
9. Les gouvernements européens envisagent de créer un fonds d’assurance mutuel, Eurotime,
selon les mêmes principes qu’Equitime. Les compagnies aériennes, les aéroports et d’autres
acteurs industriels souscriraient à ce fonds, les gouvernements garantissant le risque
excédentaire. Un membre de l’Association des compagnies aériennes européennes (AEA) a prédit
qu’Eurotime demanderait le support du gouvernement en matière de réassurance pendant 3 ans,
jusqu’à ce que le fonds parvienne à des niveaux appropriés.
10. Les compagnies aériennes se réjouissent de la future création d’un fonds d’assurance
mutuel global, regroupant Equitime et Eurotime. Mais à long terme, les gouvernements ont bien
l’intention de se retirer totalement du marché de l’assurance. En Europe, certaines compagnies
commerciales comme AIG et Allianz (Allemagne) ont déjà rétabli une couverture privée pour les
compagnies aériennes, y compris pour les risques liés aux actes terroristes. Les analystes
reconnaissent que rien de particulier n’empêche d’intégrer les attaques terroristes dans le modèle
de gestion des risques et que, d’ici quelques années, l’industrie de l’assurance aura procédé aux
ajustements nécessaires. D’ici là, une intervention limitée des gouvernements paraît à la fois
justifiée et nécessaire.
11. Il n’en demeure pas moins que la hausse des primes d’assurance, la baisse des réservations
enregistrée par les compagnies aériennes (davantage aux Etats-Unis qu’en Europe) et le poids
des nouvelles exigences liées à la sécurité ont des effets désastreux sur l’industrie des voyages en
avion. L’effondrement brutal de la demande n’a pas tardé à entraîner le dépôt de bilan de plusieurs
sociétés européennes affaiblies tandis que des centaines de milliers d’employés de compagnies
aériennes et apparentées ont brutalement perdu leur emploi, tant en Europe qu’aux Etats-Unis.
L’industrie de l’aviation civile dépend fortement d’un afflux régulier d’argent frais et la chute
dramatique des ventes de billets a induit un soudain revers de fortune pour les grandes
compagnies qui offrent un éventail complet de services. Swissair a ainsi plongé dans une crise
profonde qui a fini par nécessiter une aide d ‘urgence de l’Etat suisse, tandis que la compagnie
belge Sabena a simplement disparu.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%