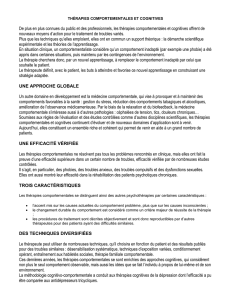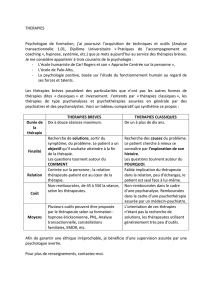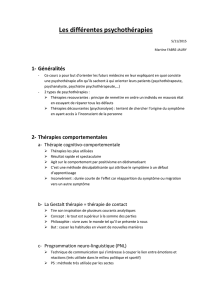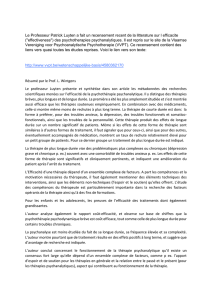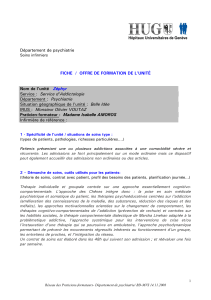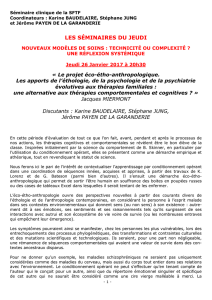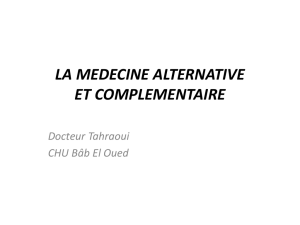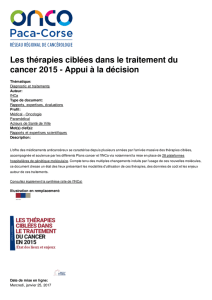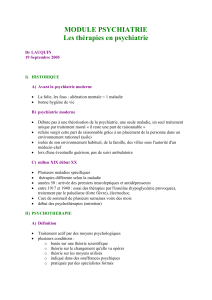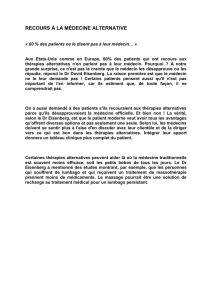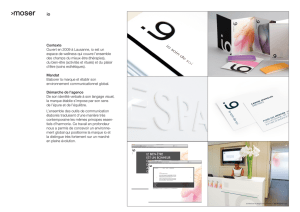Les thérapies cognitives - Bienvenue chez Gandalf Le Magicien

1
Chapitre : Les Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC)
Elles reposent essentiellement sur la psychologie expérimentale/scientifique. Il
s’agit d’un ensemble de technique thérapeutique qui utilise dans le domaine
clinique les données issues de la psychologie expérimentale et +
particulièrement les théories de l’apprentissage.
La psychologie scientifique expérimentale est née au 19ème siècle quand les
savants de l’époque essayait d’étudier la psychologie dans les laboratoires au
moyen de technique de recherche. Mais les thérapies scientifiques se sont
développées à partir des années 1960. Le premier courant qui a vu le jour était
celui comportementaliste/béhavioriste et par la suite vint le courant cognitiviste.
Les thérapies comportementales travaillent sur les affects des pensées et les
comportements qui représente le pendant agit de ses pensées.
Déjà dès le 18ème siècle avec Locke, on a un premier traitement sur une phobie
des grenouilles avec exposition à l’objet phobogène.
Dans la réflexion autour de la psychologie, Freud pratiquait parfois des thérapies
+ brèves avec des techniques + directives.
La formulation de la psychologie scientifique vient de Watson en 1913 qui disait
que « la psychologie scientifique n’a pas a spéculer sur l’âme ou l’esprit mais
doit se limiter à étudier par l’observation méthodique et l’expérimentation les
comportements, les facteurs environnementaux et physiologique ».
Par la suite les chercheurs restent dans les labos et les applications cliniques
arrivent dans les années 1950 où Wolpe en 1952 publie des études qui porte sur
la désensibilisation des phobies sur les animaux. En 1969, Bandura décrit
l’apprentissage social par imitation de modèle. La médecine comportementale se
développe à partir de 1975, il s’agit de quand les psychothérapies scientifiques
s’intéresse au champ psychosomatique comme l’effet du stress sur les
évènements de vie et les modifications hormonales liées aux stress.
Pour les TCC, le problème c’est le symptôme, sans porter l’intérêt sur les
problématiques sous jacentes. On utilise des thérapies spécifiques issues des
théories de l’apprentissage. Les postulats de base des thérapies
comportementales est le béhaviorisme qui considérait que l’étude d’un individu
ne pouvait se faire qu’à partir de faits observables (conception de la « boite
noire »). La relation entre les stimuli et les réponses du sujet donc.
Les TCC postule que les comportements sont appris grâce au conditionnement.
Le précurseurs des théories de l’apprentissage est Pavlov, il fut le premier à
mettre en avant l’apprentissage par conditionnement divisé en conditionnement
classique ou répondant ou de type I. Il a montré avec ses expériences qu’il est
possible de déclenché des réponses conditionnés par un processus
d’apprentissage. L’illustration était l’expérience avec le chien.
En 1920, Watson avec sa collaboratrice publie les résultats d’une expérience fait
sur le bébé Albert. Il avait pris l’habitude de jouer au labo avec une souris

2
blanche. Ils ont associés la présence de la souris avec un bruit brute. Après un
nombre de répétition, Albert commença a développé des symptômes phobiques
à l’animal, qui après s’est étendu à d’autres choses blanches (balles, lapin,
masque, pelote de laine,…). En 1924, sa collaboratrice Mary Cober Jones a
repris ses expériences pour aller dans le sens d’une désensibilisation des
phobies. Elle testa Peter, phobique des lapins. Dans une pièce il était confronté a
de la nourriture et des peluches, dont un lapin dans une cage dont on rapprochait
petit à petit. Au final, il n’avait plu peur (au bout de 40 séances où on
rapprochait lentement la cage). Elle a introduit 2 choses, l’objet phobogène
tandis que Peter faisait quelque chose d’incompatible (manger une glace). Le
fait d’avoir un comportement agréable face à l’objet phobogène provoque
l’inhibition réciproque. Comme deuxième technique elle a aussi eu l’idée de
présenter des enfants du même âge à Peter qui n’avaient pas peur du lapin et qui
jouait avec, Peter les observant, débouchant sur l’apprentissage par imitation
(développé par Bandura par la suite).
Les applications thérapeutiques par la suite dans le domaine clinique ont été
synthétisés et appliquer par un psychiatre sud africain Golpe qui publie en 1964
un livre sur les phobies pour les humains. Selon lui les phobies sont souvent des
réactions conditionnelles dû à une situation traumatisante, et le traitement
appliqué est la désensibilisation systématique qui consiste à apprendre un
comportement nouveau pour diminuer l’angoisse et aider la personne étape par
étape à faire face aux situations anxiogènes. On fit une immersion in vivo
(confrontation à l’objet phobogène) qui au bout de plusieurs séances permet la
confrontation sans angoisse / on a aussi la confrontation relaxation + in vivo.
Skinner a fait la distinction entre le conditionnement classique de Pavlov et celui
opérant/instrumental/de type II. Il a montré que l’être humain est profondément
conditionné par son environnement social et physique mais qu’on peut quand
même apprendre à exercer un peu + de contrôle. Le conditionnement opérant
qu’il a démontré c’est l’apprentissage d’un conditionnement en fonction des
conséquences pour l’organisme. Cette conséquence est appelé le renforcement
soit positif/négatif/neutre. Le renforcement positif facilite la répétition, le négatif
sert à l’évitement, et lorsque c’est neutre on arrive à l’extinction du
comportement.
Les applications thérapeutiques sont par exemple la thérapie des jetons où le
patient fait la liste de comportement à modifier et la liste de renforcement qu’il
souhaite avoir en comportement, a la fin avec l’accumulation des jetons il
obtient ce qu’il désir.
Bandura fit un assouplissement des modèles strictes déjà présents, il posa le
problème concernant la motivation. Selon lui l’organisme ne fait pas que subir
passivement les renforcements venant de l’environnement. Le fait d’avoir
conscience du renforcement semble être beaucoup + important que le
conditionnement lui même pour sa modification. Le conditionnement peut être
aussi anticipé (et qui dit anticipation dit pensée donc ouverture vers des

3
thérapies cognitivistes). Il va orienter ses recherches vers les processus
d’imitation et leur rôle dans l’apprentissage de comportements sociaux.
L’apprentissage par essai/erreur est celui habituellement fait, mais assez
coûteux, l’apprentissage par imitation est un raccourci vitale, c’est
l’apprentissage par observation, par modelage. Les hypothèses cognitives
renforcent le comportement futur même si elles peuvent s’avérer fausses.
Les applications de l’apprentissage par imitation des modèles, on le voit dans les
jeux de rôles, où on fait comme si.
Il y a le modeling positif, l’imitation d’un comportement. Le modeling négatif,
éviter de reproduire un comportement. Le faconnement de la réponse, c’est
quand on donne un feedback au patient sur son comportement, versant positif et
négatif. Toutes les campagnes de pub sont plutôt portées sur ce type
d’apprentissage.
Le déroulement d’une thérapie comportementale : brève et bien structurée, se
déroulant sur 10 à 25 séances (théoriquement). 4 étapes :
- analyse fonctionnelle correspond à la phase où on essai de clarifier
le problème, on évalue les symptômes de façon précises (quel moment,
contexte, depuis quand), on a l’anamnèse du patient et la quantification
du problème. Dans cette étape là le thérapeute utilise aussi des échelles
pour pouvoir quantifier et repérer le problème
- la formulation d’un objectif et le contrat thérapeutique patient et
thérapeute vont établir le contrat avec les règles (nombre de séances,
tarifs) et se fixe un objectif minimum
- la mise en œuvre d’un programme de traitement le programme
thérapeutique utilise les techniques qu’on a préalablement expliqué au
patient, il s’agit surtout d’exercices et tâches qu’on prescrit au patient
pendant la séance et entre les séances (choses à faire à la maison), le
but étant de développé une capacité d’autorégulation au patient,
permettant une régulation dans d’autre pan de sa vie, faisant ainsi
boule de neige.
- L’évaluation des résultats du traitement il se fait par rapport au
contrat, à l’objectif visé, on fait passer de nouveau les échelles du
début pour quantifier la modification et on peut fixer des rendez vous
espacé (6 mois, 1 an, « follow up ») pour faire un check up
L’indication majeur est la motivation.
La contre-indication est donc l’amotivation, qui n’incite pas à respecter le
contrat.
On n’entreprend pas une thérapie avec quelqu’un de pas suffisamment motivé.
La relation thérapeutique est interactive, pédagogique, parfois autoritaire, mais
très contenante qui se passe dans le respect mutuel des deux parties. Les 2 sont

4
dans une collaboration transparente, il n’y a pas de doute, si le patient n’est pas
content, il doit contester la thérapie.
La relaxation et les thérapies cognitives
La relaxation est un état de détente et de relâchement musculaire. L’utilisation
de la relaxation en psychothérapie s’appuie sur les liens entre le tonus
musculaire et la vie émotionnelle. On suppose que pour la plupart des gens il est
possible d’acquérir un niveau de contrôle sur le tonus musculaire pour obtenir
un état de détente psychique.
L’objectif de la relaxation est de mieux gérer les situations de stress, les
réactions émotionnelles, faciliter un sommeil réparateur, faire des expériences
de sérénité, se détendre au final.
L’origine des techniques de relaxation remonte au début du 20ème siècle. Charcot
considérait que l’hypnose était un fait diagnostique d’un trouble historique.
Bernehim lui disait que c’était naturel, et exploitait l’hypnose comme un moyen
thérapeutique. Dans cette optique, Wogt a décrit l’auto-hypnose dans le cas
d’une personne en proie d’une crise émotionnelle très importante et qui via ce
moyen a évité que ça devienne pathogène. Schultz, son élève, a développé les
training autogène, une méthode d’auto-hypnose qui consiste à une modification
auto-suggéré de la tonicité musculaire afin d’obtenir une déconnexion générale
physique et psychique de l’organisme. Dans les années 30, Jackobson qui va
s’intéresser aux aspects logique de la relaxation. Il a fait des études avec des
traces d’électromyogramme et a développée une méthode thérapeutique qui
visait à obtenir l’apaisement de l’activité physique et un état de détente
psychique.
En TCC, on utilise les méthodes de Jackobson et Schultz.
La méthode de Jackobson : il focalise l’attention sur les sensations provoqués de
contraction et décontraction musculaire, on l’appelle aussi la méthode de
relaxation progressive. Dans sa méthode le sujet contracte et décontracte
différents groupes musculaires de manière progressive, c’est une technique qui a
peu de risque (facile d’apprendre la procédure de base), a appliqué 2/3 fois par
semaines pour apprendre au bout de quelques mois pour se détendre rapidement.
Jackobson a soigné ainsi des troubles d’hyperémotivité, d’angoisse,
psychosomatique.
Ridd, collègue de Jackobson, a développé la technique de relaxation
« accrochement sans peur » a appliqué lors de l’accouchement.
La méthode de Schultz : c’est le training auto gène, qui est définit comme le
moyen d‘arriver par soi-même à un état d’hypnose sans induction extérieure. Cet
état peut être obtenu par la détente musculaire et vasculaire qu’une série
d’exercice est capable de procurer. Il a observé que lorsqu’on est dans un état
hypnoïde, l’état de détente s’accompagne d’une sensation de lourdeur des
membres et une chaleur, ce qui correspond aux phénomènes physiologiques. Il

5
se dit qu’on pourrait obtenir cet état via ses exercices. La première série consiste
à ce que la personne se dise « mon bras est lourd, très lourd », etc… en étendant.
La deuxième série est sur le même principe avec l’idée de chaleur « mon bras
est chaud, très chaud, c’est confortable et bon », etc… en s’étendant aussi.
On répète ce type d’exercice. La technique de Schultz se fait assis, debout,
allongé, les exercices se répètent 20 à 30 min, au fur et à mesure de la répétition
on arrive à cet état.
Pour les 2 méthodes, la participation du sujet est primordiale.
La relaxation est quelque chose peut + ou – arriver à contrôler, mais il ne faut
pas le proposer à tout problème. Sur un plan thérapeutique il faut voir les
sources d’angoisse, de problème (…) avant de la proposer.
Les indications majeurs sont les troubles anxieux (panique, TOC, phobie
spécifique et/ou sociale,…), troubles fonctionnels (stress, surmenage, troubles
du sommeil, hypertension, douleurs chroniques, céphalées, douleurs de dos,…),
parfois sur des troubles d’addiction et des troubles d’impulsion (mais ici des
techniques + spécifique sont utilisés), troubles sexuels, pour les dépressions
également, ainsi que les personnalité obsessionnelle également (quoique ?).
Les contre indications sont lorsque la personne n’arrive pas à se détendre à
cause de l’intrusion des pensées (ce qui est le cas chez les obsessionnels), l’âge
du sujet (les + jeunes comme les ados et les + âgés), l’amotivation (il faut que le
sujet soit motivé).
Les thérapies cognitives
Elles sont nés aux USA dans les années 60, avec comme figures emblématiques
Albert Ellis et Aron Beck.
Beck est connu pour le test du BDI (évaluation de la dépression).
Une thérapie cognitive consiste à apprendre à faire face à des situations
difficiles, à la prise de conscience, aux modifications des pensées
disfonctionnels/inadaptées. Elle a comme objet le discours intérieur, la pensée,
la perception. Le but est de modifier les émotions et les comportements en
influençant les structures de la pensée.
Beck était psychiatre et psychanalyste, il travaillait avec beaucoup de dépressifs
et s’intéressait beaucoup à leur rêve. Il cherchait les chemins cognitifs de ces
rêves. Finalement sa thérapie cognitive est un mélange de son orientation
psychanalytique et du comportementaliste classique (mixte entre les pensées
latentes du patient). Les modèles de Beck met en exècre
cognition/émotion/comportement. Il a le soucis d’aller chercher la genèse
historique du schéma cognitif. L’influence du comportementalisme on le voit
dans le soucis de proposer une thérapie structurer, avec des objectifs précis et
une évaluation finale.
Ellis a développé la thérapie rationnelle émotive en 1962. Il part de la
dichotomie stoïcienne entre émotion/pensée(raison). Il affirmait que le
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%