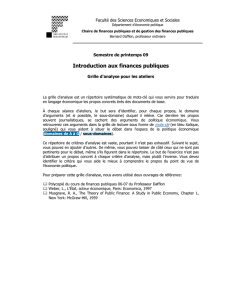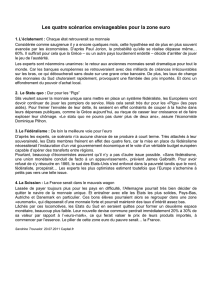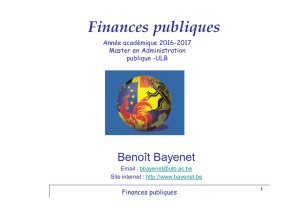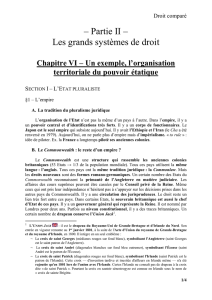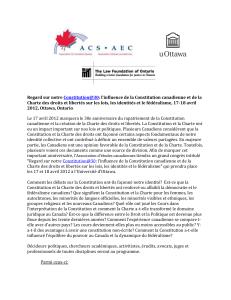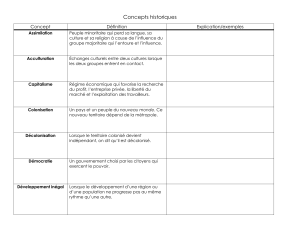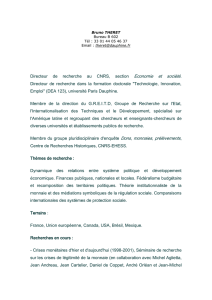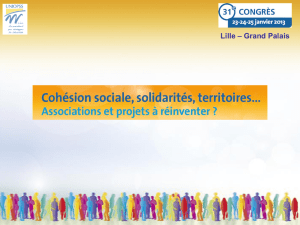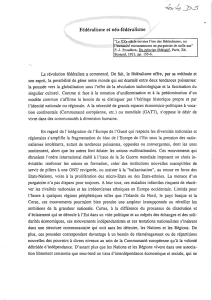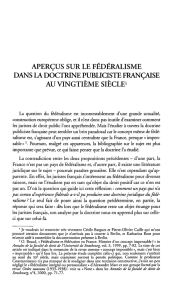3__Federalisme_technocratique

SYSTEME ET VIE POLITIQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Semestre 3 – Cours 3 – Vendredi 27 octobre 2006
Un modèle : le fédéralisme technocratique
Introduction :
Lecture de la déclaration Schuman. Réconciliation franco-allemande, paix etc. mais aussi
ouverture aux autres, qui le voudraient. La CECA serait la « première étape de la fédération
européenne ». Fusion des intérêts, indispensable pour établir une communauté économique.
Elargissement et approfondissement sont évoqués dans ce texte, sans être opposé, ce qui est
généralement le cas. Cette déclaration marque l’esquisse d’un modèle et le début d’un
processus, dynamique mais chaotique. La caractéristique de cette déclaration est de combiner
un principe d’égalité entre la France et l’Allemagne, concept plutôt anglo-saxon, et aussi un
principe d’ordre continental, selon une conception plus française. Les Anglais vont s’opposer
à ce dernier concept, rappelant le blocus continental imaginé par Napoléon pour éloigner UK
du continent. Pourtant, ça va dans le sens d’une paix continentale, qui bloque la progression
soviétique et s’intègre dans l’alliance atlantique. Donc il y a une solidarité de fait, surtout que
les USA se réjouissent de cette paix permise par cette cohésion économique et politique de
l’Europe occidentale. Cet arrière-plan diplomatique débouche sur un modèle politique à
caractère fédéral. Le terme de « fédération » (the « f-word » qui ne doit pas être prononcé
outre-manche) a été banni des textes successeurs, dont le Traité de Rome. Quelques mois
avant la déclaration Schuman, Adenauer avait fait une première proposition, mais c’était à la
France de la faire, car les Allemands étaient les perdants de la guerre. L’initiative de Schuman
satisfait les Allemands, car elle les intègre dans un cadre supérieur, capitaliste et atlantiste.
Mais les gaullistes avaient une autre idée que celle de Schuman, avec la volonté de créer une
Europe qui permettrait à la France de concurrencer les USA.
I) Les dimensions du fédéralisme.
A) L’essence du fédéralisme.
1) La subsidiarité.
La première interrogation porte sur l’essence du fédéralisme. C’est une répartition
fonctionnelle des compétences selon le principe de subsidiarité, qui s’oppose au principe de
souveraineté, où une seule entité dispose des compétences sur une certaine zone. La
subsidiarité, c’est un peu comme des poupées russes. C’est la préférence pour la
communauté la plus restreinte à degré d’efficacité égal. Arrière-plan socio-économique de
cette répartition des pouvoirs. L’organisation souverainiste est adaptée à un système
néolithique d’organisation des pouvoirs, avec des richesses agricoles et extractives. Le but du
politique va alors être de contrôler des territoires pour en retirer les richesses. Au contraire,
dans une société en réseau, où les services remplacent les secteurs primaires et secondaires.
Ce principe de subsidiarité vient de la culture chrétienne, et des partis démocrates-chrétiens,
sauf Jean Monnet. Si l’on dit que l’on doit attribuer à l’autorité supérieure les domaines les
plus importants et le reste à l’autorité locale. Mais ça dépend de notre échelle de valeur. La
transcription juridique de ces différences de valeurs est problématique.

2) La primauté du droit fédéral.
Le fédéralisme, c’est l’idée d’une hiérarchie contraignante des normes, avec la primauté du
droit fédéral. C’est la pierre angulaire du fédéralisme, mais ça pose des problèmes à ceux qui
s’insurgent du fait que le droit communautaire s’impose à l’ordre juridique interne. Si chaque
pays peut remettre en cause les dispositions communes au sein de son ordre juridique interne,
il n’y a plus de fédération possible, ni même de Communauté au sens juridique. La mise en
œuvre de ces principes est forcément difficile. Il y a aussi une hiérarchie au sien des textes
juridiques communautaires. Ce qui est compliqué, c’est de coordonner les deux hiérarchies,
car sinon, n’importe quelle décision de l’UE serait supérieure à la norme suprême de chaque
Etat membre, donc la Constitution.
3) La décision à la majorité.
Le fédéralisme, c’est aussi une facilité procédurale, avec la décision à la majorité plutôt qu’à
l’unanimité, dans une confédération. Juridiquement, ce n’est pas exact : ce qui est constitutif
de la dimension fédérale, c’est la primauté de la loi communautaire, mais elle peut-être prise à
l’unanimité, et ça reste fédéral. Ce n’est pas la technique de prise de décision, mais la
soumission à la décision commune qui compte, même si le vote à la majorité est un symbole.
B) L’existence des fédéralismes.
1) Etat fédéral et organisation fédérale.
La communauté européenne est une organisation fédérale, mais pas un Etat fédéral. Un Etat
c’est l’acteur qui fixe la répartition des compétences et des pouvoirs. L’UE est seulement une
organisation fédérale, et c’est assumé comme ça. Un Etat peut toujours se retirer de l’UE. Le
fait d’avoir seulement une organisation fédérale rend plus difficile le principe de subsidiarité,
car c’est difficile d’être cohérent et unanime à 25 ou 27. Il y a une logique de « donnant-
donnant » diplomatique. L’attribution des compétences est compliquée.
2) Fédéralisme frontière ou fédéralisme coopératif.
Dans le fédéralisme frontière, il n’y a aucune participation des instantes fédérées à la
répartition des compétences fédérales. Aux USA, ce ne sont pas les gouverneurs des 50 Etats
qui sont les législateurs, mais les élus au Sénat. Il y a des possibilités d’appel devant la Cour
Suprême etc. Séparation des instances fédérales et des instances fédérées. En Allemagne, c’est
le système inverse, le fédéralisme coopératif, ou fédéralisme inter-gouvernemental (JL
Quermonne), avec des gouverneurs et des ministres des Länder qui sont présents au
Bundesrat. Jusqu’à 1979, on était dans une version de fédération frontière avant d’avoir des
élections des parlementaires européens. C’est plus simple lorsque les décideurs sont les
mêmes aux deux bouts. Il y a alors une respiration plus sereine dans le cadre du fédéralisme
coopératif pour la question de la répartition des compétences. C’est pourquoi c’est le modèle
adopté pour l’UE.
3) Le fédéralisme politique et technocratique.
Est politique une décision qui n’est pas déterminée de façon rationnelle, mais en fonction
d’intérêts, d’un électorat propre. On parle de compétences politiques pour les affaires
étrangères, alors que pour l’économie par exemple, on est au niveau technique,
technocratique. Pourtant, même en économie, il y a des choix politiques, donc ce n’est pas
seulement sur les compétences que l’on fait la distinction.
Il y a aussi une différence entre des institutions politiques, élues, et des institutions
technocratiques, choisies pour leur compétence et leur indépendance (c’est le cas dans les

choix des juges par exemple). Ces institutions ne sont pas démocratiques, mais elles sont
compétentes et indépendantes.
II) L’ordre fédéral communautaire.
A) Le pacte fondateur.
1) L’offre de Jean Monnet.
C’est le texte de la déclaration Schuman en 1950. Monnet et Schuman feront de l’adhésion à
ce principe communautaire le critère d’adhésion à l’Europe. Le principe supranational est
présent dans l’offre Jean Monnet. Il y a aussi la prétention technocratique car Monnet se
méfie des politiques et des Parlements. Discussions sur les compétences et les institutions.
2) La transaction.
Deux pays ont refusé la proposition de Schuman et Monnet. Les Britanniques ont refusé tout
simplement de faire passer sous contrôle communautaire leur secteur principal qu’est le
charbon. Les Pays-Bas refusent la dépolitisation, et vont jouer un rôle de médiateur. Ils
acceptent la supranationalité pour rentrer, mais portent des réserves sur le transfert
technocratique.
Dans le Traité de Paris en 1951, il y a donc un compromis fondateur, avec à la fois une Haute
Autorité technocratique et des rencontres des ministres côté politique. En tout cas, c’est la
création d’une fédéralisme technocratique, loin des parlementaires.
B) Les ressorts du fédéralisme technocratique.
1) Un fédéralisme coopératif.
Le principe de subsidiarité : les Etats choisissent les compétences qu’ils mettent en commun,
donc ce sont des compétences qui gagnent à être partagées. La coopération est bénéfique.
2) Un fédéralisme cantonné.
En fait, les Etats vont garder les domaines les plus importants pour eux, comme les affaires
étrangères etc. et ne déléguer que ce qui est secondaire, ou ce qui les arrange financièrement,
comme dans le cas de la PAC, ça permet aux Français de mettre ça sur le dos de l’Europe et
pas seulement de l’Etat français. La logique de « donnant-donnant » est contraire au principe
de subsidiarité. En fait il y a cinq compétences majeures qui sont déléguées :
- La concurrence
- La PAC
- Le Marché intérieur
- La politique commerciale internationale
- La monnaie depuis Maastricht et l’euro.
Ça reste des compétences limitées : c’est un « fédéralisme à l’envers ». Il y a quatre échelons
de technocraties : - 1 technocratie supranationale (Commission)
- La somme des technocraties nationales (Conseil)
- 1 technocratie juridique (Cour de Justice)
- 1 technocratie monétaire (BCE)

3) Un fédéralisme camouflé.
Depuis l’échec de la CED, on ne parle plus de fédéralisme, mais de coopération de plus en
plus proche. C’est un peu un sujet tabou. On est dans une démocratie de négociation et pas de
confrontation.
Conclusion :
-L’Europe fédérale : le cercle de la raison
-Les Nations souveraines : le sanctuaire de la politique.
1
/
4
100%