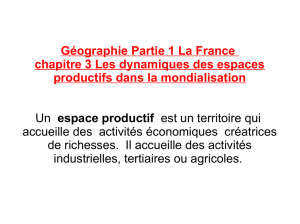Sch‚mas_institutionnelles_de_l`int‚gration_3

Les schémas institutionnels
et politiques des
expériences d’intégration
Professeur Moustapha Kassé
www.mkasse.com


Ces trente dernières années ont vu la recrudescence des accords régionaux,
en d’autres termes la montée en puissance du régionalisme. L’augmentation
des accords notifiés au GATT et à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) illustre cette tendance : au 1er janvier 2005, 312 accords ont été
notifiés depuis la Seconde Guerre mondiale.
Sur les 124 accords notifiés entre 1948 et 1994, seulement 38 sont restés en
vigueur, montrant ainsi l’évolution des accords – via un approfondissement
ou un élargissement du processus. De la création de l’OMC au 15 juin 2006,
147 étaient encore en vigueur.
Cette dynamique touche l’ensemble des régions du monde. Des cadres
institutionnels et/ou des accords commerciaux privilégiés, allant de simples
forums interrégionaux jusqu’à des unions économiques en passant par des
zones de libre-échange et des unions douanières, ont été mis en place dans
la plupart des régions : Amérique latine (MERCOSUR), Amérique du Nord
(ALENA), Asie Pacifique (ASEAN, CER), Caraïbes (CARICOM), Afrique
(UEMOA, SADC, CEDEAO, COMESA…), Russie et son voisinage (CEI,
GUAM…), Europe (UE, partenariat Euro-med, accords ACP)…
Si l’expérience européenne est le processus le plus abouti en la matière,
cette recrudescence montre aussi que l’Europe n’est plus l’unique parangon
de l’intégration. Quelles sont les raisons de cet intérêt.

Quelles sont les raisons de cette
motivation ?
1. Les motivations de
l’intégration régionale de
jure: créer les conditions
favorables pour une insertion
dans les circuits mondiaux.
Dès lors 3 justifications du
processus:
•L’intégration comme marchepied
vers la mondialisation
•L’intégration comme catalyseur de
la mondialisation
•L’intégration comme rempart
contre la mondialisation
2. Les schémas d’insertion
dans la mondialisation
multipolaire :
•Commerce international,
croissance et développement
•Mondialisation, multilatéralisme
et intégration
•Le Schéma de Balassa

5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%