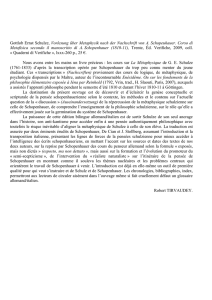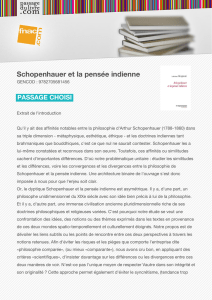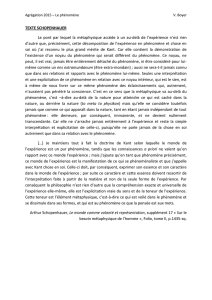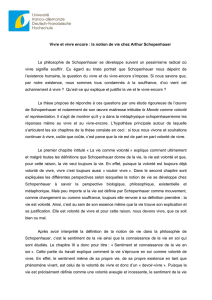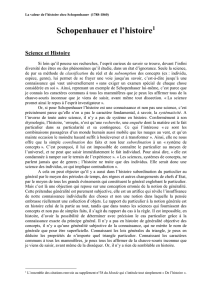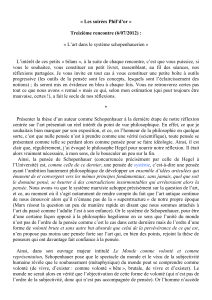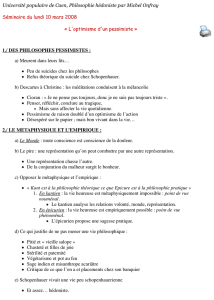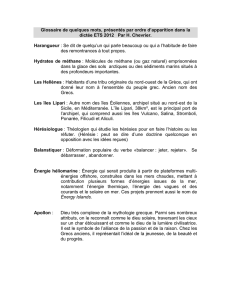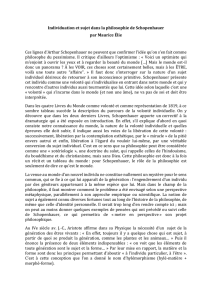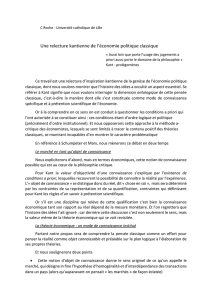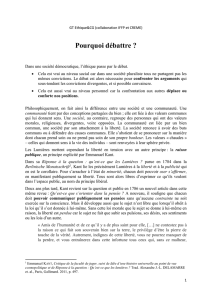Les modifications du phénomène de Kant à Schopenhauer

Les modifications du phénomène, de Kant à Schopenhauer.
Benjamin Douplat
Au sein de l’idéalisme allemand, la place qu’occupe Schopenhauer semble encore poser
problème, au point de vue de son intégration dans une période que domine la triade Fichte –
Schelling – Hegel. Si l’on a cessé d’évoquer l’auteur du Monde comme Volonté et représentation sous la
rubrique des épigones de Schelling ou comme un contempteur peu averti de Hegel, il n’en reste
pas moins que sa position dans la pensée allemande continue d’être floue. Il ne s’agit pas tant
toutefois de faire preuve d’acrimonie à l’instar de Schopenhauer, que de se demander, pour
singulière que soit la métaphysique de la Volonté, si celle-ci reste susceptible de s’inscrire dans
l’idéalisme allemand. À cet égard, vue de France, la pensée allemande n’est pas sans offrir une
certaine cohérence :
« Les disciples de Schopenhauer et de Hegel se croient aux antipodes parce qu’ils
représentent des tendances différentes d’une même époque, d’une même nation. Mais leurs
ressemblances apparaissent, dès qu’on les oppose en bloc à la pensée française par exemple.
Chez Schopenhauer comme chez Hegel le moi ne se pose qu’en s’opposant et le monde
n’existerait pas, sans la contradiction féconde qui lui donne la vie et le mouvement, sans cette
contradiction essentielle dont procède l’idéalisme guerrier des philosophes allemands. Tous deux ont
bénéficiés de la critique du Cogito par Kant, tous deux vivent sur l’Esthétique
transcendantale, sur la doctrine de l’idéalité de l’espace et du temps. »
1
Ainsi, évincer du 19ème siècle le coup de tonnerre philosophique qu’annonce le Monde comme
Volonté et représentation, dont les échos iront résonnant jusque chez Nietzsche et chez Freud, ce
n’est pas seulement faire l’aveu de la difficulté qu’il y a à circonscrire une pensée intempestive
2
,
mais c’est surtout accuser des différences qui ne vont pas forcément de soi. Louis Ducros dans
Les transformations de la chose en soi de Kant à Schopenhauer
3
, indique clairement le lien entre
métaphysique de la Volonté d’une part et pensée de la volonté, notamment chez Fichte, d’autre
part. Schopenhauer n’y est pas décrit comme le mièvre inspiré de la pensée fichtéenne qu’il ne fut
jamais, plutôt comme un interlocuteur philosophique à part entière.
Cependant, nous ne prendrons pas ici le parti de mettre uniquement à jour les liens entre
les diverses manifestations de l’idéalisme allemand. Nous essaierons plutôt de comprendre quels
furent les motifs philosophiques qui ont permis l’oubli partiel dont a souffert Schopenhauer.
Motifs philosophiques, car il en est d’autres qui ne nous intéresseront pas du fait de leur manque
de pertinence. En effet, pour une bonne part, la condescendance des philosophes (français) à
l’égard de Schopenhauer se joue dès sa réception en France à la fin du 19ème siècle. À l’époque se
sont les Parerga et Paralipomena qui lui valent une soudaine et tapageuse gloire, mais pour cette
raison même douteuse
4
. Flaubert et Maupassant y voient la consécration de leur misogynie et de
leur pessimisme de mauvais aloi ; même chez un Proust, où les thèmes schopenhaueriens
résonnent avec force, il n’en reste pas moins que l’aspect proprement philosophique de la pensée
1
FAUCONNET, L’Esthétique de Schopenhauer, 202, note 1.
2
Sur ce point, cf. NIETZSCHE et la troisième Considération intempestive : Schopenhauer als Erzieher.
3
Le titre complet est : Schopenhauer, les origines de sa métaphysique ou les transformations de la chose en soi
de Kant à Schopenhauer, 1883, Paris, Germer Baillière.
4
Cf. COLIN, Schopenhauer en France, Presses Universitaires de Lyon, 1979.

2
du maître ne ressort véritablement jamais. Même en Allemagne, ce sont les écrivains qui assurent
à la pensée de Schopenhauer un écho durable : que l’on songe à Thomas Mann. Seul Nietzsche
prendra à son compte l’héritage de la métaphysique de la Volonté et lui seul en fera le grand cas
que l’on sait.
Mais, ces motifs ne sont pas assez philosophiques pour qu’ils nous retiennent plus
longtemps qu’au détour d’un paragraphe. Que l’on ait pris Schopenhauer pour un moraliste à la
plume caustique et non pour le philosophe qu’il était n’a guère d’intérêt dans notre enquête. Il
s’agit pour nous de déterminer philosophiquement les motifs eux-mêmes philosophiques qui ont
permis de reléguer Schopenhauer au second plan. Le débat ne sourd donc pas de l’amertume de
voir une pensée négligée – ce qui est de plus en plus en passe d’être faux – mais de comprendre
ce qui, dans la réception du legs kantien, permet de discriminer les philosophes.
Car l’essentiel se joue là : l’idéalisme allemand fonde et annonce la métaphysique qu’avait
ruiné Kant en ses possibilités. Le phénix métaphysique renaît ici des cendres de la Critique de la
Raison pure, sous l’espèce du postkantisme, dont le problème reste de savoir qui, au sein de cette
tendance, a le mieux compris Kant. L’étude des modifications du phénomène, qui chez
Schopenhauer devient représentation (Vorstellung), ne nous permettront sans doute pas de
décider de manière définitive qui de Fichte, de Schopenhauer ou de Hegel, peut être dit
continuateur authentique de Kant. L’idée n’est pas de trancher le nœud gordien de l’héritage
kantien ; plutôt de comprendre ce que Schopenhauer en a fait, pour quelles raisons et en quoi
cela a semblé constituer un motif philosophique suffisant pour écarter Schopenhauer de la scène
philosophique et ce de manière durable.
I. L’héritage kantien
Tous les penseurs de l’idéalisme allemand revendiquent, à divers degrés, l’héritage kantien.
La postérité les a d’ailleurs consacrés sous le titre de post-kantiens, au même titre qu’il y aura plus
tard des néo-kantiens. Avant que de discuter la manière dont cet héritage est repris par chacun de
ces penseurs, évoquons les diverses figures du postkantisme : nous retiendrons ici d’une part,
Fichte, Schelling et Hegel et, d’autre part, Schopenhauer
5
. Évoquer ces penseurs de manière
séparée indique d’emblée les prises de position divergentes qu’ils annoncent.
En effet, suivant la critique initiale de Jacobi, Fichte, Schelling et Hegel considèrent la
chose en soi comme une monstruosité théorique, qu’un Kant acculé à la fin de la Critique de la
Raison pure aurait dû bon gré mal gré intégré à son système. Jacobi nous dit qu’ « il est impossible
d’entrer dans la philosophie critique sans la chose en soi, il est impossible d’y rester et d’y faire un
pas avec la chose en soi. » Ce dilemme se laisse résumer ainsi :
« L’affection par laquelle nous recevons la matière empiriquement donnée de nos
perceptions provient nécessairement ou bien des phénomènes ou bien des choses en soi. La
première explication est absurde, parce que les phénomènes, dans le sens kantien, ne sont
que des représentations ; il faudrait donc qu’avant toute représentation il y eût déjà d’autres
représentations. La deuxième explication, Kant l’a adoptée, mais la doctrine critique
repousse cette seconde explication. En effet, le rapport de cause à effet n’a de valeur que
dans le monde des phénomènes et n’a rien à voir avec [la chose en soi]. »
6
5
Sur ce point, nous renvoyons à Ernst CASSIRER: Les systèmes post-kantiens, le problème de la connaissance
dans la philosophie et la science des temps modernes, 1907, Presses universitaires de Lille 3 (1983). Nous
laissons sciemment de côté des penseurs tels que Herbart et Fries, tenants de la lecture réaliste de Kant.
6
DUCROS, Schopenhauer, les origines de sa métaphysique ou les transformations de la chose en soi de Kant à
Schopenhauer, 88.

3
La chose en soi laisse ainsi s’empêtrer le système dans des contradictions telles qu’il s’avère
nécessaire de l’évacuer. Mais à l’inverse, Schopenhauer considère la distinction entre phénomène
et chose en soi comme la découverte qui mérite à elle seule tous les honneurs à Kant :
« Le plus grand mérite de Kant, c’est d’avoir distingué le phénomène de la chose en soi. »
7
Inutile de préciser que c’est cette lecture de Kant qui passera pour proprement dissidente dans
l’idéalisme allemand, malgré quelques faits pour le moins étrange. En effet, le premier post-
kantien est sans aucun doute Fichte ; or celui-ci se targue d’avoir compris Kant de la bonne
manière : « Ich allein habe Kant richtig verstanden »
8
, en dépit de ce Kant lui-même a pu dire
concernant son système. L’on sait que parmi tous ses héritiers, Kant n’a eu véritablement
connaissance que des travaux de Fichte ; il est vrai que celui-ci fut d’abord subjugué par le talent
du jeune philosophe :
« Fichte […] se rendit […], durant l’été 1791, à Königsberg pour rendre visite au grand
philosophe. […] Dans un premier temps, Kant le renvoya chez lui comme les autres
visiteurs [...]. Fichte se retira pour trente cinq jours et rédigea fiévreusement un écrit avec
lequel il voulait se recommander au maître : Essai d’une critique de toute révélation. Kant fut
tellement impressionné par cet ouvrage que non seulement il invita son auteur à déjeuner,
mais que, bien plus, il lui trouva un éditeur. »
9
Mais une fois la surprise passée, Kant en viendra à désavouer les travaux ultérieurs de Fichte qui,
selon lui, ne prennent pas acte du criticisme. C’est donc contre l’avis explicite de Kant que l’on
considère Fichte comme un post-kantien. Fort heureusement, il n’est pas possible de réduire à
l’assentiment de Kant l’authenticité de l’appellation « post-kantien », car serait alors dite post-
kantienne toute doctrine s’inscrivant dans l’héritage kantien, c’est-à-dire tendant non pas à
prolonger le kantisme ou à le débarrasser de ses scories et autres contradictions, mais au sens où
elle en reproduirait la stricte orthodoxie. Si tel était le cas, il n’est pas de doute qu’aucun post-
kantien trouverait grâce aux yeux de Kant.
Hegel reproduit cette attitude lorsqu’il considère que le criticisme n’est pas en soi
philosophique et qu’il ergote sans fin sur des conditions de possibilité dont seule « l’épreuve du
feu » – pour ainsi dire – peut réellement attester l’efficace. Hegel convoque ainsi la figure de ce
scolastique qui, mimant hors de l’eau les gestes de la nage, n’osait entrer dans l’eau et nager pour
de bon. Qui plus est, le hégélianisme blâme sévèrement une critique de la raison où celle-ci, seule
et sûre de son bon droit, en vient, dans son propre procès, à être juge et parti ; car c’est tour à
tour que la raison mène le réquisitoire (Critique de la raison pure) et s’attèle ensuite au plaidoyer
(Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger). Cette schizophrénie pathologique de la
raison lui fait oublier qu’elle est alors l’instrument de mesure et la mesure elle-même.
De son côté, Schopenhauer ne conçoit pas que sa critique (Critique de la philosophie
kantienne) puisse être autre chose qu’une polémique serrée contre Kant :
« Il ne faut donc pas attendre de moi que le profond respect que j’ai pour Kant s’étende
jusqu’à ses faiblesses et à ses défauts ; je ne me crois pas obligé à envelopper ma réfutation
d’artifices et de restrictions ; je ne veux point, à force de faux-fuyants, ôter à mon
argumentation toute force, toute relief. »
10
7
Monde, Critique de la philosophie kantienne, 522, Schopenhauer souligne lui-même.
8
FICHTE, Doctrine de la science, deuxième introduction.
9
SAFRANSKI, Schopenhauer et les années folles de la philosophie, 160.
10
Monde, Critique de la philosophie kantienne, 521.

4
Dès lors, il serait presque juste de dire que tout philosophe venant immédiatement après Kant est
post-kantien, sans égard à l’orthodoxie de sa doctrine. Cela se conçoit si l’on entend par « venir
immédiatement après Kant » « subir l’influence de la pensée kantienne » et non « reproduire
obséquieusement celui-ci ». De ce point de vue-là aussi bien Fichte, Schelling, Hegel, que
Schopenhauer subissent de plein fouet cette influence et la revendique malgré des modifications
d’importance dans l’économie générale du kantisme. Le post-kantisme reste donc fondamentalement une
pensée qui vit sur les acquis du kantisme, tout en en remodelant la perspective générale selon l’interrogation:
comment est-il possible après Kant de fonder une nouvelle métaphysique ?
II. L’unité de l’idéalisme allemand
L’idéalisme allemand se rassemble donc sous la bannière d’une critique post-kantienne du
kantisme. En termes hégéliens, cela signifie que le post-kantisme dépasse (Aufhebt) le criticisme et
cela ne va pas sans une certaine unité de pensée. Quoi qu’en dise Schopenhauer, sa doctrine n’est
pas aussi éloignée qu’il veut bien le croire de celle d’un Fichte. Il ne s’agit pas de minimiser
l’originalité de Schopenhauer ou de le réduire au statut de disciple ; plutôt d’indiquer qu’une
certaine Stimmung est sans doute à l’œuvre et qu’elle réunit autour de certains points communs les
penseurs allemands du début du 19ème siècle.
Remarquons d’abord que Schopenhauer quitta Göttingen pour Berlin au cours de l’été
1811 afin d’y suivre, entre autres, les cours de Fichte et de Schleiermacher. De cette université
récente, fondée en 1809, Fichte vient d’être nommé recteur :
« En 1811, je m’installai à Berlin dans l’espoir d’apprendre à connaître, en Fichte, un grand
philosophe et un grand esprit. »
11
Fichte se trouve alors à l’apogée de sa gloire. Révélé en 1792 par un opuscule d’inspiration
kantienne : L’essai d’une critique de toute révélation, dont Kant lui-même a permis l’édition et que l’on
soupçonne d’en être l’auteur, sa renommée a crû soudainement à travers toute l’Allemagne une
fois l’auteur identifié. Dans son ouvrage, Fichte prolonge le subjectivisme kantien en matière de
religion. Il pose la question de savoir si on peut encore penser la révélation suivant les principes
de la philosophie critique. À celle-ci, il répond par oui, à condition que ce ne soit pas la révélation
qui fonde la moralité, mais inversement la moralité qui fonde la révélation.
Dès cet écrit, l’on comprend que ce qui importe à Fichte, c’est la doctrine de la liberté et
de l’autonomie du moi créateur du monde. Du « Je pense » de l’aperception transcendantale
kantienne, Fichte tire le concept d’un moi tout puissant et celui complémentaire d’un monde
comme simple produit des actions de ce moi. Son influence s’étend prodigieusement à l’époque
et c’est sous son impulsion, qu’à la fin du 18ème siècle, l’emphase du moi fichtéen est reprise par
Schelling, Hegel et Hölderlin qui formuleront, en guise de procès-verbal d’une soirée arrosée, Le
programme du système le plus ancien de l’idéalisme allemand. C’est donc tout naturellement qu’à l’époque
Schopenhauer en vient à attendre de Fichte une philosophie de grand style.
Cependant, dès l’automne 1811, les premiers cours que professent Fichte sur les faits de
conscience, lui paraissent abscons. En marge de ses notes, Schopenhauer écrit :
« Je dois avouer que tout ce qui se dit ici m’est très obscur, mais il est possible que je n’ai
pas compris convenablement. »
12
Entre agacement et incertitude, le jeune philosophe ne désespère cependant pas. Ce n’est que
quelques semaines plus tard que sa colère explose :
11
RÜDIGER SAFRANSKY, Schopenhauer et les années folles de la philosophie, 155.
12
Der handschriftliche Nachlass, II, 37.

5
« Durant ce cours, dit-il, il a dit des choses qui me donnent envie de pouvoir lui mettre un
pistolet sous la gorge et de lui dire : « Tu dois mourir maintenant sans pitié ; mais pour
l’amour de ta petite âme, dis-moi si tu as pensé quelque chose de clair dans ce charabia, ou
si tu t’es simplement moqué de nous ? » »
13
Schopenhauer ne s’en laisse alors plus conter par le jeu de concepts que propose Fichte à ses
étudiants. Toutefois, l’attaque porte d’abord et essentiellement sur la langue ; si l’on a pu dire que
Schopenhauer a formé le vœu d’écrire en Allemand comme Hume avait écrit en Anglais, il n’est
pas étonnant que Fichte et plus tard Hegel le désappointeront sur ce point précis. Kafka ne
louait-il pas d’ailleurs le talent littéraire de Schopenhauer :
« Schopenhauer ist ein Sprachkünstler. Wegen seiner Sprache allein muss man ihn
unbedingt lesen. »
Mais la fureur de Schopenhauer ne se cantonne pas uniquement à la forme de la pensée
fichtéenne. Le fond est sans doute atteint lui aussi par la critique du jeune philosophe. Il n’en
demeure pas moins possible de rapprocher le système de Fichte de celui qu’expose le Monde.
Bryan Magee se propose un tel rapprochement des points cruciaux des deux doctrines :
« 1. Ce qui est premier et fondamental dans le monde est décrit en termes de volonté, bien
qu’évidemment les deux philosophes entendent par là deux choses différentes. 2. Le monde
des phénomènes en son entier est compris comme étant une création de cette volonté. 3.
Cet acte de création implique qu’il soit « libre » du point de vue de la volonté au sens où il
ne ressortit pas au domaine du principe de raison suffisante. 4. Comme ce domaine de la
causalité naturelle est coextensif à celui de la connaissance naturelle, de l’entendement et de
la raison, et partant de l’intellect, il en découle que l’intellect est un produit de la volonté et
qu’il vient à l’être pour en remplir les desseins. 5. L’homme n’est pas primitivement une
créature raisonnable ; ce qui est premier en l’homme ce n’est pas la raison, mais la volonté.
6. Il est dans la nature du monde des phénomènes et constitutif de son être d’empêcher si
ce n’est de s’opposer à l’activité volontaire des individus. 7. La morale et l’ontologie sont
comme l’avers et l’envers d’une même pièce, c’est-à-dire liées, contrairement à ce qu’en
disait Kant : l’unité morale du monde ainsi que son unité épistémologique et ontologique
proviennent d’une source unique de telle manière que l’existence elle-même du monde
possède une signification morale. 8. La philosophie ainsi esquissée apparaît comme le
prolongement naturel du kantisme et le parachèvement des œuvres de Kant : sont ainsi
développées les conséquences de sa pensée qu’il n’avait pas perçu et là où l’on s’écarte de
lui, on y voit précisément une rectification de ses erreurs, plutôt qu’un rejet de sa
philosophie. »
14
Un tel compte-rendu reste évidemment sommaire et ne porte au premier plan que les points de
contact entre les deux pensées, indépendamment des différences qui les hantent. De même, ce
que Fichte et Schopenhauer entendent par « volonté » n’est pas la même chose. Toutefois, on
peut qu’être frappé par une similitude troublante entre les deux doctrines. Cette similitude se
fonde sur l’héritage kantien commun au deux penseurs.
Il serait également possible de rapprocher la philosophie volontaire de la Naturphilosophie
schellingienne. D’une part, Schopenhauer est plus disponible à l’égard de son enseignement ;
13
Der handschriftliche Nachlass, II, 41.
14
BRYAN MAGEE, Schopenhauer and the Idealists, in The philosophy of Schopenhauer, 279-280, nous
traduisons.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%