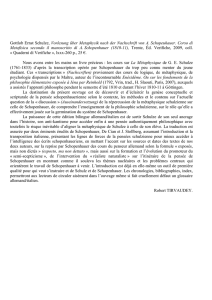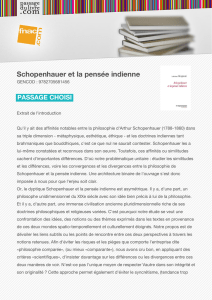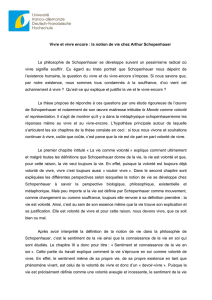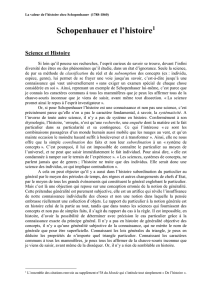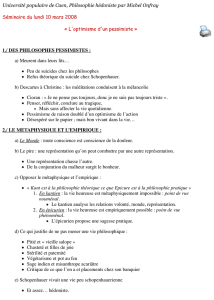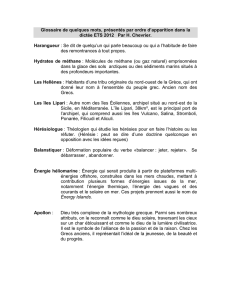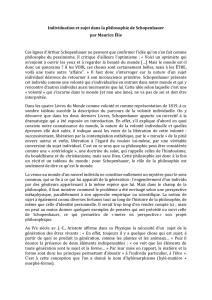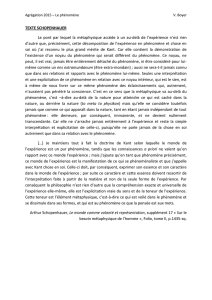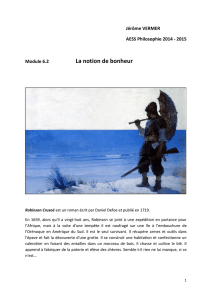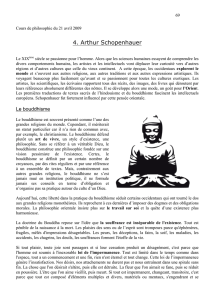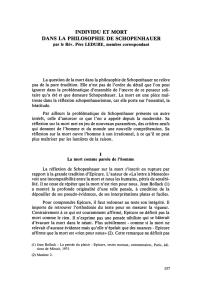Phil`dor n° 13 060712

« Les soirées Phil’d’or »
Treizième rencontre (6/07/2012) :
« L’art dans le système schopenhauerien »
L’intérêt de ces petits « bilans », à la suite de chaque rencontre, c’est que vous puissiez, si
vous le souhaitez, vous constituer un petit livret, rassemblant, au fil des séances, nos
réflexions partagées. Je vous invite en tout cas à vous constituer une petite boîte à outils
progressive (les outils de la pensée sont les concepts, lesquels sont l’éclaircissement des
notions) ; ils seront mis en évidence en bleu à chaque fois. Vous ne retrouverez certes pas
tout ce que nous avons « remué » mais ce qui, selon mon estimation (qui peut toujours être
mauvaise, certes !), a fait le socle de nos réflexions.
*
Présenter la thèse d’un auteur comme Schopenhauer à la dernière étape de notre réflexion
centrée sur l’art présentait un réel intérêt du point de vue philosophique. En effet, ce que je
souhaitais bien marquer par son exposition, et ce, en l’honneur de la philosophie en quelque
sorte, c’est que nulle pensée n’est à prendre comme une vérité (scientifique), toute pensée se
présentant comme telle se perdant alors comme pensée pour se faire idéologie. Ainsi, il est
clair que, régulièrement, j’ai évoqué le philosophe Hegel pour nourrir notre réflexion. Il était
alors vraiment nécessaire, à mon sens, de le bousculer un peu sur la fin.
Ainsi, la pensée de Schopenhauer (concurrencée précisément par celle de Hegel à
l’Université) est, comme celle de ce dernier, une pensée de système, c’est-à-dire une pensée
ayant l’ambition hautement philosophique de développer un ensemble d’idées articulées qui
émanent de et convergent vers les mêmes principes fondamentaux, sans jamais, quel que soit
le domaine pensé, se heurter à des contradictions insurmontables qui arrêteraient alors la
pensée. Nous avons vu que le système marxiste achoppe précisément sur la question de l’art,
et ce, au moment où il s’agit notamment de rendre compte du fait que l’art antique continue
de nous émouvoir alors qu’il n’émane pas de la « superstructure » de notre propre époque
(Marx résout la question un peu de manière rapide en disant que nous sommes attachés à
l’art du passé comme l’adulte l’est à son enfance). Or le système de Schopenhauer, pour être
d’une certaine façon opposé à la philosophie hegelienne en ce sens que l’unité du monde
n’est pas de l’ordre de la pensée comme c’est le cas dans cette dernière mais de l’ordre d’une
forme de volonté brute et sans autre but absurde que celui de la persévérance de ce qui est,
n’en propose pas moins une pensée forte sur l’art qui, en bien des points, rejoint la thèse de
penseurs qui ont davantage fait confiance à la pensée.
Ainsi, dans son ouvrage majeur intitulé Le Monde comme volonté et comme
représentation, Schopenhauer pose que le spectacle du monde et le vécu de la subjectivité
humaine révèle que le soubassement (métaphysique) du monde peut se comprendre comme
volonté (de vivre, d’exister : comme volonté « bête », brutale, de vivre et d’exister). Le
monde ne serait alors en vérité que l’objectivation de cette forme de volonté (qui n’est pas de
l’ordre de la subjectivité, donc qui n’est pas accompagnée de pensée). Or l’homme n’accède

pas à ce savoir même par la science car le sujet connaissant que nous sommes connaît le
monde non pas tel qu’il est mais tel qu’il est déterminé à le connaître de par sa structure
subjective (à travers notamment l’espace, le temps et la catégorie de la causalité : un certain
prolongement de la philosophie de la connaissance kantienne dont Schopenhauer, de ce point
de vue-là, se revendique). D’où nous vient alors ce « savoir » métaphysique d’un tel « tissu »
du monde ? Précisément de l’art. Mais parmi tous les arts, de la musique.
Qu’en est-il exactement ? C’est là que le système de Schopenhauer révèle toutes ses
richesse et complexité. Ainsi, l’homme n’échappe aucunement au « sort » de toutes les
réalités du monde : il est le « jouet » de cette volonté brutale et absurde qui le pousse à
persévérer dans son existence coûte que coûte. Il éprouve cette volonté comme désir. Le
concept de désir chez Schopenhauer, pour rendre compte de la condition humaine, est
déterminant : l’existence humaine balance en effet entre le manque (car le désir est manque
de l’ « autre » et, donc, souffrance) et l’ennui (car un désir satisfait laisse un goût de mort, la
mort étant l’arrêt du mouvement qui nous maintient dans la vie), d’où le « désir » de sortir de
l’ennui pour entrer de nouveau dans le désir pur, c’est-à-dire, paradoxalement, dans la
souffrance. Tout ce qui concerne l’homme est ramené par Schopenhauer à ce socle. Vie bien
douloureuse ! Or il se trouve que la volonté a aussi produit l’antidote ! L’art. L’art est en
effet pensé par Schopenhauer comme l’acte de représentation du monde qui, contrairement à
la science, génère un certain plaisir. L’artiste est précisément celui qui propose une sorte
« d’arrêt sur image » du flot violent de la vie et de l’existence et qui permet ainsi à l’homme
de s’en reposer un peu ; un peu car l’art n’arrête pas réellement le mouvement de la volonté.
Parmi les arts se trouve un art que Schopenhauer reconnaît comme majeur dans le cadre de
son système : la musique, car celle-ci permet non seulement une distanciation (certes
provisoire) par rapport à la volonté brutale, mais en même temps elle révèle la « vérité » de
cette dernière : elle révèle le fond des choses, contrairement à la science qui n’en donne
qu’une représentation subjective (quoique universelle car rationnelle), elle révèle le
mouvement, la continuité de la volonté, cela même dont nous cherchons à nous reposer ; elle
révèle donc à l’homme ce qu’il cherche à fuir par l’art même.
L’art musical
1
a donc pour Schopenhauer, au-delà d’un pouvoir consolateur, un pouvoir
révélateur (révélation du fond de la réalité : le « noumène » du réel, en deçà du phénomène,
pour reprendre la terminologie kantienne que Schopenhauer reprend mais dans sa propre
perspective). Le « salut » commence donc par l’art mais ne s’y trouve pas : Schopenhauer,
lecteur des textes sacrés de l’Inde, les Upanishad, pense qu’il se trouve dans l’ascétisme
qu’il regarde, comme le bouddhisme, comme une certaine victoire sur le désir (sur la
volonté, donc) car le désir est alors réduit à sa plus minime expression sans avoir à payer le
prix de la mort qui est le moment de sa totale extinction.
N.A
1
Même si la musique écoutée est « difficile ». Et l’art est toujours difficile en tant qu’il ouvre les yeux et empêche d’en rester
« là » ! Etc.
1
/
2
100%