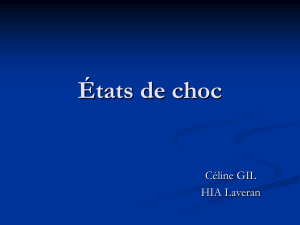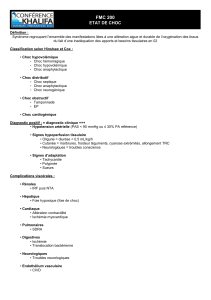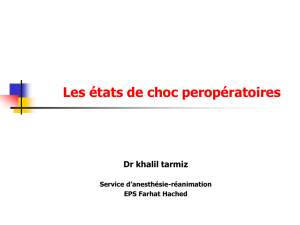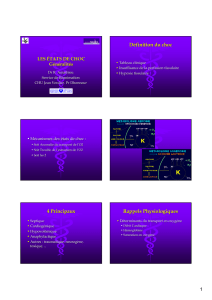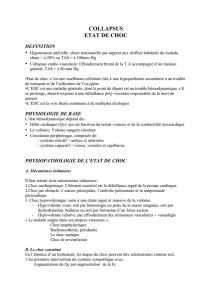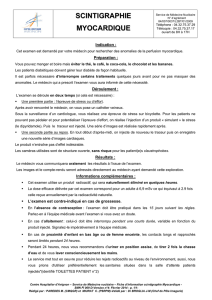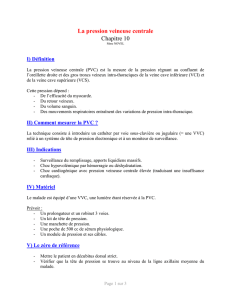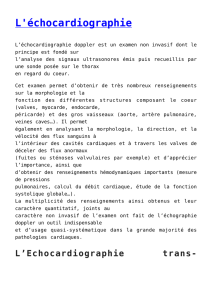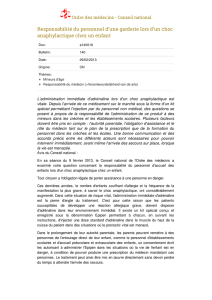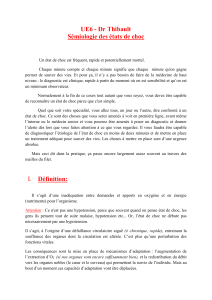UE 4.3. S4 Année 2010-2011 L.DARRAS LES ETATS DE CHOC

UE 4.3. S4 Année 2010-2011
L.DARRAS
1
LES ETATS DE CHOC
1. DEFINITION
L’état de choc se caractérise par une défaillance de la microcirculation, responsable d’une
hypo perfusion cellulaire aiguë et durable.
L’apport d’oxygène aux tissus n’est plus adapté à leurs besoins → une souffrance cellulaire.
L’altération profonde des conditions hémodynamiques entraîne une ischémie irréversible des
organes cibles.
2. PHYSIOLOGIE Une hémodynamique normale implique :
Un volume circulant normal (volémie 5 à 6 litres) et un retour
veineux suffisant
Une contractilité myocardique efficace
Une circulation périphérique normale : est constituée d’un
réseau capillaire contenant 6 à 7% de la masse sanguine, mais
est capable de stocker un volume plus important.
La vasomotricité est régulée par le système sympathique qui agit
par l’intermédiaire d’hormones appelées catécholamines
(adrénaline, noradrénaline) dont le site d’action est constitué de
récepteurs spécifiques.
3 acteurs cardio-vasculaires sont à la base de la physiologie d’un
choc. Ce sont :
- la pompe cardiaque,
- le contenant ou lit vasculaire,
- et enfin le contenu ou masse sanguine.
Une altération de l’un ou plusieurs de ces composants peut conduire à
un état de choc.
PHYSIOPATHOLOGIE (physiologie commune des états de choc)
On peut définir plusieurs types de chocs, en fonction de l’atteinte initiale de l’un ou l’autre
des composants :
Une atteinte de la pompe cardiaque → choc cardiogénique
Le cœur peut être :
→ soit le principal responsable par défaillance myocardique (ex. IDM)
→ soit victime (pneumothorax suffocant, tamponnade …)

UE 4.3. S4 Année 2010-2011
L.DARRAS
2
Une atteinte de la masse sanguine lors d’une hémorragie massive par exemple,
donnera → choc hypovolémique
Une atteinte du lit vasculaire, que l’on trouve en cas de réaction anaphylactique
ou d’infection grave par exemple. → choc anaphylactique ou choc septique
Après ce point de départ initial, un état de choc constitué se déroule
schématiquement en plusieurs étapes.
LA DEFAILLANCE HEMODYNAMIQUE INITIALE
Elle entraîne une baisse de la perfusion des tissus. L’hypo perfusion tissulaire induit une
diminution de l’oxygénation des cellules, avec activation de la voie énergétique
anaérobie qui produit moins d’énergie et rejette des lactates dans la circulation.
Pour compenser cette défaillance, le système sympathique est activé (libération intense
de catécholamines) ce qui permet :
D’augmenter le débit cardiaque par augmentation de la fréquence et de la
contractilité myocardique
De préserver la vascularisation des organes nobles (cerveau, cœur, foie) au dépend
des circulations cutanéo-muqueuses, rénales et de l’appareil digestif, qui sont le siège
d’une vasoconstriction intense.
LE CHOC EST ALORS COMPENSE
L’ANOXIE TISSULAIRE
Elle entraîne une cascade de réactions cellulaires et humorales. Le déversement de
métabolites cellulaires de l’anaérobiose (lactates, histamine, kinines) dans la circulation
entraîne une vasodilatation et des troubles de la perméabilité de la paroi des
vaisseaux qui impliquent une fuite liquidienne vers les espaces extracellulaires. Ces 2
phénomènes aggravent la mécanique circulatoire déjà altérée.
L’anoxie cellulaire favorise également des troubles de la coagulation (agrégation
plaquettaire, activation locale des facteurs de coagulation).
Le choc entre alors dans un cercle vicieux et devient décompensé. Il tend à devenir
irréversible.
Retentissement viscéral de l’état de choc.
Il est secondaire aux troubles vasomoteurs et à la souffrance cellulaire et peut aboutir à
un syndrome de défaillance multi viscéral (SDMV).

UE 4.3. S4 Année 2010-2011
L.DARRAS
3
3. DIAGNOSTIC de l’ÉTAT DE CHOC
Signes cardiovasculaires
Tachycardie : pouls rapide (Fc >100b/min) et filant, ou bradycardie paradoxale de
mauvais pronostic.
Hypotension : PA systolique < 80 mmHg
Pâleur intense au niveau du visage
Marbrures au niveau des membres inférieurs
Cyanose (coloration bleue des muqueuses) localisée aux extrémités, c’est-à-dire
aux lèvres, aux ongles et aux lobules des oreilles.
Signes respiratoires
Polypnée ou tachypnée superficielle (Fr > 20c/min). Une bradypnée est de
mauvais augure.
Sudation abondante signe d’hypercapnie (augmentation du CO2).
Signes urinaires
Baisse de la diurèse : oligurie (diurèse inférieure à 30 ml/h) ou anurie (absence de
diurèse).
Signes neurologiques. Ils sont essentiellement neuropsychiques :
Angoisse, agitation ou prostration.
4. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Le collapsus est un symptôme hémodynamique, caractérisé par une chute brutale de la
pression artérielle sans souffrance cellulaire.
5. LES DIFFERENTS CHOCS
5.1 CHOCS HYPOVOLEMIQUES
Ils se caractérisent par une inadéquation brutale entre le contenant (les vaisseaux) et le
contenu (le sang) par perte liquidienne.
→ soit par hémorragie extériorisée que l’on doit essayer de quantifier
→ soit par hémorragie interne dans une cavité naturelle (péritoine, tube digestif) ou dans
un tissu (hématome)
→ soit par perte de plasma : brûlure..
→ soit par perte d’eau (3ème secteur) ou perte de sel (déshydratation aiguë)

UE 4.3. S4 Année 2010-2011
L.DARRAS
4
Volémie : 70 mL/kg chez l’adulte
Amputation de la volémie de 20% → choc
Dans le choc hypovolémique, la diminution du retour veineux se traduit par une diminution
de la PVC.
La PVC équivaut à la pression de remplissage de l’oreillette droite et est le reflet partiel
du remplissage du cœur gauche et donc du fonctionnement cardiaque.
Signes de CHOC + PVC basse (< 5cmH2O)
= choc hypovolémique
5.2. CHOCS CARDIOGENIQUES
Ils se caractérisent par une chute du débit cardiaque avec incapacité de la pompe cardiaque
à assurer les besoins tissulaires en oxygène.
Une faillite myocardique peut en être la cause (ex : IDM). L’état de choc survient par
insuffisance cardiaque ou par l’apparition de troubles du rythme.
Cela peut aussi être un défaut de remplissage avec risque de désamorçage de la pompe. C’est
le cas de la tamponnade cardiaque, de la dissection aortique etc.
En fait le choc cardiogénique est dû à un dysfonctionnement cardiaque avec une
volémie efficace. On observe une augmentation des pressions en amont du cœur avec une
augmentation de la pression veineuse.
5.3. CHOC PAR VASOPLEGIE INITIALE
La dilatation des vaisseaux entraîne une hypo volémie relative, responsable d’une
augmentation de la fréquence cardiaque.
CHOC SEPTIQUE
Il se caractérise par une défaillance circulatoire due à la libération de toxines
bactériennes ou virales, voir de levures.
Au début, il s’agit d’un choc vasoplégique.
Cette phase réversible appelée choc hyperkinétique se traduit cliniquement par :
Tachycardie
Une PA normale ou augmentée
Des sueurs
Une rougeur des téguments
Une polypnée

UE 4.3. S4 Année 2010-2011
L.DARRAS
5
Les mécanismes physiologiques de compensation du choc sont encore efficaces. Les
germes responsables sont surtout les bacilles gram négatif ou positif.
Secondairement, l’état de choc évoluera vers une chute du débit cardiaque avec
altération myocardique due aux endotoxines bactériennes (toxines sécrétées par les
bactéries entraînant la libération dans l’organisme de substances vasoactives)
Cette 2ème phase est appelée choc hypokinétique.
Les systèmes de compensation sont dépassés et le choc devient irréversible.
Pour le choc septique l’antibiothérapie est une urgence thérapeutique
CHOC ANAPHYLACTIQUE
Il s’agit d’une réaction immunologique entre un antigène (apporté de l’extérieur) et un
anticorps (présent dans l’organisme) qui est à l’origine d’une vasoplégie brutale et intense.
Il n’existe actuellement aucun moyen efficace de prévenir la survenue d’un accident
anaphylactique. Il faut donc être prêt à y faire face à tout moment.
La prise en charge est bien codifiée
Cf protocoles SAU
6. TRAITEMENT DE L’ETAT DE CHOC
Les buts du traitement sont de corriger les désordres hémodynamiques et d’améliorer
l’apport d’oxygène au niveau tissulaire. La compréhension des mécanismes de choc est
indispensable pour adapter au mieux la prise en charge hémodynamique.
En dehors des circonstances de survenue, un minimum d’examens paracliniques permettra
d’orienter la réflexion (température, ECG, enzymes cardiaques, radiographie du thorax
NFS, ECBU…).
La PVC permettra grossièrement de différencier un choc cardiogénique (PVC
>12cmH2O) d’un choc non cardiogénique (PVC<5cmH2O). La mise en place d’un cathéter
artériel permettra de réaliser une surveillance continue de la pression artérielle et
facilitera les prélèvements sanguins nombreux et indispensables.
Remplissage : le but étant de restaurer la volémie, d’améliorer la microcirculation et
d’augmenter le débit cardiaque.
o Les cristalloïdes qui contiennent de l’eau et des ions : Ringer-lactate et sérum
physiologique
o Les colloïdes : Plasmion, Voluven…
o Le sang : transfusion de concentrés érythrocytaires en cas d’hémorragie.
L’assistance respiratoire
o O2 nasal ou au masque si le patient est en ventilation spontanée satisfaisante
o Intubation oro-trachéale et ventilation contrôlée en FiO2 élevée en cas de
détresse respiratoire.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%