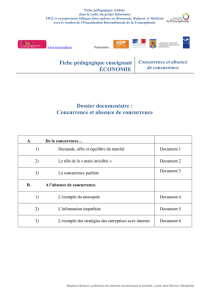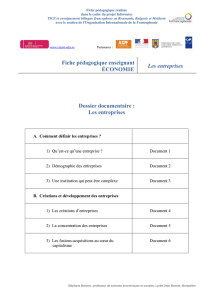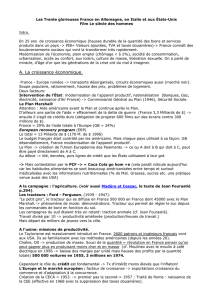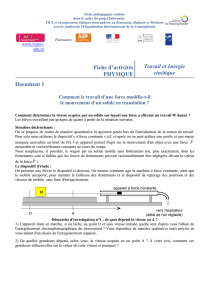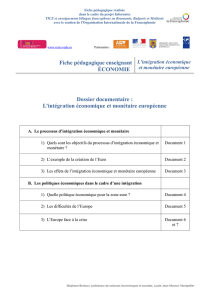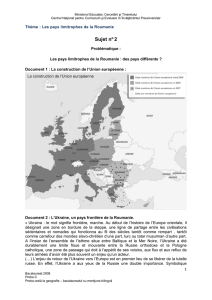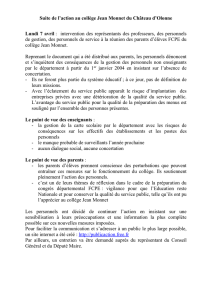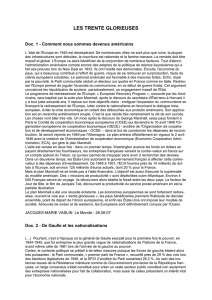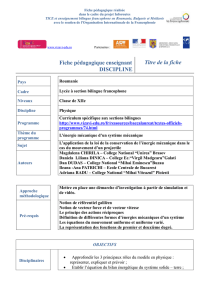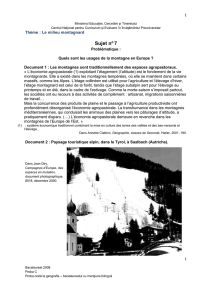Télécharger la fiche

Fiche pédagogique réalisée
dans le cadre du projet Inforoutes
TICE et enseignement bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie
avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie
www.vizavi-edu.ro Partenaires :
Fiche pédagogique enseignant
ÉCONOMIE
Stéphane Boisson, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Jean Monnet, Montpellier
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
La consommation :
entre satisfaction et
construction des besoins
Dossier documentaire :
La consommation : entre satisfaction et construction des besoins
A. Comment peut-on expliquer les besoins de
consommations ?
1) Utilité marginale et satisfaction des besoins de
consommations
Document 1
2) Les changements économiques et sociaux influencent
les besoins
Document 2
B. Besoins et société de consommation
1) Comportements mimétiques et ostentatoires
Document 3
2) Doit-on repenser les besoins de consommation ?
Exercice de
synthèse et
argumentation

Fiche pédagogique réalisée
dans le cadre du projet Inforoutes
TICE et enseignement bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie
avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie
www.vizavi-edu.ro Partenaires :
Fiche pédagogique enseignant
ÉCONOMIE
Stéphane Boisson, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Jean Monnet, Montpellier
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
La consommation :
entre satisfaction et
construction des besoins
Document 1 : Le principe de l’utilité marginale décroissante
Pour ceux qui sont à l’origine de ce nouveau courant, l’Anglais Stanley Jevons (1835-1882), l’Autrichien Karl
Menger (1840-1921) et le Français Léon Walras (1834-1910), il existerait – au-delà de la diversité des goûts
individuels – une « loi psychologique » selon laquelle la satisfaction procurée par la consommation d’un bien
augmente avec la quantité qui en est consommée, cette augmentation se faisant à un rythme de plus en plus faible,
de sorte qu’il y ait saturation progressive , mais jamais totale. Cette « loi psychologique » - qui pour certains, tel
Jevons, s’explique par des raisons physiologiques- a été appelée loi de l’utilité marginale décroissante, le mot
« utilité » désignant la satisfaction, ou le plaisir, alors que l’adjectif « marginale » attire l’attention sur le fait que
c’est l’utilité de la dernière unité consommée qui diminue lorsque la consommation augmente. Ainsi, pour prendre
un exemple simple, si la consommation d’une pomme procure une utilité égale à 10, celle de deux pommes une
utilité de 15, et celle de trois pommes une utilité de 18, alors l’utilité marginale de la deuxième pomme est égale à
15-10 = 5 tandis que celle de la troisième est de 18 – 15 =3. Comme 3 < 5, la loi de l’utilité marginale décroissante
est bien vérifiée, du moins dans cet exemple.
Le choix du consommateur
Les marginalistes – nous appellerons ainsi les tenants de la loi de l’utilité marginale décroissante- vont utiliser une
telle « loi » pour expliquer la valeur des biens, en s’appuyant sur l’idée que les individus cherchent à obtenir la
satisfaction – ou le plaisir – le plus grand possible (ils ont un comportement hédoniste) et qu’ils sont rationnels,
c’est-à-dire qu’ils agissent dans le but d’atteindre cet objectif. Ainsi, le problème du consommateur – dont on
suppose qu’il est hédoniste et rationnel – est de choisir le panier de biens qui maximise son utilité, compte tenu de
ce qu’il dispose de ressources limitées (il subit une contrainte budgétaire). Ce choix dépend donc de la forme de sa
fonction d’utilité (de ses goûts), mais aussi du prix des biens. Plus précisément, il est tel que le rapport entre
l’utilité marginale et le prix de chaque bien soit le même pour tous les biens composant le panier retenu.
En effet, si tel n’était pas le cas, le consommateur pourrait augmenter son utilité en modifiant ce panier. Ainsi, si le
rapport entre l’utilité marginale et prix était plus grand pour le bien A que pour le bien B, alors le consommateur
aurait intérêt à vendre du bien B et à acheter du bien A avec la somme obtenue ; le panier considéré ne
correspondrait donc pas une utilité maximale. Et ce raisonnement est valable quels soient les biens A et B
considérés.
La « condition d’optimalité » qui vient d’être établie – égalité des rapports entre utilités marginales et prix, pour
chaque bien – peut aussi s’énoncer de la façon suivante : le panier qui maximise l’utilité sous la contrainte
budgétaire est tel que l’utilité marginale de chacun des biens qui le composent soit proportionnelle au prix de ce
bien, le coefficient de proportionnalité étant le même pour les biens. Ce coefficient dépend du revenu, puisque, si
celui-ci augmente, la contrainte budgétaire est moins « serrée », de sorte que la consommation des biens augmente
et que les utilités marginales diminuent ; comme on suppose les prix fixés, le rapport entre utilités marginales et
prix – c’est-à-dire notre coefficient de proportionnalité – diminue. D’ailleurs, les microéconomistes appellent ce
rapport utilité marginale du revenu.[…]
La loi de la demande
Lorsqu’un individu a déterminé le paner de biens qui maximise son utilité, il cherche à acquérir un tel panier et
formule donc des demandes pour chacun des biens qui le composent. Ces demandes dépendent évidemment des
prix de ces biens et on les représente généralement par une courbe (Cournot [1801-1877] a été le premier à utiliser
cette représentation, mais c’est Walras puis, surtout Marshall [1842-1924] qui ont mis en avant le lien entre
demande et maximisation de l’utilité).
Quelle est la forme des courbes de demande ? La réponse à cette question semble aller de soi : décroissante. N’est-
il pas évident que, lorsque le prix d’un bien augmente, on cherche à en acquérir moins, quitte à reporter ses achats
sur d’autres biens ?
Le propos des théoriciens marginalistes n’était pas pourtant d’en rester aux « évidences », mais de montrer que la

Fiche pédagogique réalisée
dans le cadre du projet Inforoutes
TICE et enseignement bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie
avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie
www.vizavi-edu.ro Partenaires :
Fiche pédagogique enseignant
ÉCONOMIE
Stéphane Boisson, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Jean Monnet, Montpellier
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
La consommation :
entre satisfaction et
construction des besoins
décroissance de la courbe de demande (de n’importe quel bien) est une conséquence de la maximisation de l’utilité
par les individus.
Bernard Guerrien, La microéconomie, La pensée économique contemporaine, T.1, Points Seuil, 1995.
Questions
1) Définissez les termes soulignés dans le document. (n’oubliez pas que certains termes peuvent avoir un sens
courant et un sens économique différents).
2) Représenter graphiquement ci-dessous la courbe de la demande en fonction du prix.
3) Quelle vision ont les marginalistes de l’individu consommateur ?
4) Selon les marginalistes, quelles variables déterminent les comportements de consommation ?

Fiche pédagogique réalisée
dans le cadre du projet Inforoutes
TICE et enseignement bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie
avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie
www.vizavi-edu.ro Partenaires :
Fiche pédagogique enseignant
ÉCONOMIE
Stéphane Boisson, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Jean Monnet, Montpellier
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
La consommation :
entre satisfaction et
construction des besoins
Document 2 : Deux villages
Ces deux villages s’appellent l’un Madère, l’autre
Cessac. Le lecteur reconnaîtra sans peine dans le
premier un village « sous-développé » ; dans le second
éclatent les traits majeurs du développement
économique.
Le village de Madère - je pourrais écrire la paroisse de
Madère, car tous ses habitants sont chrétiens baptisés, la
majorité pratique chaque dimanche, et de mémoire
d’homme, l’on n’y a encore vu que quatre enterrements
civils - a d’après les chiffres du recensement, 534 hab.
Les quatre cinquièmes sont nés à Madère ou dans des
paroisses voisines, distantes de moins de 20 km, soit
moins de quatre heures de marche. Cela marque déjà un
certain acheminement vers des temps nouveaux car,
cinquante ans plus tôt, c’étaient 97 % des habitants qui
étaient nés sur le terroir.
Sur ces 534 habitants, 40 ont plus de 70 ans, et 210
moins de 20 ans. Il y a environ 12 naissances en
moyenne par an, et 8 décès, dont près de 3 chaque deux
ans sont des décès de bébés de moins d’un an. Tous ces
chiffres sont très inférieurs à ceux qui étaient
enregistrés à Madère au siècle précédent, où la mortalité
infantile dépassait 30 %, la natalité 40 %. Mais la
plupart des autres éléments du niveau de vie et du genre
de vie des habitants de Madère sont restés très proches
de ce qu’ils étaient à la fin du 19ème siècle. Par
exemple, la taille moyenne des adolescents à l’âge de
20 ans est de 165 cm pour les garçons et de 155 cm
pour les filles. Très peu d’enfants dépassent le niveau
de l’école primaire élémentaire, où l’on apprend à lire, à
écrire la langue nationale et à compter. J’ai sous les
yeux la liste des enfants nés à Madère depuis 1921 et
qui ont atteint ou dépassé le « niveau baccalauréat » : ils
sont moins de 50 sur 4000 enfants nés vivants.
Des 534 habitants de Madère, 279 sont recensés dans la
population active ; les autres étant des jeunes de moins
de 14 ans, des femmes « ménagères », et une quinzaine
de personnes désignées comme « retraités » : ces
retraités sont le petit nombre des hommes, nés pour la
plupart à Madère, qui ont fui la misère dans leur
jeunesse en obtenant des postes dans l’administration
publique (postes, contributions fiscales...) et dans
l’armée. De ces 279 « actifs », 208 sont agriculteurs, 27
artisans (maçons, menuisiers, charpentiers, un tonnelier,
maréchaux-ferrants, meuniers, cordonniers, tailleurs...)
et 12 commerçants : il y a en effet un très petit
commerce, trois ou quatre « boutiques », deux épiceries
- merceries, une boulangerie, une boucherie. Le boucher
ne travaille d’ailleurs qu’à temps partiel ; il ne vend en
général que du mouton, et seulement deux jours par
semaine. Les 19 personnes recensées comme «
employés » sont 5 instituteurs ou institutrices, le
receveur des postes et le facteur, la secrétaire de mairie,
le garde champêtre et quelques femmes de ménage
journalières, laveuses et « bonnes à tout faire ». Une
dizaine d’ouvriers non agricoles (cantonniers,
mécaniciens...) complètent les 279, qui ne comprennent
que 2 « cadres ou techniciens », le curé et un docteur en
médecine, qui, d’ailleurs, a quitté Madère peu après le
recensement, non bien sûr faute de malades, mais faute
de clients solvables. Les 208 agriculteurs sont groupés
en 92 « exploitations agricoles » dont la superficie
moyenne en culture est de l’ordre de 5 ha. Aucune
exploitation ne dépasse 20 ha. Ces 208 travailleurs
agricoles ne disposent en tout que de deux tracteurs,
souvent hors d’usage par bris d’une pièce dont la «
rechange » manque et ne peut être obtenue qu’après des
délais variant de quelques jours à quelques semaines.
L’auxiliaire fondamental du travailleur reste le boeuf
(parfois la vache mi-laitière, mi-charretière), quelques
chevaux et encore plusieurs ânes et mulets.
L’engrais chimique est très peu utilisé ; on « fume » la
terre avec le fumier des grands animaux, avec appoint
des poules, lapins, canards et dindons... Le rendement
par hectare cultivé ne peut, dans ces conditions, qu’être
très faible : à peine supérieur aux chiffres du 19ème
siècle. En année moyenne, le blé rend 7 à 8 fois la
semence ... L’alimentation forme les trois quarts de la
consommation totale. Elle est cependant pour sa moitié
composée de pain et de pommes de terre ; chaque
exploitation agricole élève un porc et une trentaine de
têtes de petits animaux, dont la consommation fournit
les trois quarts de la consommation de viande de la
famille. Une seule fois par semaine, en moyenne, on
achète et on consomme de la viande de boucherie, en
petite quantité et, s’il s’agit de bœufs, en qualité très
médiocre. Le beurre est inconnu ; le fromage n’est
consommé que dans sa forme locale. La base de
l’alimentation, plus de la moitié des calories absorbées,
est la soupe de pain et de légumes, à la graisse de porc.
Le reste de la consommation personnelle est
vestimentaire pour plus de sa moitié. Les dépenses de

Fiche pédagogique réalisée
dans le cadre du projet Inforoutes
TICE et enseignement bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie
avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie
www.vizavi-edu.ro Partenaires :
Fiche pédagogique enseignant
ÉCONOMIE
Stéphane Boisson, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Jean Monnet, Montpellier
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
La consommation :
entre satisfaction et
construction des besoins
loisirs sont très faibles ; ni les jeunes ni les adolescents
ne reçoivent d’argent de poche. En dehors du service
militaire et de la guerre, la grande majorité des
habitants de Madère n’a fait de voyage que son voyage
de noce et quelques pèlerinages. On aura une image
concrète du niveau de consommation de cette
population, si l’on apprend que pour acheter 1 kilo de
pain, le travailleur moyen de Madère doit travailler 24
mn, contre 10 à Cessac. Mais il doit travailler une
journée entière de 8 h à Madère pour gagner
l’équivalent du prix d’un poulet, que le Cessacois
moyen gagne en 11 fois moins de temps ! L’écart est
encore plus fantastique pour certains produits
manufacturés ... pour la radio, de 300 à 20. C’est dire
que Cessac appartient à un pays hautement développé,
où le niveau de vie moyen est de 4 à 5 fois plus élevé
qu’à Madère.
Jean Fourastié, Les trente glorieuses, 1979.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%