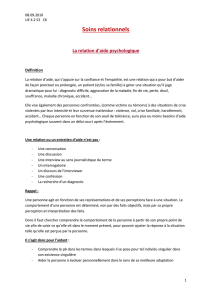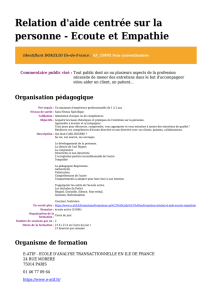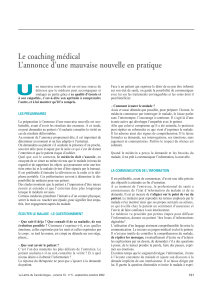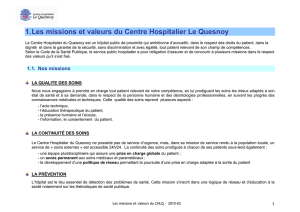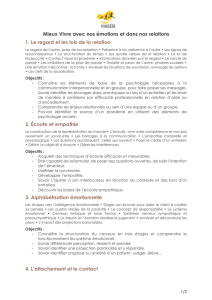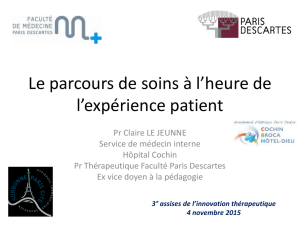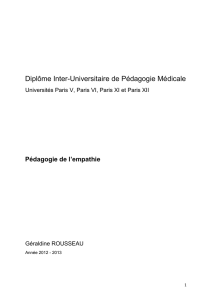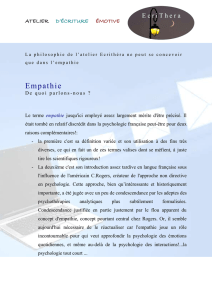berthoz a, jorland g

1 BERTHOZ A, JORLAND G. (Sous la direction de): "L'empathie", Editions Odile Jacob, Paris,
2004.
1' BERTHOZ A, JORLAND G, SIRONI F, DEPRAZ N : "L'empathie", Document audio
phonique de France culture, Emission "La vie comme elle va ", jeudi 16 décembre, 15h00,
décembre 2004.
Contexte et place dans ma thèse : faire la part entre intuition, sympathie et empathie. Passer du survol
nécessaire pour la vue d'ensemble, à la navigation autour der réseaux et des hommes pour poser et
chercher des bornes et des repères puis à la rencontre et le terrain en faisant la différence entre moi et
l'autre, voir près des corps et parler de la souffrance, des soins et des regards...
1 BERTHOZ A, JORLAND G. (Sous la direction de): "L'empathie", Editions Odile Jacob, Paris,
2004.
Page 7 : " C’est à résoudre ce paradoxe de l’ambivalence de l’homme à l’égard de ses semblables qu’est
conviée la faculté d’empathie, une aptitude à se mettre à la place des autres, distincte de la sympathie et
qui rend compte de tous les élans solidaires et dont l’absence ou le déficit explique la cruauté au
quotidien ou au Champ d’honneur "
Page 8
" La conception d’un cerveau calculateur ,sorte d’ordinateur central qui traite les données que lui
fournissent les capteurs sensoriels périphériques à laide de programmes innés ou acquis, comme, en tout
premier lieu, le langage Cette conception issue de la philosophie du langage d’inspiration chomskyenne
plonge ses racines dans la philosophie analytique. L’autre conception fait du cerveau un simulateur du
monde extérieur, programmé par des modèles internes en vue de l’action. Le cerveau projette dans le
monde ses élucubrations et se sert des informations que lui donnent en retour les capteurs sensoriels
périphériques pour en tester la pertinence, à moins qu’il ne s’en remette à eux pour en assurer la
réalisation. Cette conception s’inscrit dans la tradition phénoménologique."
Pages 14 et 15
" Se mettre à la place de l’autre, adopter son point de vue, se transposer à son point zéro d’orientation,
rien de tout cela n’a de sens si le sujet est incapable de troquer un système de référence centré sur lui-
même contre un système centré hors de lui-même et notamment sur autrui Cette analyse
neurophysiologique du changement de point de vue lui permet de penser le problème du fanatisme
sectaire et de son exploitation par l’endoctrinement dont il explique la terrible efficacité par le fait qu’au
lieu de changer librement de points de vue, de les multiplier pour saisir toute la complexité et la beauté
des choses, de laisser jouer la diversité des opinions et des regards sur le monde et sur les autres, au lieu
de se jouer des pièges du narcissisme de l’égocentrisme, le sujet se limite délicieusement au seul point
de vue d’un chef, ou d’un gourou, auquel il s’identifie. Il s’enferme ainsi dans un système de référence
égocentré qui ne donne du monde qu’une image en noir et blanc, détruisant ainsi la faculté d’empathie,
et de sympathie, destruction source de haine."
Page 20 et 21
"Une remarque s’impose au préalable. Il convient de distinguer, ce que ne font pas toujours les auteurs
dont il sera question, l’empathie et la sympathie. L’empathie consiste à se mettre à la place de l’autre
sans forcément éprouver ses émotions, comme lorsque nous anticipons les réactions de quelqu’un ; la
sympathie consiste inversement à éprouver les émotions de l’autre sans se mettre nécessairement à sa

place, c’est une contagion des émotions, dont le fou rire peut être considéré comme typique. Autrement
dit, on peut être empathique sans éprouver de sympathie de même qu’on peut avoir de la sympathie sans
être empathique ".
Pages 32 et 33
"Martin Hoffman a proposé une ontogenèse des sentiment moraux et de justice à partir de l'empathie. Là
encore, les définitions sont idiosyncrasiques. Alors que la plupart des auteurs distinguent la détresse en
retour de l'empathie, il identifie les deux et parle de "détresse empathique "qu'il définit comme un
sentiment d'aversion pour la détresse physique, émotionnelle ou économique d'autrui", tel qu'on cherche
à le faire disparaître. Et c'est la manière dont l'individu s'y prend pour le faire disparaître qui va le
constituer en sujet, égocentrique dans un premier temps puis altruiste dans un second. "
Pages 34 et 35
"Hoffman montre que l'empathie conduit à sélectionner un principe de justice égalitaire ou de répartition
selon les besoins, c'est-à-dire la théorie de la justice de Rawls Celle-ci est en effet fondée sur ce que
Rawls appelle le "principe de différence" qui articule les deux principes d'égalité et d'équité : le mérite
ne justifie une répartition inégale des ressources que s'il bénéficie aux plus défavorisés. "
P 43 et 44 : « C’est Adam Smith qui a introduit, sinon le terme, du moins la réflexion contemporaine sur
le phénomène de l’empathie. Il conçoit la vie sociale comme un spectacle, dont chacun d’entre nous est
à la fois spectateur et acteur : nous regardons les autres vivre et nous vivons sous le regard des autres.
Mais le regard sur l’autre ne suffit pas à connaître l’autre : Comme nous n’avons aucune expérience
immédiate de ce que les autres hommes ressentent, écrit-il, nous ne pouvons nous faire aucune idée de la
manière dont ils sont affectés, sinon en concevant ce que nous ressentirions nous-même dans une
pareille situation. Bien que notre semblable soit dans les tourments, tant que nous sommes tranquilles,
nos sens ne nous informeront jamais de ce qu’il souffre ».
P 46 : « A force de vivre sous le regard des autres et de se mettre à leur place, le sujet finit par se faire
une idée d’un spectacle impartial qu’il va intérioriser –Adam Smith l’appelle the man within, l’homme
intérieur –et qui va constituer sa conscience, lui donnant un recours contre le jugement d’autrui et le
moyen de s’en libérer dans une certaine mesure. Autrement dit, chaque sujet va se juger à l’aune de sa
propre conscience, seule manière de distendre les mailles des regards croisés sur lui ».
P 48 et 49 : « On peut en effet montrer que l’empathie est une relation d’équivalence entre les
consciences : elle est réflexive, que ce soit sous la forme du cogito –je ne doute pas que je doute –ou du
stade du miroir ; elle est symétrique sous la forme de l’injonction : mets-toi à ma place !, je me mets à ta
place. Et elle est transitive sous la forme de l’injonction mets-toi à sa place ! Une relation réflexive,
symétrique et transitive est une relation d’équivalence ».
PSYCHOLOGIE COGNITIVE :
P 53 : « Dans ce chapitre, je développerai l’idée que l’empathie, définie comme la capacité à se mettre à
la place de l’autre pour comprendre ses sentiments et ses émotions, n’est pas seulement un outil
développé par les psychologues. C’est avant tout une capacité propre à la nature humaine qui repose sur
des systèmes neurologiques que l’on commence à comprendre. Nous sommes des animaux sociaux

assez particuliers, car non seulement nous passons une grande partie de notre existence à interagir avec
nos congénères, mais même lorsque nous faisons une promenade solitaire, nous pensons à eux ».
P 54 : « J’avance l’idée que l’empathie repose sur une simulation mentale de la subjectivité d’autrui en
m’appuyant essentiellement sur des travaux empiriques réalisés dans les sciences du comportement et
du cerveau. Cette simulation est possible parce que nous possédons une disposition innée à ressentir que
les autres personnes sont comme nous et parce que nous développons rapidement au cours de
l’ontogenèse la capacité de nous mettre mentalement à la place d’autrui ».
P 77 : « L’hémisphère droit et les régions qui sont engagées dans le traitement émotionnel sont
préférentiellement recrutés lorsque nous ressentons de la sympathie envers autrui. C’est ce que démontre
une étude dans laquelle les variations du débit sanguin cérébral ainsi que d’autres mesures
physiologiques, comme la réaction électrodermale, ont été mesurées chez des volontaires auxquels
étaient présentés des vidéo-clips d’acteurs racontent des histoires tristes ou neutres comme si elles leur
étaient arrivées. Les histoires neutres étaient fondées sur des évènements de la vie quotidienne, comme
faire des courses. Les histoires tristes se rapportaient à des événements qui peuvent survenir à n’importe
qui, comme la maladie d’un proche parent ou un décès par noyade. Il avait été demandé aux acteurs de
raconter chacune de ces histoires avec trois expressions émotionnelles différentes, neutres, gaie ou
triste ».
P 77 : « Les résultats montrent que lorsque les sujets écoutent des histoires racontées avec une
expression émotionnelle congruente (par exemple une histoire triste avec un ton et un visage tristes), ils
ressentent de la sympathie pour les acteurs. Dans ces conditions, les variations de débit sanguin cérébral
sont détectées dans les régions cérébrales impliquées dans le traitement des émotions ainsi que celles
impliquées dans les représentations motrices partagées. Ainsi ressentir de la sympathie, c’est non
seulement reconnaître l’état émotionnel d’autrui, mais c’est aussi se mettre à sa place dans la situation
qu’il décrit ».
PHILOSOPHIE :
Page 131 : « Improprement nommée jugement esthétique, l’évaluation, par exemple, que comporte le
sentiment de la beauté ou de la laideur exige le contraire de la mise à distance objectivante où un sujet
s’oppose à un objet. La valeur esthétique d’une forme perçue s’éprouve directement, comme libre
expansion (ou morne contrainte), par projection des vécus subjectifs dans l’objet perçu ».
Page 145 : « Un des rapports originaux de Husserl est d’assurer cette transition d’une Einfulhung
indifférenciée aux formes déterminées de la socialité (d’une sociologie compréhensive : Simmel,
Weber). La faiblesse d’une théorie de la relation à autrui fondée sur l’Einfulhung, c’est précisément
qu’elle est incapable de faire comprendre la diversification des rapports sociaux comme conditions
concrète de la relation à autrui. La difficulté est de savoir comment introduire une différenciation qui ne
soit pas purement arbitraire –en appeler aux conventions, et faire commencer le social au langage –mais
qui procède du même enracinement que l’Einfulhung elle-même dans l’expérience corporelle et
l’interaction pratique ».
Page 147 : « La doctrine cognitive des objets physiques dotés de propriétés mentales nous fait manquer
l’intersubjectivité. En vérité, l’autre n’est pas un objet déjà tout constitué auquel j’attribuerais des états
mentaux en plus de ses états physiques. L’autre est pour moi parce qu’il a valeur d’être pour moi en tant
qu’alter ego, une valeur qui le distingue absolument des simples choses, qui n’en ont pas moins, elles
aussi, une certaine valeur d’être. Remontant des profondeurs de l’enracinement corporel de chacun, nos

contributions respectives s’éprouvent comme indispensables à la constitution d’un monde commun.
L’autre est pour moi en tant que sujet constituant égal en dignité à moi-même ».
L’EMPATHIE ET SES DEGRES
Page 150 : « Par empathie, on désigne aujourd’hui la capacité de se mettre à la place d’autrui afin de
comprendre ce qu’il éprouve. L’empathie, ainsi caractérisée, se distingue à la fois de la sympathie, de la
contagion émotionnelle et du phénomène plus général de la simulation d’autrui. Les distinctions qui
seront proposées ici sont quelque peu arbitraires dans la mesure où l’usage de ces termes a fluctué, mais,
au-delà de l’arbitraire des étiquettes, il existe des différences réelles entre les phénomènes concernés. La
contagion émotionnelle désigne le phénomène de propagation d’une émotion d’un individu à d’autres.
C’est un phénomène bien connu de la psychologie des foules et qui se rencontre également chez les
bébés, qui répondent aux pleurs d’un autre bébé en commençant eux-mêmes à pleurer. On s’accorde
généralement pour penser que la contagion émotionnelle se caractérise par une forme d’indifférenciation
entre soi et autrui, soit, dans le cas des bébés, que les bases de cette différenciation ne soient pas encore
suffisamment établies, soit, dans le cas des phénomènes de foule, que l’on assiste à une forme
d’abolition momentanée de la distinction des moi individuels confondus en un moi collectif. L’empathie
se distingue de la sympathie sur un autre plan. Dans les deux cas, la distinction soi/autrui est préservée.
La différence essentielle entre les deux phénomènes tient, selon Wispé, aux fins poursuivies. La
sympathie, comme son étymologie l’indique, suppose que nous prenions part à l’émotion éprouvée par
autrui, que nous partagions sa souffrance ou plus généralement son expérience affective. La sympathie
met en jeu des fins altruistes et suppose l’établissement d’un lien affectif avec celui qui en est l’objet.
L’empathie en revanche est un jeu de l’imagination qui vise à la compréhension d’autrui et non à
l’établissement de liens affectifs ».
Page 180 : « Je voudrais, en guise de conclusion, revenir sur les fonctions de l’empathie. Jusqu’ici j’ai
surtout mis l’accent sur son rôle d’instrument de la connaissance des émotions d’autrui. Si l’empathie a
bien cette fonction épistémique, ce n’est pas là sa seule utilité. J’ai déjà indiqué, en parlant de la
référence sociale, un autre rôle qu’elle peut jouer. Nous interprétons les émotions d’autrui comme des
commentaires sur des situations ou des événements. L’empathie peut ainsi être un vecteur de
transmission de connaissances sur le monde. Mais c’est sur une autre fonction de l’empathie que je
voudrais maintenant attirer l’attention. J’ai mentionné plus haut les émotions dites sociales, telles que la
fierté, la honte, la culpabilité, le mépris, qui se caractérisent par leur objet double : la personne qui en est
la cible, soi-même ou autrui, et le comportement ou trait de caractère sur lequel porte l’évaluation. Ces
émotions ont deux autres caractéristiques importantes : elles font intervenir les notions de responsabilité
personnelle et de normes sociales. Ce qui m’intéresse particulièrement ici sont les émotions sociales
portant sur nous-mêmes et leur dimension normative ».
PHYSIOLOGIE DU CHANGEMENT DE POINT DE VUE
Page 254 : « Il peut paraître audacieux de spatialiser le problème de l’empathie. Il y a pourtant à cela
plusieurs raisons. D’abord le fait que changer de point de vue c’est changer de référentiel, c’est-à-dire
résoudre un problème spatial. Se mettre à la place de l’autre, c’est adopter le regard de l’autre. Changer
de point de vue, c’est changer de perspective. De plus, l’empathie est mon propre regard (dans le sens le
plus fort et plein du mot) que je porte sur le monde à la place de l’autre. Or, la physiologie du regard est
une physiologie des manipulations de l’espace par l’action, l’émotion, l’attention et l’intention ».
Page 260 : « Cette stratégie typique de ce que nous appelons la stratégie égocentrée de navigation fait
intervenir le regard, rivé à l’espace comme référence dans le guidage de la locomotion. Puis, peu à peu,

l’enfant dissocie son regard de sa navigation. Je pense que cela correspond à l’acquisition de la stratégie
dite de survol qui lui permet de s’affranchir du caractère séquentiel de la navigation égocentrée et de
commencer à changer de point de vue pour envisager des chemins variés, des détours, etc. Il n’est plus
prisonnier du déroulement pas à pas de son exploration du monde, il peut prendre de la hauteur, pour
ainsi dire. Ma thèse est que cette évolution est fondamentale pour toutes les fonctions cognitives et
notamment pour la capacité de prendre le point de vue de l’autre ».
Page 263 : « Ce n’est pas seulement non plus être comme l’autre : Gérard Jorland insiste sur la
différence entre sympathie et empathie dans son chapitre. Par conséquent, le secret de l’empathie ne se
trouve pas seulement dans les neurones miroirs. Il ne réside pas non plus seulement dans la capacité de
simuler mentalement les actions de l’autre ou d’en éprouver les émotions. Il exige cette capacité de
changer de point de vue tout en gardant le sentiment de soi ».
« La première de ces stratégies cognitives peut être appelée la stratégie de route. Elle consiste à se
souvenir des mouvements, des tournants, des translations que nous avons effectués et de les associer à
des repères visuels que nous avons remarqués. C’est pour cela que je l’ai nommée kinesthésique car elle
inclut la mémoire des kinesthèses au sens où, par exemple, Husserl l’emploie. L’environnement y est
construit par le cerveau à partir de visées successives, de points de vue séquentiellement organisés. Elle
est épisodique car elle peut aussi comprendre des événements complexes comme la rencontre d’une
personne, un évènement inattendu, etc. Elle est fondamentalement égocentrée, le point de vue de
l’analyse du monde est à la première personne. Nous avons montré qu’elle est sous-tendue par un réseau
neuronal qui implique particulièrement des couples d’aires pariéto-frontales et certaines aires temporales
comme le parahippocampe qui code des scènes visuelles liées à l’environnement. L’importance en est
que l’imagination de notre trajet est une véritable simulation mentale de nos mouvements et des
événements vécus dans l’ordre où ils sont apparus. Le flux du vécu y est reproduit. Nous en sommes en
quelque sorte les prisonniers. J’appelle cela la tyrannie du vécu. Une deuxième stratégie cognitive pour
se rappeler un trajet a été désignée par les psychologues qui l’ont étudiée stratégie de survol. Elle
consiste à évoquer une carte de l’environnement vue de dessus et à suivre un trajet sur cette carte
mentale. Cette stratégie de survol, qui consiste à visualiser une carte ou à en faire une description
propositionnelle, est utilisée en particulier lorsque nous cherchons à nous souvenir de grandes distances.
Elle a été étudiée par l’imagerie cérébrale. Cette stratégie est allocentrique. Dans le cas de la présence
d’autres personnes dans la scène à mémoriser, elle peut impliquer l’usage de la troisième personne,
c’est-à-dire la prise en compte du point de vue d’agents dans le monde. Une troisième stratégie a été
décrite par Thorndyke et Hayes-Roth. Lorsque, par exemple, nous essayons de nous rappeler où est le
bureau d’un de nos collègues dans un bâtiment, notre cerveau construit une représentation interne d’une
sorte de maquette du bâtiment. De nombreux auteurs ont élaboré des classifications de ces stratégies
mentales. Par exemple, Touretzky et Redish ont proposé de diviser les stratégies de navigation en quatre
sortes : les deux précédentes (route et carte), plus deux autres qu’ils appellent la navigation par taxons (il
s’agit de l’approche directe d’un but ou de l’évitement d’un obstacle, c’est la plus primitive des
navigations), et la navigation praxique qui serait une navigation purement endogène par séquence de
mouvements programmés internes (la trajectoire d’une ballerine sur la scène pourrait être un exemple de
cette navigation).
Page 273 : « La capacité d’avoir une vision d’ensemble, d’une situation ou d’un problème est associée à
la remarquable capacité d’envisager le monde de façons diverses, de changer non seulement de point de
vue mais aussi d’interprétation du réel, de lui attribuer des valeurs, de tolérer la différence, de décider.
Ce jeu subtil entre le perçu et le vécu, or pour échapper à la tyrannie du fanatisme, il faut être capable
d’être différent, c’est-à-dire de changer notre point de vue. »
Page 274 : « Or, le regard pénètre l’autre, il le pénètre en se fondant, en se transformant. Nous savons,
grâce à l’imagerie cérébrale, que le contact du regard active d’amygdale et tout le système des émotions.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%