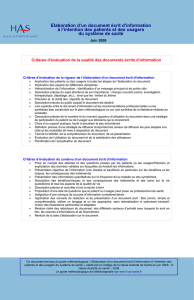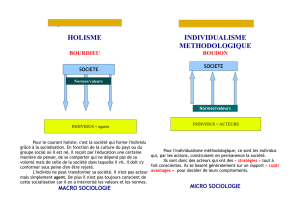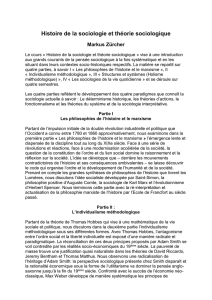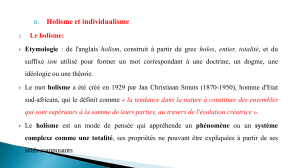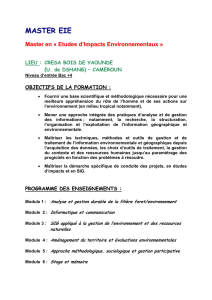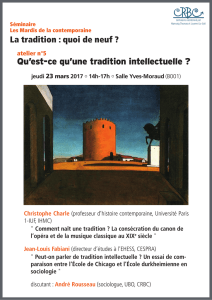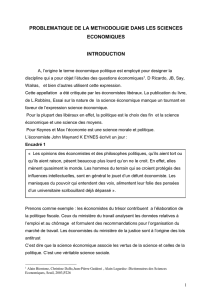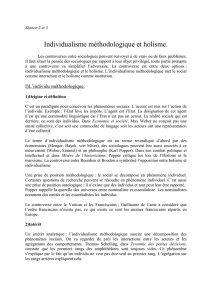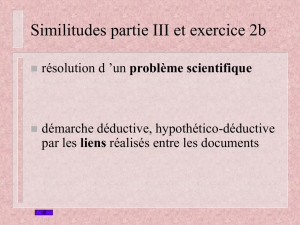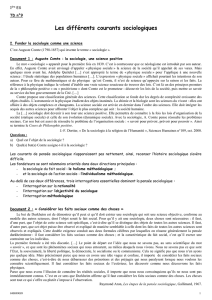Thème : la division du travail, à partir des analyses de Smith et Marx

Thème : Les grands paradigmes en sciences sociales
Document 1
Au premier contact avec l'analyse économique, on est sans cesse tenté d'objecter que, dans le
monde réel, les choses ne se passent pas toujours comme dans la théorie. Mais ce reproche est
souvent déplacé. En effet, par définition, aucune théorie n’est réaliste. L’analyse théorique ne
cherche pas à simplement décrire la réalité, ce n'est pas un reportage!
Toute théorie procède par abstraction. Il s'agit en effet de disposer d'un modèle
suffisamment simple pour être maniable. Or, la simplicité n'est pas de ce monde; la réalité est
complexe, et c'est précisément cette complexité qui rend nécessaire l'abstraction théorique pour
construire une interprétation intelligible du monde. Cela dit, il ne suffit pas d'un raisonnement
abstrait parfaitement logique pour constituer une théorie scientifique ; celui-ci doit en outre être
confronté aux faits. Mais ce sont les conclusions de la théorie qui sont soumises à l'épreuve des
faits et non ses hypothèses de départ. Par exemple, on construit la théorie de la production à partir
d'une hypothèse très simple : les dirigeants des entreprises cherchent à maximiser leur profit. [...]
Cette hypothèse n'est pas toujours réaliste ; il existe chez les dirigeants bien d'autres motivations
que le profit. Mais le problème de l'économiste n’est pas de savoir ce qui se passe dans la tête des
dirigeants ; il cherche seulement à construire un modèle du comportement des entreprises qui lui
permette d'expliquer correctement leurs décisions. Si ce modèle permet d'expliquer correctement la
façon dont la production réagira à une modification du SMIC, de la TVA ou des taux d'intérêt, il
sera retenu, quel que soit le degré de réalisme ou d'irréalisme de ces hypothèses. La performance
scientifique d'une théorie ne se mesure pas au réalisme de ses hypothèses de départ mais à celui de
ses conclusions. Jacques Généreux, Introduction à l'économie, Le Seuil, 1992.
Question 1 : Pourquoi une théorie doit-elle procéder par simplification ? [5 points]
Question 2 : Expliquez la phrase soulignée. [5 points]
Question 3 : Selon l’auteur, est-ce les hypothèses ou les conclusions des théories économiques et
sociologiques qui doivent être « réalistes » ? Justifiez cette réponse. [5 points]
Document 2
I1 existe dans les sciences sociales deux grandes options méthodologiques : l'individualisme
méthodologique d'une part, et le holisme méthodologique d'autre part. La première de ces options
prescrit d'expliquer les phénomènes sociaux par les actions individuelles dont ils sont composés. La
seconde considère au contraire que les phénomènes sociaux forment des touts qui ne sont pas
réductibles à des actes individuels (ce sont les phénomènes sociaux qui expliquent les actes
individuels, et non l'inverse). Le terme « holisme » a été forgé à partir du mot grec holos qui
signifie « entier ».
Chacune de ces deux grandes options méthodologiques peut se réclamer de l'une des deux
traditions majeures de la sociologie, la tradition allemande et la tradition française. La tradition
allemande, principalement représentée par Max Weber et Georg Simmel, a opté pour
l'individualisme méthodologique. La tradition française, principalement représentée par Auguste
Comte et Émile Durkheim, a opté pour le holisme méthodologique. [...] Les théories de l'interaction
sociale emploient l'individualisme méthodologique et sont issues de la tradition allemande ; le
structuralisme et le fonctionnalisme sont fondés sur un holisme méthodologique et sont issus de la
tradition française (le culturalisme relève lui aussi du holisme méthodologique).
Bernard Valade, Introduction aux sciences sociales, PUF, 1996.
Question : À l'aide de vos connaissances et du document 2, vous présenterez les grands clivages
au sein des théories sociologiques. [5 points]
1
/
1
100%