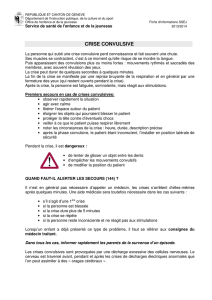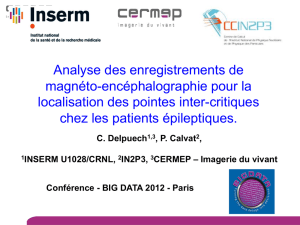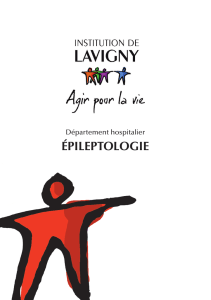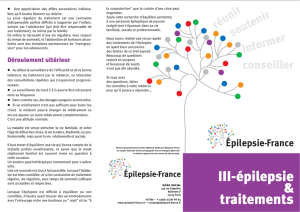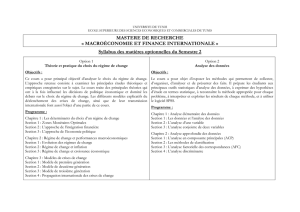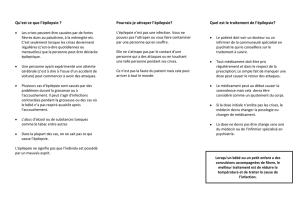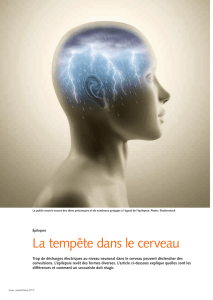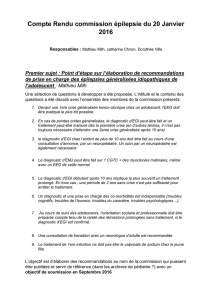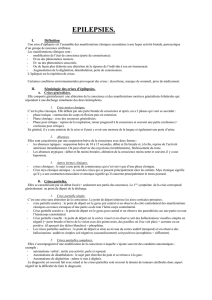Les traitements de l`épilepsie de l`adolescence

CONVULSIONS ou CRISES d'EPILEPSIE CHEZ L'ENFANT
Pr Patrick Berquin
Définition :
Une crise d'épilepsie correspond à l'expression clinique d'une décharge hypersynchrone de potentiels
d'actions d'une population neuronale.
Les termes "crise d'épilepsie", "crise comitiale" et convulsions" sont des synonymes même si le terme
convulsions fait plutôt référence aux crises d'épilepsie à expression motrice.
Sémiologie :
Selon que la décharge épileptique va intéresser l'ensemble du cortex ou une population de neurones
limités à une région particulière de celui-ci on parlera de "crise d'épilepsie généralisée" ou de "crise
d'épilepsie partielle" (ou focale ou localisée)
I - la sémiologie des crises généralisées :
- Les crises généralisées peuvent être motrices, on décrit :
- des crises cloniques généralisées : secousses rythmiques des membres et du tronc
- des crises toniques : accès hypertoniques le plus souvent en extension
- des crises tonico-cloniques : c'est le type de la crise dite "grand-mal" débutant par une
perte de connaissance brève suivie d'une phase tonique puis d'une phase clonique et enfin d'une phase
stertoreuse. Cette dernière correspond à une reprise bruyante de la respiration à travers une filière oro-
pharyngée et souvent encombrée de salive.
Chez le nourrisson et le jeune enfant les crises sont plus souvent soit tonique soit
clonique. Plus l'enfant grandit et en particulier chez l'adolescent ou l'adulte les crises seront plutôt tonico-
cloniques. - des crises myocloniques caractérisées par des sursauts intéressant soit la racine des
membres soit l'extrémité de ceux-ci, pouvant être isolées ou survenant en série
- des crises atoniques dans lesquelles il y a une brusque résolution du tonus entraînant une
chute.
- Des spasmes : brusques contractions en flexion (le plus fréquent) ou en extension.
- A côté de ces crises à expression motrice il existe des crises généralisées se caractérisant uniquement par
une rupture du contact que l'on appelle des absences. Le plus souvent chez l'enfant il peut s'agir d'absences
typiques de durée brève (moins de 1mn) sans mouvements anormaux associés à l'exception fréquemment
de clonies des paupières.
Il existe des absences dites atypiques soit parce que leur durée est plus prolongée (+ de
1mn) soit parce que la rupture du contact est partielle. Il s'y associe alors des automatismes moteurs soit
parce qu'il y a des mouvements anormaux associés clonies, hypertonies, atonies.
II - la sémiologie des crises partielles ou focales :
On divise les crises partielles ou focales en 3 groupes :
a) les crises partielles simples dans lesquelles il y a préservation de la conscience. L'enfant est
donc capable de se remémorer, de décrire la crise qu'il a présentée.
- Il peut s'agir de crises partielles motrices (cloniques, myocloniques, toniques ou
atoniques) qui n'intéresseront qu'une partie du corps (un hémicorps ou un membre
supérieur)
- les crises sensitives (à type de paresthésie localisées à une partie du corps), sensorielles
(crises visuelles, auditives, …)

- les crises végétatives, plus rares, en particulier chez le nouveau né ou le nourrisson
(pâleur, variation du rythme cardiaque ou de la respiration)
- les crises à expression psychique (tr. du comportement ou accès de frayeur)
b) les crises partielles dites complexes dans lesquelles il y a perte de connaissance ou trouble
de la conscience
c) les crises partielles secondairement généralisées c'est-à-dire qu'après un début focal la
crise va se généraliser et se terminer par ex. sous la forme d'une crise tonico-clonique
généralisée.
Quelle que soit l'étiologie des crises d'épilepsie ces différentes formes cliniques des crises peuvent être
observées.
Les particularité chez les nourrissons et l'enfant sont :
- la fréquence des crises à type d'absences typiques ou atypiques
- la fréquence des troubles neurovégétatifs chez le nourrisson
- le caractère souvent fruste des crises partielles qui peuvent se limiter à une déviation de la tête et des
yeux ou à quelques secousses myocloniques.
Etiologie des convulsions chez l'enfant
On peut séparer en 3 grandes catégories les causes des convulsions chez l'enfant :
- les convulsions dites occasionnelles
- les convulsions fébriles
- les épilepsies.
A - les convulsions dites occasionnelles chez l'enfant
On appelle convulsions occasionnelles des crises convulsives ou crises d'épilepsie qui
vont survenir de façon aiguë au cours d'une pathologie qui en est directement la cause. Les crises ne
récidivent pas dès lors que la cause initiale est corrigée.
Les principales causes de convulsions occasionnelles chez le nourrisson et l'enfant sont :
1) les infections du système nerveux (méningite, encéphalite, abcès)
2) les perturbations ioniques ou hydroélectrolytiques (hypo ou hypernatrémie que ce soit au cours
d'une deshydratation ou le plus souvent au cours de syndrome diarrhéique, ou au cours d'une
hyperhydratation ou intoxication par l'eau, qu'elle soit iatrogène ou secondaire à un diabète
insipide), les hypocalcémies fréquentes chez le nouveau-né
3) l'hypoglycémie en particulier chez le nouveau-né de mère diabétique, chez l'ancien prématuré mais
également chez l'enfant diabétique insulino-dépendant.
4) les traumatismes crâniens. La crise peut survenir soit très précocement dans les 2mn suivant le
traumatisme. Il s'agit le plus souvent alors d'une crise réflexe. Elle peut survenir dans les 48h
suivant le traumatisme à l'occasion d'une commotion cérébrale ou contusion cérébrale voire une
hémorragie intra-crânienne.
5) les causes les plus rares : toxiques (par intoxication accidentelle ou volontaire), les accidents
vasculaires cérébraux soit ischémiques ou hémorragiques.
B - les convulsions fébriles
Par définition, on appelle "convulsions fébriles" les crises convulsives survenant chez
l'enfant de moins de 5 ans provoquées par la fièvre. C'est une pathologie fréquente qui touche 2 à 5% des
nourrissons. Les antécédents familiaux sont fréquents (environ 30%). L'hyperthermie peut provoquer une
crise convulsive chez le nourrisson en raison de l'immaturité cérébrale et d'un seuil épileptogène plus bas.

On distingue 2 groupes parmi les convulsions fébriles
a) les convulsions fébriles dites simples
Il s'agit de crises convulsives survenant chez le nourrisson entre 1 et 5 ans, de type
généralisé, de durée brève (moins de 15mn), sans déficit post-critique (l'examen neurologique après la
crise doit être strictement normal). Enfin, ces crises surviennent chez le nourrisson dont l'examen
neurologique et le développement psychomoteur ont toujours été normaux et qui n'ont pas de pathologie
neurologique connue.
Ces crises convulsives fébriles simples sont les plus fréquentes. Elles représentent 80% des crises
convulsives fébriles. Elles sont bénignes. Il n'y a pas d'indication à réaliser d'examens complémentaires.
L'hospitalisation n'est pas obligatoire (dès lors qu’une méningite, une encéphalite ou un syndrome
infectieux grave a été écarté). Le traitement préventif repose sur le traitement de la fièvre. Il n'y a lieu
d'envisager un traitement préventif par un anti-convulsivant au long cours que si les crises sont répétées.
C'est dans ce groupe que l'on retrouve la plus grande fréquence d'antécédents familiaux.
b) les convulsions convulsives fébriles dites compliquées ou complexes.
Elle ne représente que 20% des convulsions fébriles. Le risque est élevé d'état de mal
convulsif, de séquelles neurologiques ou d'évolution vers une épilepsie ultérieure.
Elles s'opposent point par point aux crises convulsives fébriles simples. Il peut s'agir de :
- crises convulsives partielles,
- prolongées (+ de 15mn)
- avec un déficit post-critique transitoire ou définitif.
- crises convulsives fébriles survenant chez des nourrissons ayant déjà une pathologie
neurologique et un retard psychomoteur ou un examen neurologique anormal.
- On y inclus également les crises convulsives fébriles survenant chez les nourrissons de
moins de 1 an qui présentent les mêmes risques.
Un seul des éléments cliniques sus-jacents est suffisant pour parler de crises convulsives
complexes. Le risque est d'autant plus élevé que les différents facteurs de risques sont associés.
Seules ces crises convulsives fébriles compliquées justifient la réalisation d'examens
complémentaires (EEG avant l'instauration du traitement et examen neuroradiologique : scanner cérébral
ou IRM encéphalique). Dans ce groupe de crises convulsives fébriles compliquées on proposera un
traitement préventif afin d'éviter l'apparition d'un état de mal convulsif ou de crises prolongées avec
séquelles neurologiques. Le traitement préventif repose sur le Valproate de Sodium ou DEPAKINE à la
posologie de 30mg/kg/J poursuivi jusqu'à l'âge de 5 ans.
Quelle que soit le type de crises convulsives (simples ou complexes) le traitement des crises si elles
ont une durée de plus de 3mn repose sur l'injection de Diazépam ou Valium IR à la posologie de
0,5mg/kg qui peut être réalisé par les parents qu'il faudra former.

C - les épilepsie de l'enfant et de l'adolescent
L'épilepsie est une maladie chronique se caractérisant par la répétition de crises de façon
spontanée. On devrait parler plutôt "des épilepsies" que de "l'épilepsie" dans la mesure où existent de
nombreux syndromes épileptiques en particulier chez l'enfant et l'adolescent.
En effet, en raison de la maturation cérébrale à chaque tranche d'âge correspondent un certain nombre de
syndromes épileptiques.
On estime qu'environ 80% des épilepsies de l'adulte débutent dans l'enfance ou pendant l'adolescence.
L'incidence de l'épilepsie chez l'enfant est de l'ordre de 40 à 60°/°° avec une prévalence de 4 à 12 °/°° , la
fréquence étant d'autant plus importante que l'enfant est plus jeune.
Les différents types de syndrome épileptique seront définis par ce qu'on appelle des syndromes
électrocliniques c'est-à-dire tenant compte à la fois de la sémiologie clinique des crises et des aspects
électro-encéphalographiques qu'ils soient intercritiques (entre les crises) ou critiques (enregistrement
électro-encéphalographique au cours d'une crise).
On peut distinguer les épilepsies de l'enfant et de l'adolescent selon leur caractère généralisé ou partiel, on
parlera donc d'épilepsie généralisée ou d'épilepsie partielle.
On distingue également les syndromes épileptiques en fonction de leur étiologique connue ou supposée en
3 groupes :
a) les épilepsies dites "idiopathiques".
Il s'agit de syndromes épileptiques "Age-dépendant" c'est-à-dire que le syndrome
épileptique correspond à une tranche d'âge ou un stade de maturation cérébrale terminée. Ils ont en
général un caractère familial. Ce sont des syndromes épileptiques survenant chez les enfants et
adolescents dont l'examen neurologique et le développement psychomoteur étaient normaux. Les examens
neuroradiologiques sont normaux.
Ce sont des syndromes épileptiques dont l'étiologie est supposée génétique. Plusieurs gènes candidats ont
déjà été découverts pour certains syndromes. Ils correspondent uniquement à une hyper-excitabilité
neuronale sans qu'il y ait de lésions cérébrales. Ce sont habituellement des épilepsies dites "bénignes"
dans le sens où elles n'ont pas ou peu de répercussions sur le développement psychomoteur, elles sont le
plus souvent facilement contrôlées par un médicament anti-épileptique. Enfin, un certain nombre de ces
syndromes épileptiques vont guérir (plus des 2/3), les autres le plus souvent vont s'améliorer avec l'âge et
seront facilement contrôlées.
b) les épilepsies dites "symptomatiques"
Ce sont des épilepsies secondaires à une lésion cérébrale (on les appelait autrefois les
épilepsies lésionnelles). La lésion cérébrale peut être connue et antérieure à une épilepsie ou découverte à
l'occasion du diagnostic étiologique de celle-ci. Toute lésion cérébrale intéressant le cortex peut être à
l'origine d'une épilepsie. Cette lésion est soit congénitale ou acquise.
Il s'agit souvent d'épilepsie plus sévère, rebelle, réfractaire au traitement nécessitant souvent des
changements thérapeutiques ou une polythérapie. Elles ont beaucoup plus fréquemment des répercussions
sur le développement psychomoteur et sont souvent associées à un handicap du fait de la gravité de
l'épilepsie, handicap également du fait de la lésion cérébrale causale.
c) les épilepsies cryptogéniques (ou basocryptogénétiques)
Ce sont des épilepsies dont l'étiologie lésionnelle est supposée mais pour lesquelles les
différents examens neuroradiologiques et en particulier l'IRM encéphalique sont normaux et ne permettent
pas de mettre en évidence cette lésion.
Elles partagent les mêmes caractéristiques que les épilepsies symptomatiques dans la mesure où ce sont
également souvent des épilepsies réfractaires avec répercussion sur le développement psychomoteur ou
les fonctions cognitives chez l'enfant.

L'évolution des techniques d'imagerie fait que le groupe des épilepsies cryptogéniques diminue. Il faut
donc savoir répéter les examens neuroradiologiques chez les enfants présentant une épilepsie
cryptogénique.
Sur le plan pratique, en ce qui concerne la prise en charge, le pronostic et le traitement des enfants et
adolescents épileptiques on distingue donc 2 groupes :
a) le groupe des épilepsies idiopathiques, le plus fréquent dont le pronostic et
l'évolution sont relativement "bénins"
b) le groupe des épilepsies symptomatiques et cryptogéniques dont le pronostic et
l'évolution sont similaires. La seule différence est l'identification ou non de la
lésion causale.
Nous étudierons par la suite les différents syndromes épileptiques en fonction des tranches d'âge.
I - LES CONVULSIONS NEONATALES
Les convulsions néonatales sont très fréquentes. Il s'agit le plus souvent de convulsions
occasionnelles secondaires à une anoxo-ischémie, une hémorragie intracrânienne ou une infection du
système nerveux central.
Les syndromes épileptiques débutant en période néonatale sont rares.
a) Il existe des syndromes épileptiques idiopathiques dans cette tranche d'âge :
les convulsions néonatales bénignes ou les convulsions néonatales familiales bénignes sont 2 syndromes
épileptiques idiopathiques caractérisés par des crises convulsives fréquentes survenant dans les premiers
jours de vie mais il s'agit de syndromes épileptiques transitoires qui guérissent constamment et de façon
spontanée en quelques jours en ce qui concerne les convulsions néonatales bénignes, au bout de 1 mois - 1
mois 1/2 en ce qui concerne les convulsions néonatales familiales bénignes.
b) Les syndromes épileptiques symptomatiques ou cryptogéniques de la période néonatale sont très rares
mais d'un pronostic effroyable dans la mesure où il s'agit d'épilepsie réfractaire avec des crises fréquentes
pluriquotidiennes associées à une encéphalopathie sévère conduisant le plus souvent vers le décès ou une
encéphalopathie gravissime : on parle alors d'encéphalopathie épileptique néonatale dont deux formes ont
été identifiées : le syndrome de Otohara et l'épilepsie myoclonique précoce
II - LES EPILEPSIES DU NOURRISSON DE MOINS DE 2 ANS.
A - les épilepsies idiopathiques
Il s'agit de syndromes épileptiques rares d'évolution transitoire et bénigne. Deux formes
essentiellement ont été identifiées :
- l'épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson qui se caractérise par des myoclonies (sursauts brefs et
répétés) intéressant essentiellement les épaules et les membres supérieurs. L'EEG met en évidence des
grapho-éléments épileptiques généralisés. Les nourrissons ont par ailleurs un développement
psychomoteur et un examen neurologique tout à fait normaux. Il s'agit d'une épilepsie qui répond bien à
un traitement par Valproate de Sodium (Dépakine°) et qui va guérir de façon quasi-constante au bout de 1
à 3 ans d'évolution.
- les convulsions infantiles familiales bénignes. Il s'agit d'un syndrome autosomique dominant qui se
caractérise par des crises convulsives survenant le plus souvent dans la première année de vie et en
général autour du 5ème mois. Les crises sont le plus souvent partielles, parfois secondairement
généralisées. Il s'agit de crises convulsives qui vont survenir en série pendant quelques jour à 1 mois
répondant bien à tous les traitements anti-épileptiques sans évoluer constamment vers la guérison, sans
récidive. Le traitement est donné habituellement pour une période de 1an à 18 mois par Valproate de
Sodium ou Carbamazépine (Tégrétol°)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%