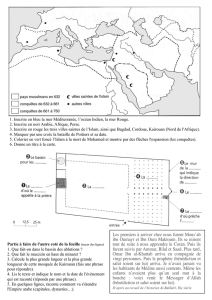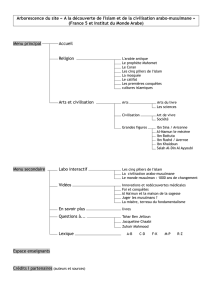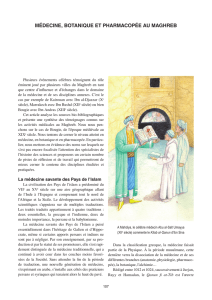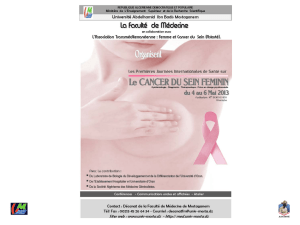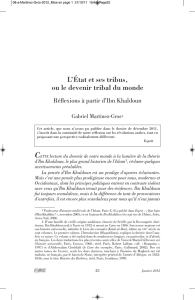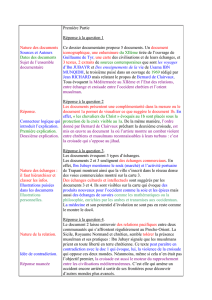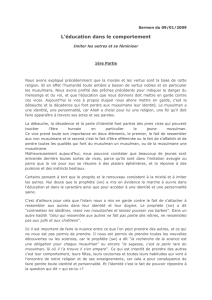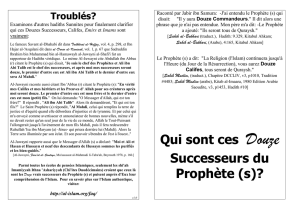La croisée des chemins

La croisée des chemins
1
La croisée des chemins
« Nos ennemis d'aujourd'hui sont la caricature et le préjugé : l'absence d'informations faisait hier de nous
de simples ignorants de certaines cultures, de certaines réalités ou de certains événements ;
l'information caricaturale, superficielle, voire la désinformation, nous donnent aujourd'hui l'illusion de la
connaissance. Or, l'illusion d'aujourd'hui est bien plus dangereuse que l'ignorance d'hier : elle est mère
de la suffisance, des jugements définitifs et des dictatures intellectuelles. Le mouvement va dans les
deux sens : avoir le souci d'éviter les simplifications, d'une part, et offrir à l'autre un accès à la complexité
de son être et de ses références, d'autre part. Tel nous paraît être le défi du dialogue dans une société
culturellement plurielle. ». Ce vaste chantier, mis en exergue par le philosophe helvète Tariq Ramadan,
demeure, entre les théories du Clash (1) et l'extrême droite assassine (2), plus que jamais nécessaire.
C'est pourquoi je propose de faire, d'entrée, un pas en avant vers le passé. Il s'agira d'élaborer une sorte
d'aller vers l'amont, pour transmettre, depuis le foyer des ancêtres, non pas les cendres mais la flamme
(3).
Mes cheveux dansent au gré des chorégraphies infinies que la brise leur impose. Les yeux fermés, je
me meus en girouette, concentrant ainsi la mémoire tantôt dans une direction, tantôt dans une autre.
J'ouis avec douceur les hagiographies que me conte l'hôte impalpable. Elles sont chantées en araméen,
en hébreu, en syriaque, en arabe, en latin,… certaines datent même d'avant le roseau et le parchemin.
Je suis haut perché sur le Mont Nébo et je scrute l'horizon. Une émotion envoûtante m'enlace dans le
silence. Tellement d'hommes ont dû traverser ces régions, par delà le Jourdain, le Nil, l'Amou Daria, le
Tigre, le Guadalquivir… Là-bas, Jérusalem, Bethléem, plus loin encore, Nishapur, Cordoue, Palerme,
Istanbul ou Boukhara,… Après l'horizon, se dresse la Cité des souvenirs, celle qui renferme le grimoire
des Hakims (4) faiseurs de sagesses, explorateurs de la Science, chercheurs de toujours plus de sens…
d'Amour (5), de transcendance. On se souvient, dès lors, que les points cardinaux orientèrent les cœurs
vers ces humains, ceux qui naquirent un jour dans le Temps qui suivait sagement son envol. Ils en
redéfinirent le cours et façonnèrent l'Histoire. C'est au cœur d'une géographie spirituelle que je me sens
alors transporté. D'ici, le Passé me fraie un passage pour l'Avenir. Un couloir vers soi et une ouverture
vers les autres. Qui sont donc ces êtres humains qui au fond m'animent ? Qui sont ceux qui m'abreuvent
de soif de Connaissance, de Justice, de Paix et de Lumière ? L'élan de tout pèlerin s'appuie d'abord sur
une méditation et celle qui symbolise notre voyage est celle-ci : « l'autre Homme, c'est celui qui lui
manque pour être pleinement un Homme » (6).
Tout commence sur une planète vierge, foulée soudainement sur un de ses pans par deux êtres
descendus de trop loin. La ligne de la Remémoration nous plonge vers nos pères, car, bien que
différents, nous restons des pairs. C'est donc par la Genèse que le Cairn se laissa griffonner en premier
(7). L'Islam n'est pas une religion nouvelle née avec le solitaire de Hira(8). Le Coran, source scripturaire
principale du musulman, renferme la vie de tant d'illuminés par l'Eternel, pour l'éternité. La psalmodie, au
fond de la nuit, éveille la carcasse consonantique des versets, laissant étinceler le rubis de la noblesse
donné à Adam et Eve, le couple originel repentant. A Abraham, accueillant l'amour de l'Unique sur l'autel
du sacrifice. A Joseph, éprouvé par sa beauté. A l'humble Salomon, grand roi des éléments. A Moïse,
fils de 'Imran et libérateur des persécutés. A Jésus et Marie, deux signes pour la postérité. A Loth,
l'exilé… Des milliers d'entre eux ont été annoncés, quelques noms seulement nous furent révélés mais
tous nous font méditer. Le simoun m'emporte vers la Péninsule Arabique. C'est dans ces contrées
marchandes du septième siècle que Mohamed, sur lui la Paix, fit souffler une révolution de pacification
des cœurs dans le cœur des sables. Libérateur de la plus vieille demeure sacrée, le bien-aimé demeure,
quinze siècles plus tard, la référence et le modèle de plus d'un milliard et demi de croyants. « Nous ne
t'avons envoyé que comme miséricorde pour les Mondes » nous dit le Coran. Le projet prophétique du
sceau des Messagers résida dans le Rappel de l'Unique et dans l'instauration de la Justice pour tous. Il
bouleversa alors l'ordre établi par les oligarchies esclavagistes marchandes bercées par l'idolâtrie.
Bientôt, ce furent les civilisations voisines, mourantes et agonisantes, qui s'éteignirent face à l'arrivée de
ce grand chambardement culturel, social, politique…civilisationnel. Ayant vécu l'exil, Mohamed, sur lui la
Paix, adressa en terre d'accueil, ces quelques mots pour premier discours : « Ô vous les Hommes,
répandez la paix ». Tel est le message qui transcendait toute distinction idéologique, religieuse,
raciale… Une tradition prophétique souligne que : « Les savants sont les héritiers des prophètes ».
C'est par le biais de cette conscience que des érudits se relayèrent le premier impératif
coranique : « Lis ». Des hommes pour qui Foi et Raison s'interpénétrais.

La croisée des chemins
2
Dans leurs encriers, les sciences multiples étaient reliées à l'Un : c'était une ode de l'unité dans la
multiplicité. Ces Hommes, par une myriade d'attributs, ne cessent d'animer les musulmans tant en
Belgique que partout dans le monde : Abu Bakr, compagnon d'exil du Prophète, déclarait : « Jamais mon
regard ne se posa sur une chose sans que la conscience que j'ai de Dieu ne l'ait précédée ». Omar,
embrassant l'Islam à vingt-sept ans, s'adressait à la masse en ces termes : « Dieu fasse bénédiction
envers tout être qui me fait don de mes péchés ». Othman, exilé en Abbyssinie, symbolisait à lui seul le
creuset de la générosité et Ali, le David des compagnons, demeurait une porte d'accès à un savoir sans
fin. Tels s'illustrent les quatre Califes à l'aurore de l'Islam. Huit ans après la fondation de Kaïrouan, c'est
la mère des Croyants, Aïcha, l'une des sources intarissables des traditions du Prophète, qui s'éteignit.
Une centaine de milliers de compagnons gravitèrent ainsi autour du Prophète ; s'y attarder nous
aspirerait dans la spirale insatiable des êtres vrais, animés par le Divin. Les compagnons furent des
Hommes de foi et de terrain. Ils demeurent les Géants d'une génération ou plutôt une génération de
Géants ! Puis vint la vague des compilateurs du Savoir, ceux qui dessinèrent, par le biais d'écoles
juridiques, les sentiers conduisant au puit prophétique. Citons, entre autres, le descendant du
messager : Ja'far As Sadiq et le grand théologien Abu Hanifa (696-767) né en même temps que le dinar
ommeyyade mais brillant plus longtemps que ce dernier. Ensuite, un an après l'arrivée des musulmans
en Al andalus, c'est l'Imam Malik (712-791) qui vit le jour. Un peu plus loin, c'est la plume d'Al Ashr'ari
(873-935), d'Al Bukhari (810-870) et de Muslim qui relayèrent l'héritage des illuminés. Cette génération
reflète une mémoire vivante, parcourant un processus liant la Révélation au contexte toujours nouveau,
afin de rester fidèle au sens même des références. En effet, « …c'est en allant vers la mer qu'un fleuve
est fidèle à sa source » (7).
Sous les califes Abbassides, ont vit la science atteindre l'extrême pointe de sa perfection avec,
notamment, le joyau de Bagdad : La Maison de la Sagesse (832). Tout autour, les arts s'y multiplièrent
et les sciences s'y perfectionnèrent. La pléiade des manuscrits alla en grossissant. La poésie fut à
l'honneur avec Abu Nuwas (747-810), la grammaire avec Sibawayh (755-791) et puis la musique de
Zyriab (776-852) passa des horizons de palmiers d'Orient vers les Sierras andalouses. La philosophie
trouva sa voie avec Al Kindi (800-870) et Al Farabi (870-950). Tandis que la ville de Marrakech se
construisait, un enfant âgé de douze ans illuminait déjà la Transoxiane. Il s'agissait du génie Abu Hamid
Al Ghazali (1058-1111). Il devint vite l'un des plus éminent savant de tous les temps, mais il fuit la
célébrité que lui coûta son érudition à la chaire de la Nidhamiyya pour s'abandonner, loin du luxe et du
confort, à une vie d'errance et de libération du cœur de tout ce qui n'était pas Dieu. Le grand mystique
rédigea les fruits de sa quête, une vision coulée dans un ouvrage mille et une fois réédité
appelé : « Revivification des Sciences religieuses ».
La contemplation de Dieu, vécue dans la plénitude et dans l'action, se résume sans doute dans la
dimension de l'intériorité de la sainte Rabya al Âdawiya (huitième siècle). Elle déclamait vers les cieux
ces quelques vers, à Dieu : « Je T 'aime de deux amours : amour vivant mon propre bonheur et amour
digne de Toi. Quant à cet amour de mon bonheur, c'est que je m 'occupe à ne penser qu'à Toi, et à nul
autre. Et quant à cet amour digne de Toi, c'est que Tes voiles tombent et que je Te vois. Nulle gloire
pour moi, ni en l'un, ni en l'autre, mais gloire à Toi, pour celui-ci et pour celui-là. ». Ibn Firnas, l'homme
volant, nous fit traverser les mers jusqu'en Andalousie. Une terre, où la méditation sérieuse des
Cantiques d'Alphonse X :« Laisser vivre les Maures parmi les Chrétiens en conservant leur foi, Et en
n'insultant pas la nôtre. VII, XXV, 1 » nous aurait sans doute permis de palper une Europe
d'Universalité. L'émirat de Cordoue propulsa la science et la culture faisant d'Al andalus la jugulaire des
Sciences et des sagesses de l'humanité. L'écriteau qui accueillait les étudiants pénétrant les portiques
de ces Mosquées-universités annonçait que : « L'équilibre du Monde repose sur quatre piliers : la
Science des sages, la Justice des dirigeants, la Prière des pieux, la Valeur des braves ». Tellement de
noms, tellement de recherches… Ibn 'Abd Rabbih rédigea au Xème siècle la somme des connaissances
utiles « le Collier unique ». Théologien, philosophe, historien, juriste et littérateur, l'auteur du « Collier de
la colombe », Ibn Hazm (994-1064), reflète bien l'Esprit encyclopédique du monde musulman médiéval.
Il est incontestablement l'homme du onzième siècle. Sous les Almoravides, rayonnèrent les écrits
poétiques d'Ibn Badja et d'Ibn Kafadja. Ce dernier griffonnait : « Ô peuple d'al-andalus, quel bonheur est
le vôtre ! l'eau, l'ombre, fleuves et arbres vous appartiennent. Le Paradis éternel n'existe qu'en vos
demeures, et s'il me fallait choisir, avec celui-ci je resterais. » Sous les Almohades, le « Hayy Ibn
Yaqdhan » du grand Ibn Tufayl, les œuvres d'Ibn Rushd maître du malikisme et de la pensée
aristotélicienne, les indications thérapeutiques d'Abu Marwan Ibn Zuhr et les Relations de voyages telles
que celles d'Ibn Djubayr de Valence ont été les plus prégnants. Le treizième siècle reste marqué par des
manuscrits andalous rédigés à Damas : ceux du botaniste et herboriste Ibn Al Baytar et ceux du Plus
Grand Maître Ibn Al Arabi (1165-1240).

La croisée des chemins
3
Né deux ans après l'ouverture du chantier de Notre Dame de Paris, le grand mystique écrivit un
message pour les siècles à venir : « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Il est pâturage
pour les gazelles et couvent pour le moine. Temple pour les idoles et Ka'aba pour le pèlerin. Il est les
tables de la Thora et le livre du Coran. » Le vent continue de souffler sur le Mont Nébo. Le soleil s'est
couché depuis et je perçois les lumières de Jérusalem, à trente-huit kilomètres d'ici. Il y faisait bon vivre
sous les étendards Ayyubides nouvellement entrés, juste derrière cet homme que les Croisés
nommaient Salladin. Il bouleversa l'image que l'Occident s'était faite jusqu'alors du musulman. Symbole
de la résistance et de la magnanimité, Salahaddin Al Ayyoubi compte, avec Khalid Ibn Al Walid et
Mohamed Al Fatih, parmi les plus fins stratèges de l'histoire de l'Islam. Puis, à l'heure de la chute des
dynasties et des pouvoirs, naquit Ibn Khaldun (1332-1406), le solitaire d'une époque, le père de la
sociologie, qui rédigea, comme une synthèse pour les ères de demain, sa célèbre Muqaddima. Une
double résistance : tantôt par le glaive contre l'ennemi et tantôt par la plume contre l'oubli.
Les siècles s'égrènent. Alors que le roi des Belges est proclamé souverain du Congo en 1884, s'ouvre la
marche des grands réformistes. Muhammad Abduh et Al Afghani créent à Paris le journal intitulé le lien
indissoluble. Mohammed Iqbal, le philosophe indo-pakistanais, publie en 1918 « Message de l'Orient » ;
il est le premier à être autorisé à prier dans la Mosquée de Cordoue, des siècles après sa défiguration.
Puis, le plus grand réformiste du vingtième siècle, Sidi Hassan Al Banna, crée, en 1928, le mouvement
des Frères musulmans. En 1931, Cheikh Ibn Badis et Cheikh Ibrahimi s'unissent autour de l'association
des Ulémas en Algérie. Sayyed Qutb, lui, sera partialement lynché en Egypte, deux ans avant mai 68.
Ces trajectoires témoignent toutes de l'affirmation continuée de l'être à Dieu au delà de tout colonialisme,
de toute dictature. Ces êtres ont, souvent au prix de leur vie, résisté, relevant les défis de tous les
instants pour réformer le rapport aux sources, le rapport au monde, à la lumière de la foi, dans la réalité
du moment. Au centre du Caire, la constellation d'Al Azhar proposa des savants milles an durant.
1 Je pense notamment à la théorie de S. Huntington et au mode d'emploi de A. Sharon.
2 Une pensée profonde pour le couple musulman, citoyen de Schaerbeek, arraché à la vie le 7 mai dernier par un
voisin islamophobe et raciste.
3 Selon l'expression de Jean Jaurès
4 Personnes dotées de sagesses. Terme arabe généralement employé pour spécifier les Hommes de sciences, les
Esprits encyclopédiques, les savants … .
5 « Mon serviteur s'approche sans cesse de Moi par ses œuvres, jusqu'à ce que Je l'aime. Et quand Je l'aime, Je
suis l'ouie par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il
marche. » Ibn 'Arabi - Mystique murcien de l'Andalousie médiévale .
6 Parole du philosophe musulman R. Garaudy, Comment l'homme devint humain, Editions J. A., Paris, 1979, p. 335.
7 « Pour saisir l'ampleur vraiment cosmique du Phénomène humain, il était nécessaire que nous en suivions les
racines, à travers la Vie, jusqu'aux premiers enveloppements de la Terre sur elle-même. »
8 Cavité rocheuse du Mont de la Lumière d'où le Prophète Mohamed, Paix sur Lui, reçut les premiers Versets de la
dernière des Révélations de l'histoire.

La croisée des chemins
4
1
/
4
100%