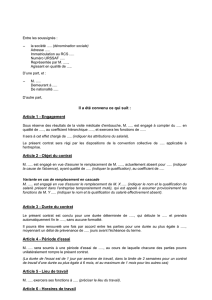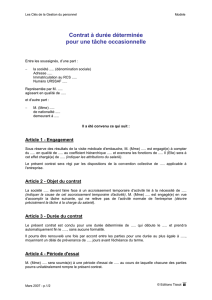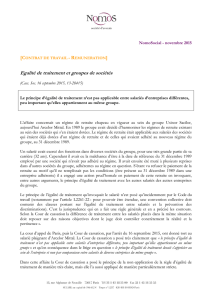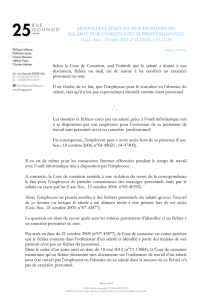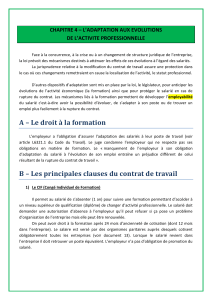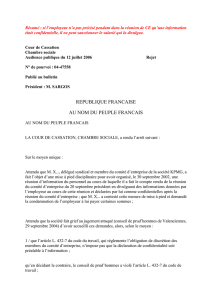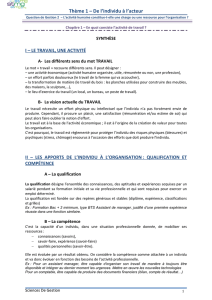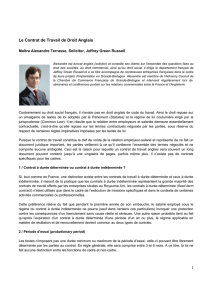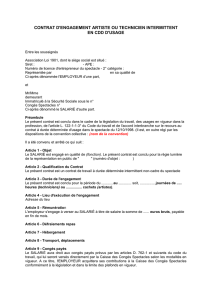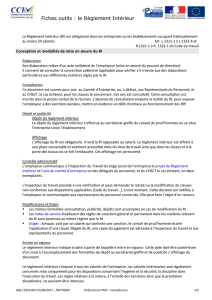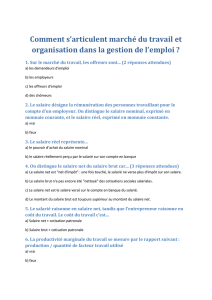Téléchargement Juridique février 2016 - unsa-pole

L’employeur ne peut accéder aux courriels de la
messagerie personnelle figurant sur l’ordinateur
professionnel
Une cour d’appel peut écarter des débats des messages électroniques figurant sur l’ordinateur
professionnel d’une salariée, mais provenant de sa messagerie personnelle distincte de la
messagerie professionnelle dont elle dispose pour les besoins de son activité. La production de ces
courriels par l’employeur porte en effet atteinte au secret des correspondances. C’est ce que
retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 26 janvier 2016.
La Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence concernant le statut juridique des
courriels que le salarié échange via sa messagerie personnelle à partir de son ordinateur
professionnel. Dans quelle mesure ces courriels sont-ils couverts par le secret de la
correspondance ? Les magistrats de la chambre sociale prennent position dans un arrêt publié au
bulletin de la Cour le 26 janvier 2016.
La responsable d’agence d’une société prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts
de l’employeur et saisit la juridiction prud’homale. Dans le cadre de ce contentieux, l’employeur
produit aux débats un échange de courriels reçu par la salariée sur sa boîte de messagerie
personnelle et figurant sur son ordinateur professionnel.
La cour d’appel écarte cette pièce au motif que, bien qu’elle provienne de l’ordinateur
professionnel mis à la disposition de la salariée, il s’agit "d’un échange de courriels reçu par
l’intéressée sur sa boîte de messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non
professionnelles" de telle sorte que "sa production porterait atteinte au secret des
correspondances".
La société conteste cette analyse et forme un pourvoi en cassation. Elle fait valoir que, selon la
jurisprudence, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa
disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les
identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Dès lors, la société soutient
que "des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié

par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils sont émis de ou vers la
messagerie électronique personnelle du salarié".
La Cour de cassation ne retient pas les arguments de l’employeur. La cour d’appel ayant constaté
que "les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée
distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité",
elle en a exactement déduit que "ces messages électroniques devaient être écartés des débats en
ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances". La chambre
sociale confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi de la société.
Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-15.360, publié
Alerter sur les pratiques illégales au travail n'est
pas incompatible avec l'intérêt de l'entreprise (M.
Sanchez, LVMH)
Alerter sur les pratiques illégales au travail n'est pas incompatible avec l’intérêt de l’entreprise, à
condition d’engager une réflexion collective sur le sujet. C’est en tout cas ce qu’estime le
responsable des affaires sociales du groupe LVMH, Christian Sanchez, lors d’une rencontre sur le
devoir de loyauté des salariés le 28 janvier 2016 organisée par l'Ugict-CGT. Face aux lanceurs
d’alerte Antoine Delcour, à l’origine du scandale d’évasion fiscale "Luxleaks", et Laura Pfeiffer,
inspectrice du travail condamnée dans l’affaire Tefal, le responsable du groupe industriel du luxe a
défendu une "réflexion collective" sur le sujet, pour remédier à la solitude des cadres confrontés
quotidiennement à des "dilemmes". Ce débat est intervenu le jour de l'adoption par la commission
des Affaires juridiques du Parlement européen du projet de directive sur le secret des affaires.
Alerter sur les pratiques frauduleuses est "parfaitement" compatible avec l’intérêt de l’entreprise,
à condition que la question soit abordée de façon "collective", assure Christian Sanchez,
responsable des affaires sociales chez LVMH, invité d’une table ronde organisée par l’Ugict-CGT le
28 janvier 2016.
"Un problème collectif"
"Je ne vois pas comment une entreprise pourrait se développer durablement sur de la
corruption,", a-t-il déclaré lors de ce débat consacré au devoir de loyauté des cadres, plaidant pour

développer un "débat au quotidien" sur la déontologie dans les services des entreprises." "Le
problème est collectif. Il faut s’en emparer à tous les niveaux [hiérarchiques], s’approprier la
responsabilité", ajoute-t-il.
Un "droit de refus et d'alternative" pour les cadres
Alors que l’accord Agirc-Arrco prévoit l’ouverture d’une négociation sur la notion d’encadrement
avant la fin 2016, l’Ugict a rappelé ses propositions pour renforcer le statut des cadres :
mettre en place d’un "droit de refus et d’alternative", dans lequel s’intégrerait un statut
pour les lanceurs d’alerte ;
définir le statut de l’encadrement de façon interprofessionnelle, assurer l’affiliation par un
organisme paritaire interprofessionnel, s’imposant aux branches ;
définir le périmètre du statut de l’encadrement à partir du contenu du travail, des
fonctions exercées par les salariés, et de leur niveau de qualification ;
un statut arrimant l’encadrement au salariat.
"Au quotidien, on peut être confronté à des devoirs d’alerte", explique-t-il, affirmant recevoir
"régulièrement" des "lettres de dénonciation". "Il y a des choses sérieuses et des choses moins
sérieuses", a-t-il poursuivi, distinguant les pratiques illégales des pratiques "moralement
condamnables" contenant "une part d’appréciation personnelle". Selon une enquête du cabinet de
conseil en prévention des risques Technologia, plus d’un tiers des salariés affirment avoir déjà
constaté des pratiques contraires au code du travail au sein de leur entreprise et 25 % disent avoir
été incités par un supérieur à enfreindre la loi.
Afin d’éviter de "faire des victimes individuelles", les lanceurs d’alerte qui finissent par être
complètement isolés au sein de l’entreprise, Christian Sanchez plaide pour la production de
"référentiels" écrits, pour que les personnes qui se sentent "en déphasage" avec les pratiques de
l’entreprise puissent avoir la certitude qu’elles ne sont pas "seules".
Une solution qu’il a tenté de concrétiser en impulsant une "charte des DRH", qui n’avait "rien de
révolutionnaire" mais qui n’a pas abouti, faute d’un "large assentiment" chez ses homologues. "Les
DRH sont confrontés en permanence à des injonctions paradoxales. Ce métier tend à faire des
compromis et éviter des points durs. Mais quand on fait trop de compromis on se compromet",
estime-t-il. Il a néanmoins rejeté l’idée de la charte d’entreprise, "rien de plus creux et langue de
bois".
Également présente lors de cette table ronde, la secrétaire générale adjointe de l’Ugict, Sophie
Binet, a plaidé quant à elle pour un "devoir de désobéissance" dans l’entreprise, sur le modèle de
ce qui existe dans l’armée. "La citoyenneté ne doit pas s’arrêter aux portes de l’entreprise",
considère-t-elle, alors que le même jour la commission des Affaires juridiques du Parlement
européen adoptait le projet de directive sur le secret des affaires, qui vise à protéger les
entreprises contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’informations ou savoir-faire qui "ont
une valeur commerciale en raison du fait qu’ils sont secrets".
Le texte adopté précise néanmoins que l’application de la directive ne peut pas être demandée
lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation présumée du secret d’affaires a été faite "par des
travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime de leur fonction de
représentation", ou lorsqu’il s’agit de la "révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une
activité illégale, à condition que le défendeur ait agi pour protéger l’intérêt public général". Des
précautions jugées insuffisantes pour certains syndicats et ONG, qui voient dans ce texte une
atteinte à la liberté d’expression, aux droits des représentants du personnel et à la protection des
lanceurs d’alerte

La durée de la formation syndicale ne peut être
imputée sur celle de congés payés conventionnels
La durée de la formation syndicale ne peut être imputée sur celle des congés payés, et elle doit
être assimilée à une durée du travail effectif pour la détermination de la durée de ces congés. Ce
principe s’applique aux congés payés trimestriels supplémentaires prévus par la convention
collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées. C’est ce que décide la Cour de cassation le 20 janvier 2016.
L’article L. 3142-12 du code du travail prévoit que la durée de la formation syndicale ne peut être
imputée sur celle des congés payés annuels et doit être assimilée à une durée de travail effectif
pour la détermination de la durée de ces congés. Cette règle vaut pour les congés payés
conventionnels, juge un conseil de prud’hommes, approuvé par la Cour de cassation dans un arrêt
du 20 janvier 2016.
Une salariée de l’association Œuvre des villages d’enfants saisit en référé le conseil de
prud’hommes pour obtenir le paiement de deux jours de formation syndicale qu’elle a pris sur ses
congés trimestriels conventionnels. Son employeur lui avait refusé la récupération de ces congés
au motif que ces journées n’étaient pas récupérables, les congés trimestriels n’ayant pas selon lui
la nature de congés payés. Pour donner raison à la salariée, le conseil de prud’hommes retient au
contraire que "les congés trimestriels prévus par l’article 6 de la convention collective sont aux
termes mêmes de cet article des congés payés annuels supplémentaires". Ces périodes étant "de
ce fait assimilées à des congés payés, les jours de formation économique, sociale et syndicale" ne
peuvent s’y imputer.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, soutenant notamment que le conseil de prud’hommes
ne pouvait trancher ce litige en référé dès lors qu’il existait une contestation sérieuse sur
l’interprétation de la convention collective. La Cour de cassation écarte cette analyse et donne
raison à la salariée. Les hauts magistrats retiennent "qu’en vertu de l’article L. 3142-12 du code du
travail, la durée de la formation syndicale ne peut être imputée sur celle des congés payés annuels
et doit être assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée de ces
congés". En l’espèce, "le conseil de prud’hommes, en décidant que les jours de formation syndicale
ne pouvaient être imputés sur les congés payés prévus par la convention collective précitée a, sans
trancher une contestation sérieuse, fait une exacte application des textes conventionnels".
Cass. soc., 20 janvier 2016, n° 14-26.684, non publié

Une injure dans une publication syndicale satirique
diffusée dans l’entreprise n’est pas diffamatoire
faute de publicité
Le tribunal correctionnel de Valenciennes juge le 1er octobre 2015 qu’un journal syndical satirique
contenant un texte injurieux envers un directeur adjoint ne permet pas de condamner pour
diffamation son directeur de la publication, un responsable syndical, dès lors que ce journal,
distribué aux seuls salariés de l’entreprise et affiché sur les panneaux syndicaux, n’a pas été diffusé
hors de l’entreprise. La condition de publicité permettant de caractériser la diffamation n’est donc
pas remplie.
Ne constitue pas une diffamation un texte injurieux visant le directeur adjoint d’un établissement,
paru dans un bulletin d’information syndical à caractère satirique distribué aux seuls salariés et
affiché sur les panneaux syndicaux. En effet, la condition de publicité, qui constitue un des critères
cumulatifs de la diffamation, n’est pas remplie. C’est ce que retient le tribunal correctionnel de
Valenciennes dans un jugement du 1er octobre 2015.
Dans cette affaire, le secrétaire d’un syndicat CGT de la société Apave fait l’objet d’une plainte
pour diffamation de la part du directeur adjoint de l’établissement, en tant que directeur de
publication d’un bulletin d’information syndical à caractère satirique diffusé dans l’entreprise. La
plainte vise un premier article qui évoque "les souffrances morales orchestrées au bureau de
Valenciennes" qui "doivent cesser et les harceleurs punis et mis hors d’état de nuire". Un second
article pointe "Moi, Régis X, directeur adjoint, harceleur, liquidateur, fossoyeur…", et "Cravache
d’or 2011".
Le tribunal correctionnel, saisi de l’affaire, rappelle en premier lieu que "la diffamation est établie
dès lors qu’il existe un caractère public des propos, une identification de la personne visée et
l’allégation d’un fait déterminé", ces éléments étant cumulatifs.
À la lumière de ces règles, les propos sur les "souffrances morales" ne relèvent pas de la
diffamation, constate le tribunal, dès lors qu’ils ne font "pas référence à une personne précise mais
un ensemble indéterminé". Il est donc "impossible en les lisant d’identifier un individu et dans
cette phrase rien ne permet de viser précisément" le directeur adjoint.
Tel n’est pas le cas du second article où ce dernier est visé "sans équivoque" et "parfaitement
identifiable". Pour le tribunal, "les termes employés, au-delà de la satire, sont injurieux et
pourraient revêtir un caractère diffamatoire". Cependant, se pose la question de leur publicité.
"Le journal concerné est une publication syndicale d’entreprise distribuée aux salariés ou affichée
sur des panneaux syndicaux", constate à cet égard le tribunal qui ajoute : "La jurisprudence a
considéré que le personnel d’une entreprise, quelque nombreux qu’il soit, ne constitue pas le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%