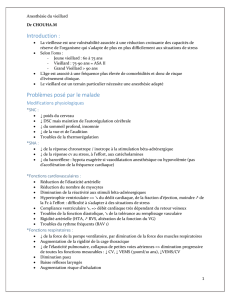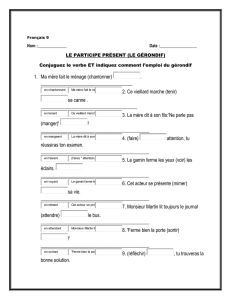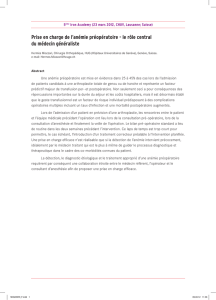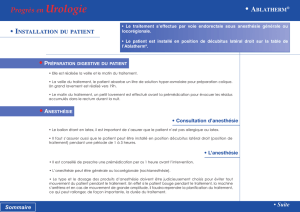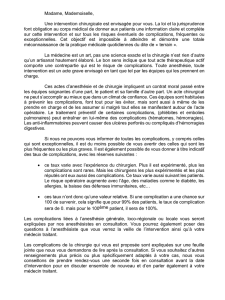Anesthésie du grand vieillard

Anesthésie du grand vieillard
P. Juvin, G. Plantefève
Service d'anesthésie-réanimation chirurgicale, centre hospitalier Bichat-Claude-Bernard,
46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris, France
POINTS ESSENTIELS
· Après 85 ans, un patient sur deux est classé ASA 3 à 5.
· Le vieillissement physiologique se caractérise par une altération des réserves fonctionnelles
des organes. Ceux-ci ne peuvent plus faire face à une augmentation brutale des besoins. L'âge
chronologique joue probablement un rôle chez le grand vieillard dans l'évolution des états
morbides. Le bilan préopératoire doit donc évaluer les capacités d'adaptation restantes de
l'organisme.
· Les grands vieillards reçoivent souvent de très nombreux médicaments, qui exposent à des
risques d'interactions.
· La pharmacocinétique et la pharmacodynamie des médicaments de l'anesthésie sont
modifiées chez le grand vieillard. La prudence commande de minorer les posologies, d'utiliser
des médicaments de délai et de durée d'action courts, de les titrer et de monitorer leurs effets.
· Dans une population générale, il n'y a pas d'avantage décisif à utiliser une technique
d'anesthésie générale plutôt qu'une technique d'anesthésie rachidienne, et inversement.
· L'anesthésie ambulatoire est possible chez le grand vieillard autonome et/ou entouré.
· L'analgésie postopératoire est souvent insuffisante chez les grands vieillards. Elle doit
répondre aux mêmes impératifs de prescription (minoration des posologies, titration,
monitorage) que les autres médicaments de l'anesthésie.
· Les troubles cognitifs et les états d'agitation sont fréquents dans la période postopératoire. Ils
doivent faire rechercher une cause immédiatement curable. Ils doivent faire l'objet de mesures
préventives.
· L'âge lui-même est un facteur de risque de troubles cognitifs postopératoires.
· L'objectif principal de la prise en charge médico-chirurgicale du grand vieillard est le retour
rapide à une autonomie optimale dans un environnement connu.
Près de 6,5 millions de français ont plus de 70 ans, 2,1 millions ont plus de 80 ans et quatre
cent mille ont plus de 90 ans. Les français âgés de plus de 65 ans représentaient 12,6 % de la
population en 1968 et 13,9 % en 1990. En 1998, ils représentent 15,6 % de la population. La
sur-représentation des femmes dans les classes d'âge apparaît tôt, dès 60 ans et devient
franche à 75 ans : elles représentent 60 % de la classe d'âge 75-79 ans et 75 % des plus de 90
ans. Parmi les personnes âgées, les classes d'âge les plus avancées sont de plus en plus
représentées (source Insee). La plupart des auteurs s'accordent pour considérer que 65 ans

constitue un tournant dans l'évolution de la santé [1]. En fait, il n'y a pas de consensus sur la
définition d'une personne âgée. Certaines études mettent la barre à 65 ans, d'autres plus
tardivement. La notion de « grand vieillard » est encore plus floue. Définition chronologique
(plus de 80 ans, de 90 ans ?) ou fonctionnelle (personne dépendante ou vivant en institution ?,
classe ASA élevée ?). La prise en charge périopératoire de ces patients très âgés
(chronologiquement ou fonctionnellement) n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études. Faute
d'une définition claire, nous bâtirons notre propos sur la littérature disponible, qui concerne
souvent des personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans, ou présentant un déficit fonctionnel, et,
par analogie, nous en tirerons des enseignements à appliquer au « grand vieillard », c'est-à-
dire à une personne âgée de plus de 80 ans et/ou à une personne âgée ayant un déficit ou un
état de santé précaire.
En 1996, un tiers des anesthésies était pratiqué chez des patients âgés de plus de 60 ans. Ce
chiffre est en nette augmentation par rapport à la période 1978-1982, où les plus de 60 ans
représentaient moins de 20 % des opérés. Après 75 ans, le taux annuel d'anesthésies pour les
femmes (hors endoscopie) (16,8 anesthésies pour 100 habitantes) est inférieur à celui des
hommes (19,6). Après 85 ans, un patient anesthésié sur deux (hors endoscopie et chirurgie
ambulatoire) est classé ASA 3 à 5 [2]. Par rapport à la période 1976-1982, l'augmentation du
nombre d'anesthésies chez le sujet âgé s'est essentiellement faite au bénéfice de l'endoscopie
digestive, de l'orthopédie et de l'ophtalmologie. Actuellement, entre 75 et 84 ans, 30 % des
anesthésies (hors endoscopie) concernent l'ophtalmologie, 24 % l'orthopédie, 13 % la
chirurgie digestive et 11 % la chirurgie urologique. Après 85 ans, 29 % des anesthésies sont
des anesthésies loco-régionales [3], et 20 % des anesthésies sont réalisées en urgence (moins
de 10 % entre 45 et 55 ans) [4].
La morbidité et la mortalité périopératoires augmentent avec l'âge [5]. Pourtant, les taux de
morbidité et de mortalité périopératoires ne sont pas plus élevés chez les octogénaires en
bonne condition physique que chez les adultes jeunes devant bénéficier du même type
d'intervention chirurgicale [5] [6]. Il est habituel d'affirmer que, plus que l'âge chronologique,
c'est l'âge physiologique, et donc l'état de santé préopératoire, qu'il faut prendre en compte.
D'où l'importance de l'évaluation préopératoire. En fait, nous verrons que chez le grand
vieillard, le vieillissement physiologique se traduit par une très grande difficulté de
l'organisme à faire face à des situations de stress. À ce moment, l'âge chronologique joue
probablement un rôle dans l'évolution des maladies.
ÉVALUATION PRÉOPÉRATOIRE
Bilan préopératoire
L'interrogatoire est une étape importante dans l'évaluation du risque anesthésique. Il permet
de préciser les antécédents, les traitements, les symptômes et les facteurs de risque en
particulier cardiovasculaires (âge, sexe, diabète) [7]. Le mode de vie est un élément
fondamental à préciser. En effet, l'absence de symptôme cardiovasculaire ou respiratoire doit
être analysée en fonction de l'activité du patient. L'électrocardiogramme de repos et la
radiographie thoracique permettent un débrouillage rapide, surtout quand le patient est très
sédentaire. Les conséquences du vieillissement peuvent se résumer par une perte des réserves
fonctionnelles de tous les organes [8]. Par définition donc, même le grand vieillard
asymptomatique est exposé à une rupture de l'équilibre en cas de stress dépassant ses
capacités d'adaptation. L'évaluation préopératoire aura donc pour but principal de déterminer

les capacités d'adaptation du patient face à une agression. Les résultats de cette évaluation
doivent pouvoir être pris en compte dans la décision chirurgicale.
Système nerveux
Le système nerveux est le principal organe cible de l'anesthésie [9]. La proportion de
substance grise, ainsi que l'index craniocérébral, qui est un indicateur grossier de la quantité
de tissu cérébral dans la boîte crânienne, diminuent avec l'âge [10]. Au plan microscopique, la
quantité de neurones et de synapses diminue considérablement en plusieurs régions (cortex
occipital, thalamus antérieur, locus ceruleus, hippocampe). Au plan biochimique, les
concentrations locales de neurotransmetteurs et la quantité ou l'activité de plusieurs récepteurs
sont plus faibles chez le vieillard que chez le sujet jeune. Cette tendance à une diminution
globale de la quantité et de l'efficacité des neurotransmetteurs va de pair avec une
augmentation des concentrations tissulaires d'enzymes, comme la monoamine oxydase,
connues pour inactiver l'action de certains neurotransmetteurs. Des modifications similaires
ont été mises en évidence dans la moelle épinière [9]. Mais le lien entre ces altérations du
système nerveux et la réduction des besoins en anesthésiques que nous évoquerons plus loin
reste à démontrer [11] [12]. Le fait que les sujets âgés voient leurs besoins diminués en
anesthésiques aussi différents que le thiopental ou les halogénés n'est pas en faveur d'un
mécanisme unique spécifique d'un médicament. Les modifications pharmacodynamiques et
pharmacocinétiques des médicaments de l'anesthésie liées au vieillissement seront étudiées
plus loin.
Fonctions respiratoires
Le vieillissement normal du système respiratoire se traduit par une diminution progressive de
toutes les fonctions mesurables. Trois mécanismes concourent à l'altération de la mécanique
ventilatoire : réduction de la force de la pompe ventilatoire, par baisse de la force des muscles
respiratoires [13], augmentation de la rigidité de la cage thoracique (calcifications des
articulations chondrocostales, pincement des espaces intervertébraux et cyphose) et altération
des propriétés élastiques du poumon. L'altération de la pompe ventilatoire est responsable
d'une diminution de tous les volumes mobilisables et des débits, alors que le volume résiduel
augmente. La diminution de l'élasticité pulmonaire altère la stabilité des petites voies
aériennes, qui tendent à se collaber plus facilement que chez le sujet jeune [14]. Ces éléments
sont responsables d'une augmentation du volume de fermeture [15]. Ainsi chez le sujet âgé,
les petites bronches peuvent se fermer même en ventilation normale. Ces faits, associés à des
altérations des rapports ventilation-perfusion [16] et de la capacité de diffusion
alvéolaire [17], expliquent que l'hypoxémie soit plus fréquente chez le sujet âgé [18]. Le
contrôle respiratoire est aussi altéré par le vieillissement puisque les réponses ventilatoires à
l'hypoxémie et à l'hypercapnie diminuent chez le sujet âgé [19]. Dans la période
postopératoire, la diminution de la clairance mucociliaire [20] et l'altération du réflexe de toux
et de la déglutition [21] peuvent entraîner des troubles de la ventilation. Le risque d'apnée
postopératoire est aussi augmenté. Mais il est peut-être plus en relation avec des modifications
pharmacocinétiques des médicaments de l'anesthésie, qu'avec une « hypersensibilité » du
contrôle ventilatoire. Au total, les altérations du système ventilatoire en relation avec le
vieillissement physiologique peuvent passer inaperçues dans la période préopératoire. Elles
peuvent n'apparaître que dans la période postopératoire ou en situation de stress, quand existe
une augmentation brutale des besoins en oxygène. Il est logique de proposer plusieurs types
d'interventions susceptibles de contrebalancer tout ou partie de ces anomalies : prévention de
l'hypoxémie (préoxygénation systématique, oxygénothérapie postopératoire, induction ou

anesthésie en ventilation spontanée en léger procubitus), prévention de la fatigabilité
respiratoire (indications « larges » de la ventilation mécanique), protection des voies aériennes
(extubation alors que le patient est parfaitement réveillé), prévention de l'altération de la
réponse à l'hypoxémie et à l'hypercapnie (utilisation d'anesthésiques de courte durée d'action,
titration et monitorage de la curarisation), kinésithérapie respiratoire.
Fonctions cardiovasculaires
Le vieillissement normal s'accompagne d'altérations progressives du système circulatoire :
réduction de l'élasticité artérielle, réduction du nombre de myocytes, diminution de la
réactivité aux stimuli bêta-adrénergiques, hypertrophie ventriculaire et baisse du nombre de
cellules des voies de conduction [22] [23]. La réduction de la compliance ventriculaire, liée à
l'hypertrophie myocardique, rend le débit cardiaque très dépendant du retour veineux. Au
repos, les conséquences cliniques de ces modifications restent longtemps mineures,
essentiellement représentées par une augmentation de la pression artérielle systémique. Mais
la caractéristique principale du système cardiovasculaire du vieillard est sa difficulté à
s'adapter à des situations de stress (exercice, frisson, etc.). Par rapport au sujet jeune, la VO2
max est plus faible chez le sujet âgé [24], et la fraction d'éjection et la fréquence cardiaque
augmentent moins à l'effort. Parallèlement, la fréquence des maladies cardiovasculaires
augmente avec l'âge. L'âge lui-même (> 75 ans) est considéré comme un élément prédictif de
risque cardiovasculaire (mort, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque) en période
périopératoire d'une chirurgie non cardiaque [7]. Mais, bien que la maladie athéromateuse soit
plus fréquente chez le sujet âgé, sa mise en évidence par le simple examen clinique peut être
difficile compte tenu d'une activité physique peu importante ou d'une difficulté de
communication (déficit intellectuel, auditif ou trouble de l'expression). Dans ces situations où
l'interrogatoire ne permet pas de conclure, il faut s'aider largement d'examens non invasifs
(scintigraphie, échocardiographie). La calcification des valves est fréquente chez le
vieillard [25]. Elle doit être recherchée et, au besoin, son retentissement quantifié par
échographie. Les troubles de la conduction et du rythme sont également fréquents. Un
enregistrement sur 24 h chez une population asymptomatique a montré qu'à 60 ans, 88 % des
sujets présentent des troubles du rythme supraventriculaires et 80 % des troubles du rythmes
ventriculaires [26]. Il est logique de penser que ces pourcentages sont au moins aussi
importants chez le « grand vieillard ». Dans la période peropératoire, l'absence de réserve
cardiaque doit conduire l'anesthésiste à prévenir et à traiter précocement les épisodes
d'hypotension artérielle (monitorage « serré » de la pression artérielle, éviter les retards de
remplissage, tolérer les élévations modérées de la pression artérielle). Le fait que le débit
cardiaque soit très dépendant du retour veineux rend le maintien d'une volémie normale, l'un
des objectifs prioritaires de l'anesthésie du vieillard. Enfin, la place des médicaments de
l'anesthésie à courts délai et durée d'action (propofol, desflurane, sévoflurane) n'a pas été
évaluée sur le plan hémodynamique. Il est cependant logique de penser qu'ils pourraient
permettre un meilleur contrôle de la pression artérielle dans des situations d'instabilité
volémique.
Fonctions rénales
La vascularisation rénale, la filtration glomérulaire et les fonctions tubulaires sont altérées
chez le vieillard [27]. Les vieillards sont particulièrement exposés à tous les types
d'insuffisance rénale aiguë car, comme pour les autres systèmes, les fonctions rénales
s'adaptent mal à des situations de stress [28]. Parmi celles-ci, la diminution de la perfusion
rénale et l'hypovolémie sont fréquentes dans la période périopératoire. Ces éléments sont une

justification supplémentaire pour prévenir et traiter précocement toute baisse de la pression
artérielle et de la volémie dans la période périopératoire.
Squelette et peau
L'ostéoporose et l'arthrose sont banales chez le vieillard [29]. Lors de manipulation du corps
sous anesthésie générale, elles exposent à des risques de fractures et de complications à type
d'étirements ou de luxations. La peau est fragile et exposée à des risques de nécrose par
compression. Au bloc opératoire, les soins les plus minutieux (mobilisation lente, pas de
position forcée, pas de point de compression) sont nécessaires pour prévenir ces
complications.
Prises médicamenteuses préopératoires
La polymédication est la règle chez le vieillard, puisque moins de 5 % des patients âgés ne
prennent aucun médicament à domicile [30]. Les médicaments les plus prescrits sont les
antibiotiques, les médicaments à effet cardiovasculaire, les antalgiques, les benzodiazépines et
des médicaments à visée intestinale. Un tiers des personnes de plus de 65 ans pratiquerait
l'automédication [31]. Cette polymédication peut avoir plusieurs conséquences. Par exemple,
un traitement préopératoire par les benzodiazépines est un facteur de risque de troubles des
fonctions cognitives dans la période postopératoire [32] ou de chute et de fracture de hanche.
La polymédication, l'augmentation de la fréquence des maladies associées, les modifications
méconnues [33] et très variables d'un patient à l'autre [34] de la pharmacologie des
médicaments et les difficultés d'adaptation des fonctions vitales à un stress [8] augmentent les
risques d'interactions médicamenteuses chez le vieillard [35]. Par exemple, comme le débit de
filtration glomérulaire chute de 50 % entre 20 et 80 ans, une altération même minime de celui-
ci, lors de l'administration d'AINS, peut provoquer une insuffisance rénale aiguë qui ne serait
pas apparue chez le sujet jeune [31].
INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT
SUR LA PHARMACOCINÉTIQUE DES MÉDICAMENTS
Considérations générales
Les sujets âgés nécessitent des quantités d'anesthésiques moindres que les sujets jeunes [36].
Cette observation est en relation avec un effet de l'âge sur le comportement
pharmacocinétique et pharmacodynamique des médicaments de l'anesthésie.
Distribution des médicaments
La composition de l'organisme se modifie avec l'âge et peut altérer la pharmacocinétique des
médicaments. Chez le vieillard, la masse maigre et la quantité d'eau totale diminuent, et la
masse grasse augmente [37]. Les agents très liposolubles (diazépam, midazolam, nitrazépam)
ont donc un plus grand volume de distribution à l'équilibre, ce qui tend à prolonger leur effet,
alors que le volume du compartiment central diminue [38]. Parallèlement, les concentrations
de protéines plasmatiques varient avec l'âge (la concentration de l'albumine plasmatique
diminue, alors que celle de l'alpha-1-glycoprotéine augmente [39]). Les fractions libres
actives des médicaments liés à celles-ci varient donc. Ainsi, les besoins du vieillard en
propofol (fixé à l'albumine) diminuent et ceux de la lidocaïne (liée à l'alpha-1-glycoprotéine)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%