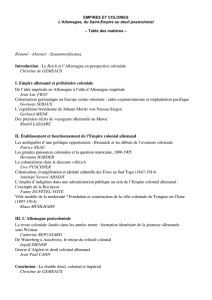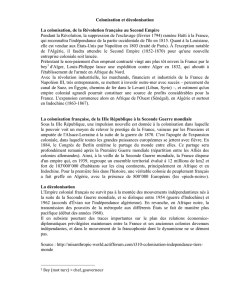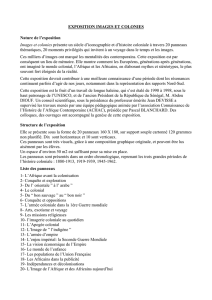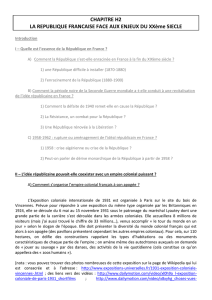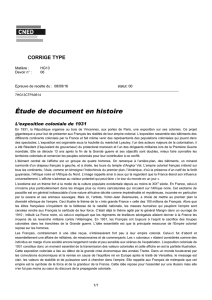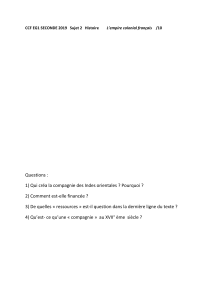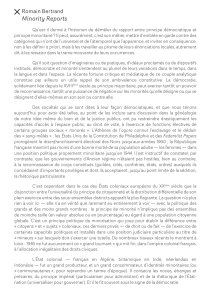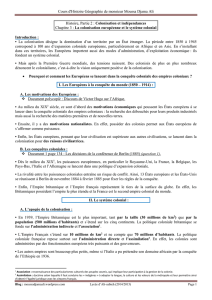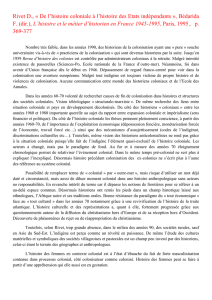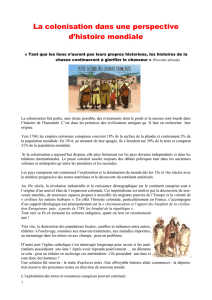Table des matières - L`esprit économique impérial

T
Ta
ab
bl
le
e
d
de
es
s
m
ma
at
ti
iè
èr
re
es
s
Introduction, par Hubert Bonin
I. PISTES BIBLIOGRAPHIQUES
1. « Impérial », « impérialisme » : quelques jalons de réflexion
2. Patronats, élites, chambres de commerce & d’industrie, places marchandes : les
enjeux socio-institutionnels et culturels de l’outre-mer impérial
3. Bourgeoisies, élites, développement capitaliste : cultures, valeurs institutionnelles,
réseaux, représentation
4. Groupes de pression et réseaux d’influence patronaux
II. LES RESEAUX D’INFLUENCE AU COEUR DU SYSTEME POLITIQUE
Francis Démier, professeur à l’Université de Paris 10-Nanterre, “L’esprit
impérial” français confronté à la première industrialisation
1. Restaurer l’empire ultramarin
2. L’alliance des manufacturiers et des ports pour promouvoir une politique
ultramarine
3. La Restauration à l’épreuve des groupes de pression ultramarins
4. L’impossible renouvellement des conceptions impériales
Conclusion : Le jeu des rivalités au sein des milieux d’affaires ultramarins
Éric Anceau, maître de conférences à l’Université de Paris 4-Sorbonne, Deux
façons de concevoir et d’appliquer la politique coloniale ? Le Prince Napoléon et
Prosper de Chasseloup-Laubat, ministre de l’Algérie et des Colonies (juin 1858-
novembre 1860)
1. Aux origines du ministère des Colonies
A. Une conception ancienne
B. Vers le gouvernement civil algérien
C. Le retour au projet de ministère et la création de celui-ci
2. Le ministère du prince Napoléon
A. Les idées du prince et l’organisation générale de son ministère
B. La difficile mise en œuvre d’un programme d’assimilation centré sur la
réorganisation administrative de l’Algérie
C. La démission du prince (mars 1859) et l’inquiétude des colons
3. Le ministère de Chasseloup-Laubat (mars 1859-novembe 1860)
A. Le nouveau ministre et ses conceptions
B. Le primat des réformes économiques
C. La fin du ministère Chasseloup-Laubat (novembre 1860)
Conclusion
Nicole Tixier, docteur en histoire contemporaine de l’Université de Nantes, La
Chine dans la stratégie impériale : le rôle du Quai d’Orsay et de ses agents

2
1. De la Monarchie de Juillet à la fin du Second Empire : une implantation encore
timide
A. Les premiers pas en Chine : la première ambassade officielle de Théodose de
Lagrené et le traité de Whampoa du 24 octobre 1844
B. L’établissement des premiers postes consulaires
C. Les diplomates et consuls : statut et fonctions
2. La Troisième République : le temps des conquêtes et une politique d’expansion
beaucoup plus active dans les années 1890
A. Les années 1880 : la question du Tonkin et ses conséquences, prélude à une
nouvelle expansion en Chine
B. Les années 1890 : Une expansion beaucoup plus offensive concrétisée par la
cession de territoires à bail, de mines et de voies ferrées
C. L’évolution du recrutement et des fonctions des agents diplomatiques et
consulaires
3. Après la guerre des Boxers, les puissances et la France à leur apogée : la Chine en
voie de colonisation ?
A. Du Protocole de 1901 à la révolution de 1911
B. La mise en place de nouveaux postes consulaires et l’évolution des anciens postes
C. L’évolution des fonctions consulaires
Conclusion
Julie d’Andurain, doctorante en histoire contemporaine et chercheur-associé au
Centre Roland Mousnier, Université de Paris 4-Sorbonne, Réseaux politiques et
réseaux d’affaires : le cas d’Eugène Étienne et d’Auguste d’Arenberg
1. Le poids des héritages
A. Deux hommes, deux parcours : un fort contraste social
B. Enracinement paysan et enracinement méditerranéen
C. L’adhésion au gambettisme
D. Les effets du Ralliement
2. La rencontre des fondateurs du « parti colonial »
A. « L’opportuniste et le rallié »
B. Utopies et réseaux
C. La naissance du Comité de l’Afrique française
3. La genèse du « parti colonial »
A. À la croisée des chemins : les sociétés concessionnaires, entre la politique et
l’économie.
B. Le « parti colonial » comme substitut du sous-secrétariat d’État aux Colonies ?
C. Les liens avec les milieux d’affaires
Conclusion
Xavier Daumalin, maître de conférenees à l’Université d’Aix-en-Provence, Le
pouvoir d’influence de Paul Leroy-Beaulieu sur la politique africaine
La doctrine coloniale africaine de Paul Leroy-Beaulieu (1870-1916) : essai d’analyse
thématique
1. L’utopie sociale et politique de Leroy-Beaulieu
2. Leroy-Beaulieu et la colonisation économique
3. La dimension stratégique des propositions de Leroy-Beaulieu
Conclusion

3
Jean Vavasseur-Despérier, professeur à l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3,
Charles Jonnart et le « parti colonial » : économie et politique
1. L’esquisse d’un réseau : des rencontres opportunes (1881-1901).
A. Jonnart fonctionnaire à Alger
B. Jonnart à la Chambre des députés : ses liens avec Eugène Étienne
C. Les liens entre Jonnart, Aynard et d’Arenberg
2. Une position centrale, mais non prédominante, dans le « parti colonial » (1901-
1927).
A L’image flatteuse de Jonnart en Algérie
B. Le poids grandissant d’Étienne au sein des réseaux impériaux
C. Jonnart et le Comité de l’Afrique française
D. Jonnart et les réseaux d’influence orientés vers l’Orient
3. Quelle influence et quel esprit impérial? Économie et politique
A. Jonnart, un leader de consolidation, non d’expansion
B. L’influence de Jonnart dans un espace géographique circonscrit
C. Les affaires présentes, mais pas au premier plan des préoccupations de Jonnart
C. Le projet politique et social de Jonnart
Conclusion
Claude Prudhomme, professeur à l’Université Lumière-Lyon 2, Le missionnaire
et l’entrepreneur colonial
1. Réseaux missionnaires et capitalisme : liens personnels et échanges de services
2. Un cas particulier : le lobby lyonnais au Levant
3. Le poids des missions dans l’économie des colonies
A. Le poids financier des investissements missionnaires
B. La place des missions dans l’appareil de production colonial
C. La perception indigène
D. La contribution au développement d’une clientèle pour le commerce français ?
4. Ethos missionnaire et esprit capitaliste : la mission comme auxiliaire de la
pénétration des idéaux du capitalisme
A. La formation des hommes et des femmes
B. La diffusion « d’un ethos économique de type capitaliste »
C. La prévalence des modes chrétiens
Conclusion
Daniel Leplat, doctorant d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1-
Sorbonne, Groupes de pression coloniaux et réseaux administratifs face aux usages
et à la valeur de la piastre indochinoise (1945-1960)

4
1. Les stratégies d'empire du ministère des Finances ?
A. Les flux de capitaux dans l'Union française : une liberté affichée, une réalité
contrastée
B. Les préférences du ministère des Finances
C. Une ou des stratégies impériales au ministère des Finances ?
2. Les milieux d’affaires indochinois face au contrôle des changes
A. L'étude des milieux d'affaires saïgonnais. Remarques méthodologiques.
B. Sortir d'Indochine : l'appel à l'empire
C. Les milieux d'affaires et la piastre
3. Le patronat saïgonnais face à la dévaluation de la piastre
A. La dévaluation de la piastre (mai 1953)
B. Les réactions des milieux d'affaires
C. Une dévaluation sabotée ?
Conclusion
Hugues Tertrais, maître de conférences à l’Université Paris 1-Sorbonne, Le
patronat français et la Guerre d’Indochine
1. Le capitalisme colonial en Indochine : un patronat sur la défensive
2. Le lobby colonial : un patronat qui s’accroche à l’Indochine
3. Les milieux d’affaires “éclairés” : tourner la page indochinoise
Conclusion
III. LES RESEAUX D’INFLUENCE SUR LES PLACES REGIONALES EN FRANCE
METROPOLITAINE
Laurent Morando, docteur en histoire contemporaine, Université de Provence,
Les Instituts coloniaux de province (1893-1940) : une action efficace ?
1. Les Instituts coloniaux de province : des hommes et des structures
A. L’Institut colonial de Marseille jusqu’en 1914
B. L’Institut colonial de Bordeaux jusqu’en 1914
C. L’épreuve de la Grande Guerre et l’échec de la Fédération des Instituts coloniaux
français
D. La fondation de l’Institut colonial de Nice (1927-1931)
E. La fondation de l’Institut colonial du Havre : 1929-1931
F. De l’âge d’or (1922-1931) au temps des difficultés (1932-1940)
2. L’action des Instituts coloniaux : propagande, enseignement, recherche
scientifique et débats doctrinaux
A. Une propagande coloniale efficace ?
B. L’enseignement des Instituts coloniaux : des cadres souvent similaires au service
d’intérêts essentiellement locaux
C. Enseignements, enseignants et étudiants
D. Documentation, recherche scientifique et débats doctrinaux
Conclusion
Yves Péhaut, professeur honoraire de l’Université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3, Le réseau d’influence bordelais : la "doyenne" Maurel & Prom jusqu’en
1914

5
1. Les étapes de la formation de la maison Maurel & Prom
2. La capacité d’influence des Maurel pour la nomination des gouverneurs
3. L’influence et les réseaux d’Émile Maurel, devenu le leader des « Sénégalais » de
Bordeaux
4. L’influence des Girondins au sein de l’Union coloniale : Bordeaux capitale du
Sénégal ?
Conclusion
Hubert Bonin, professeur à l’Institut d’études politiques de Bordeaux et au
GRETHA-Université de Bordeaux 4, La construction d’un système socio-mental
impérial par le monde des affaires ultramarin girondin (des années 1890 aux
années 1950)
1. Bordeaux dans le système économique ultramarin
2. La cristallisation de réseaux de sociabilité ultramarine : un apogée au tournant du
XXe siècle ?
A. Des réseaux familiaux ?
B. La construction d’un réseau d’influence ?
C. L’organisation de la traite sur la Côte occidentale d’Afrique
3. La diversification des circuits d’influence ultramarins dans l’entre-deux-guerres
A. Une politique constante de formation de l’opinion éclairée
B. La Foire de Bordeaux, vecteur de popularisation des valeurs impériales
C. Les institutions parapatronales
D. La consécration politique et citoyenne ?
E. Un outil nouveau, le Syndicat de défense des intérêts de la Côte occidentale
d’Afrique
F. Comment apprécier l’influence des rhumiers actifs aux Antilles ?
G. Apogée et immobilisme d’un système productif et d’un système socio-mental ?
H. Vers une remise en cause de la capacité d’influence des milieux d’affaires
ultramarins girondins ?
4. Vers un recentrage des objectifs d’influence (dans les années 1950) ?
A. La force du renouveau ultramarin
a. Privilégier le Maroc ?
b. La reconstitution d’un bloc d’influence ultramarin ?
B. Un patronat girondin sans influence nationale ?
C. Une crise de légitimité ?
Conclusion
Xavier Daumalin, maître de conférences à l’Université de Provence, Le patronat
marseillais face à la politique de la préférence impériale (1931-1939)
1. L’empire, seulement un marché d’appoint pour les Marseillais
2. L’économie ouest-africaine sinistrée par la récession des années 1930
3. Vers la politique de la préférence impériale
4. L’imaginaire colonial marseillais éclaté
Conclusion
Guy Durand, doctorant en histoire contemporaine, Université Paris 1-Sorbonne,
archiviste, Marseille colonial : quels choix ? quels mythes ? quelles réalités ?
1. Marseille métropole méditerranéenne
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%