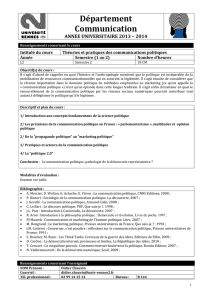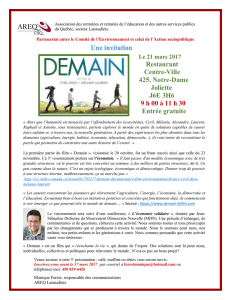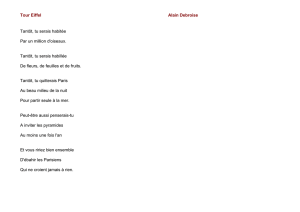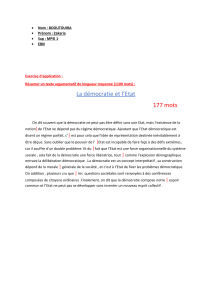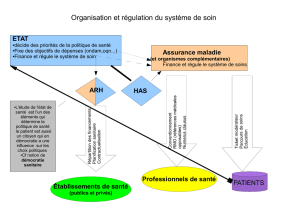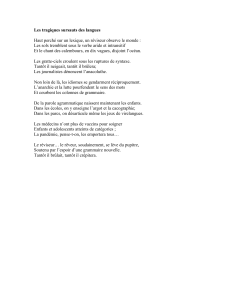Minority Reports

Qu’est-il donné à l’historien de démêler du rapport entre principe démocratique et
principe minoritaire ? Il peut, assurément, c’est son métier, mettre d’emblée en garde contre des
catégories qui n’ont de l’universel et de l’atemporel que l’apparence, et inviter en conséquence,
non à les définir a priori, mais à les travailler au prisme de leurs énonciations locales, autrement
dit, à les ressaisir dans la trame mouvante de leurs occurrences.
Qu’il soit question d’imaginaires ou de pratiques, d’idéaux proclamés ou de dispositifs
institués, démocratie et minorité s’entendent au pluriel de leurs variations dans le temps, dans
la langue et dans l’espace. La récente fortune critique et médiatique de ce couple analytique
constitue par ailleurs un utile rappel de son ambivalence constitutive. La démocratie,
solidement liée depuis le XVIIIème siècle au principe majoritaire, peut exercer tantôt un pouvoir
de reconnaissance, tantôt une puissance de négation sur les minorités qu’elle désigne ou qui se
désignent d’elles-mêmes en son sein ou contre elle.
Des sociétés qui se sont dites à leur façon démocratiques, et que nous tenons
aujourd’hui pour avoir été telles, au point de les inclure sans discussion dans la généalogie
de notre idée même du bien et de la justice publics, ont pu restreindre drastiquement les
capacités d’accès à l’espace public, au droit de vote, à l’exercice de fonctions électives de
certains groupes sociaux « minorés ». L’Athènes de l’agora connut l’esclavage et le dédain
des « sang-mêlés » ; les États-Unis de la Constitution de Philadelphie et des Federalist Papers
prorogèrent le disenfranchisement électoral des Noirs jusqu’aux années 1960 ; la République
française maintint pas moins d’une bonne moitié de sa population adulte — les femmes — dans
une position politique proprement minoritaire jusqu’en 1944. Il est instructif de constater, par
contraste, que les gouvernements d’Ancien régime n’étaient pas hostiles, bien au contraire,
à la reconnaissance de corps constitués (guildes, cités, confréries, états, ordres) auxquels ils
concédaient d’importants privilèges et dont ils acceptaient, jusqu’au point limite de la sédition,
la rhétorique particulariste.
C’est cependant dans le cas des États coloniaux européens du XXème siècle que la
disjonction entre l’universalité du principe de citoyenneté et la distribution différentielle de son
plein exercice entre des sous-ensembles distincts apparaît la plus flagrante. La question n’a plus
rien à voir ici — elle n’a en vérité que rarement eu entièrement à voir — avec la politique des
grands et des moins grands nombres : le principe de minorité n’implique pas des ensembles
de moindre taille (en valeur absolue ou en pourcentage) eu égard à une population citoyenne
globale. C’est un principe politique de minorisation qui joue pour établir la différence entre
« citoyens » et « sujets » coloniaux, ces derniers privés — de droit ou de fait — de l’exercice de
certaines capacités politiques et installés dans une position judiciaire particulière au titre de
« mineurs » sur lesquels doit s’exercer une tutelle. De nombreux travaux récents le montrent à
loisir : 1946 ne fut aucunement ce « grand tournant » qui mit fin, dans l’empire colonial français,
à l’allocation inégalitaire des droits civiques.
L’État colonial — français en Algérie, britannique en Inde, néerlandais en
Indonésie — fut un grand producteur, et un grand consommateur, d’identités minoritaires (ou
« communautaires », pour reprendre un terme d’époque). Il consacra les noces, étranges et
précaires, du principe impérial (particulariser pour administrer) et de la rhétorique de l’État-
nation (universaliser pour gouverner). Et il le fit souvent sous le signe de la démocratie.
Romain Bertrand
Minority Reports
1
/
1
100%