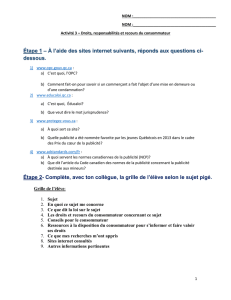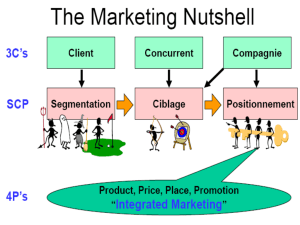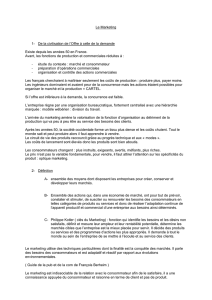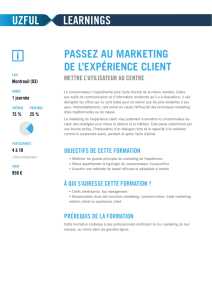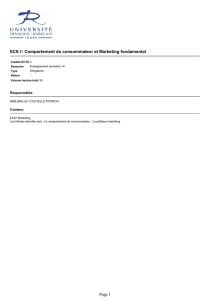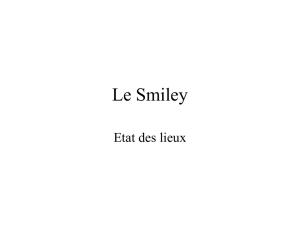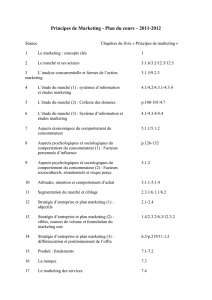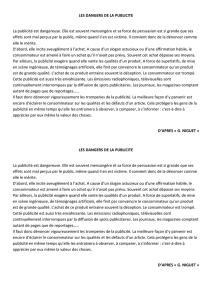DROIT DE LA CONSOMMATION Code pour le campus virtuel

1
DROIT DE LA CONSOMMATION
Code pour le campus virtuel : CONSO2011.
Introduction
I. Les fondements du droit de la C°
Le postulat de base : nous vivons dans une société de C° correspondant à un
développement économique caractérisé par plusieurs phénomènes : la multiplication
des biens et services proposés au consommateur et leur complexité croissante, une
augmentation des risques de toute nature pour le consommateur ; l’urbanisation
croissante qui est le corolaire de l’anonymat des grandes villes et l’anonymat dans les
activités économiques. Ces dernières sont concentrées dans les grands centres
urbains : les entreprises deviennent de très grandes entreprises voire des
multinationales. L’ensemble de ces phénomènes, créant ainsi la multiplication des
besoins de façon artificielle ou la croyance que l’on peut y accéder facilement grâce au
crédit, est entretenu par certaines pratiques des professionnels de séduction et de
promotion via le démarchage par exemple.
L’ensemble de ces événements a créé un déséquilibre entre les consommateurs d’une
part et les professionnels d’autre part. Ce déséquilibre se manifeste à différents égards :
- Déséquilibre économique : le consommateur est le dernier maillon du circuit.
Le consommateur ne peut pas négocier s’il souhaite contracter : soit il ne
contracte pas, soit il contracte aux conditions proposées.
- Déséquilibre intellectuel : face aux compétences du professionnel notamment
à l’égard de certains produits comme ceux de la haute technologie.
- Déséquilibre entre les produits devenus indispensables sociologiquement.
Ce ne sont pas des besoins vitaux mais ils ne sont pas pour autant artificiels.
- Déséquilibre psychosociologique : apprentissage des meilleurs techniques de
vente. Rien de tel dans l’information du consommateur.
Face à ce déséquilibre, le droit civil des contrats ne permet pas d’apporter une réponse
satisfaisante. Ce droit, si certaines conditions sont réunies, pourra aboutir à
l’annulation du contrat pour absence de cause, vice du consentement mais il faut
résoudre les questions probatoire préalablement selon le droit commun. L’annulation
du contrat est-elle pour autant la sanction la plus adaptée pour le consommateur ?
Cette sanction peut dissuasive pour le professionnel et peu réparatrice pour le
consommateur peut avec des D&I.
Laisser subsister le contrat purgé des clauses abusives est plus dissuasif pour les
professionnels. C’est dans le constat de ce déséquilibre qu’est né le droit de la C°.
Déséquilibre qu’il convenait de rétablir par des règles adaptées en revenant au
fondement premier du Droit.
Le fondement tiré du déséquilibre implique une observation : si cette règlementation
repose sur l’infériorité de l’une des parties par rapport à l’autre est-ce que cela signifie
qu’en l’absence d’infériorité il n’y a pas lieu d’appliquer les règles protectrices ? Cette

2
présomption de faiblesse est-elle simple ou irréfragable ? Dans ce dernier cas on est en
présence d’une véritable règle de fond.
Cette référence à la compétence des parties se retrouve en JP notamment sur la
question de savoir si le professionnel peut bénéficier des dispositions protectrices du
droit de la C° quand il n’y connait rien. Exemple : le coiffeur est un professionnel mais
il n’y connait rien en informatique.
II. Les définitions du droit de la consommation
Selon Cornu, le droit de la C° est le nom donné à l’ensemble des lois spéciales destinées
à assurer la protection du consommateur. « l’ensemble des lois spéciales » : cela
conforte l’aspect brouillon de la discipline, pas d’ordonnancement comme en droit civil
ou commercial. Le droit de la C° n’est pas le droit d’un contrat spécial, du contrat de
C°. On ne peut pas définir le contrat de C° par la qualité des contractants. « destinées à
assurer la protection du consommateur » : le droit de la C° se définirait alors par son
but et non par son objet.
La situation du droit de la C° par rapport aux autres branches du droit privé : le droit
de la C° est un droit pluri ou interdisciplinaire.
Droit de la C° / droit civil (droit des obligations et droit de la responsabilité)
- Dans le CV, la théorie du droit des contrats est fondé sur un quasi-dogme qui
est le principe de la liberté contractuelle qui a pour corolaire le consensualisme
et la force obligatoire du contrat. La seule condition à la validité du contrat est
le consentement = consensualisme. Conséquence de ce principe = force
obligatoire. Ce contrat ne peut alors être modifié à l’égard des parties, c’est
l’irrévocabilité du contrat. Puisque les parties sont libres, ce qu’elles ont
convenu a la même force que s’il s’agissait d’une loi. Cette liberté contractuelle
prend appui sur un autre principe : légalité formelle des partie.
- Dans le CC°, on ne retrouve pas ces principes. C’est l’inégalité présumée des
parties qui engendre l’applicabilité de telle ou telle disposition protectrice. Ces
règles protectrices sont le plus souvent impératives. L’existence de ces règles n’a
de portée que si celles-ci sont d’OP sinon on pourrait y déroger. Le droit de la C°
n’est pas une sous-branche du droit civil, ils ne s’excluent pas l’un l’autre. C’est
une branche autonome.
Droit de la C° / droit de la concurrence
- Le droit de la concurrence recouvre l’ensemble des règles applicables aux
relations entre entreprises
- Le droit de la C° vise les relations entreprises/clients.
Pourtant on peut rapprocher les deux disciplines : elles sont nées toutes les deux d’un
même constat => le libéralisme économique absolu fondé sur le principe de la liberté
du commerce et de l’industrie (principe à valeur constitutionnelle) est aussi dangereux
et néfaste pour les concurrents que pour les consommateurs. Ce libéralisme aboutit à
faire prévaloir la loi du plus fort. Le constat est qu’il faut un minimum de règles pour
réaliser un objectif de concurrence libre. Cette liberté parce qu’elle sera effective aura
nécessairement des impacts positifs sur la situation des consommateurs :
l’augmentation de la qualité et la réduction du prix. Ce constat a entrainé un choix
économique : le rejet d’un libéralisme pur sans pour autant remettre en cause la liberté

3
contractuelle. Le dirigisme n’est pas souhaitable en droit de la C° car il constitue à
moyen terme au moins un frein à l’initiative économique.
Il existe des liens étroits entre ces deux disciplines notamment quant aux choix
politiques et économiques d’un pays. Il y a une forte interaction. Et juridiquement, il
existe des règles communes. Certains auteurs ont proposé de faire du droit de la C° et
du droit de la concurrence un droit du marché dans lequel on pourrait intégrer le droit
de la D°.
Droit de la C° / droit pénal
Il existe un droit pénal de la C°. Historiquement, le droit de la C° était un droit pénal.
Droit de la C° / droit administratif
Les structures institutionnelles du droit de la C° qui ont pour objet la protection des
consommateurs comme la DGCCRF.
Droit procédural de la C°
Il existe des règles particulières, adaptées dans le but de réaliser un véritable droit
d’accès à la justice pour le consommateur victime. Exemples : la question de l’action en
justice des associations de consommateurs ; la CJ dans deux arrêts de 2009 impose aux
juges de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’ils
disposent des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Ces décisions ont pour
conséquence d’abroger indirectement, pour les règles protectrices du droit de la C°,
certaines dispositions du CPC.
La difficulté vient du fait que la notion du droit de la C° n’est pas juridique mais
économique. L’étymologie du terme vient du sens économique de la C° c’est le stade
ultime du circuit économique. La C° est nécessairement le dernier stade ce qui signifie
que si une personne achète un produit ou un service dans le but de mettre lui-même
une valeur économique sur le marché, au sens économique du terme il ne s’agit plus de
C° si on remet le produit dans le circuit économique.
Le droit de la C° peut se définir par son objet finalisé qui est le fait de se procurer un
bien ou un service pour un usage personnel ou familial.
III. Les sources du droit de la consommation
A. Les sources européennes
Dans le traité de Rome de 1957, le consommateur n’apparaissait que de façon
marginale ce qui a conduit le Pr Dubuis à l’observation suivante : « longtemps le droit
communautaire a offert le paradoxe d’être le droit d’un marché de C° qui ignorait presque
totalement le consommateur ». La notion dans le traité servait de révélateur aux
entraves à la non discrimination ou au non respect de la concurrence entre entreprises
ou encore à la libre circulation des produits et des services.
La prises de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des consommateurs est
apparue dans les 70’s à la suite des USA (60’s notamment suite au discours de Kennedy
en 1962 dans lequel il proclame que nous sommes tous consommateurs). En europe il a
fallu attendre 1975 pour observer les premières interventions législatives avec un

4
programme préliminaire pour une politique de protection et d’information des
consommateurs dans lequel sont consacrés 5 droits fondamentaux :
- Le droit à la protection de la santé et de la sécurité
- Le droit à la protection de ses intérêts économiques
- Le droit à la réparation des dommages
- Le droit à l’information et à l’éducation
- Le droit à la représentation
Ce programme a constitué la deuxième étape.
En 1992, la troisième étape, avec le traité sur l’UE de Maastricht qui créé un titre 11 dans
le traité qui s’intitule : « protection des consommateurs » qui comportait un article
unique devenu article 169 TFUE. Depuis, la protection des consommateurs est devenu
un objectif. Puis la charte des droits fondamentaux de l’UE qui proclame : « la
communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ». Avec
l’article 169, deux moyens sont mis à disposition de l’UE pour réaliser cet objectif :
a) Adopter des mesures prises en application de l’article 95 TCE dans le cadre de
la réalisation du marché intérieur. Cette méthode vise le rapprochement des
législations.
b) Prendre des mesures en faveur des consommateurs (règlements, directives,
décisions).
Il faut tenir compte du principe de subsidiarité cela veut dire que le législateur
européen n’est censé intervenir qu’en de défaillance, d’insuffisance de l’action des EM
(article 5 TCE).
L’article 169 TFUE dans son 5° précise : « les mesures prises sur le fondement du b) ne
peuvent empêcher un EM de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus
strictes. Cette limite ne concerne pas les mesures prises sur la base du a) ». Cette limite
pose problème avec les directives d’harmonisation totale.ces directives doivent être
transposées telles quelles. Si dans le droit français est plus protecteur, alors avec la
transposition d’une directive d’harmonisation totale, les dispositions protectrices du
droit français est de facto abrogé.
1
/
4
100%