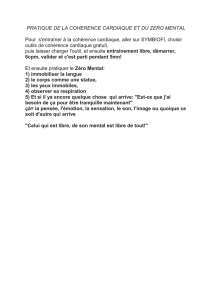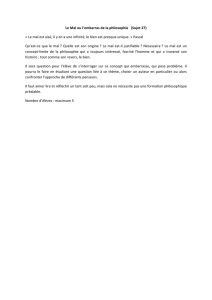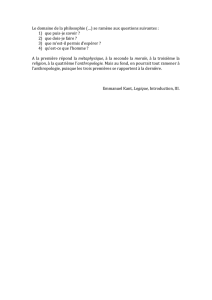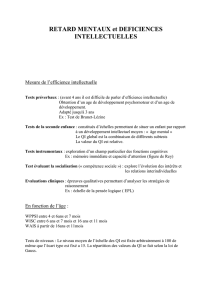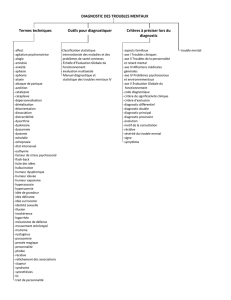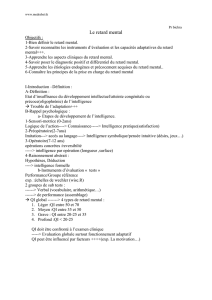le développement mental de l`enfant

Fondation Jean Piaget
Étude&parue&dans&Juventus(Helvetica&(Zürich)&1940
puis&reproduite&dans&Six(études(de(psychologie
(Paris:&Denoël=Gonthier,&1964)
La&pagination&du&présent&document
est&celle&des&Six(études.&
Version&électronique&réalisée&par&les&soins&de&la
Fondation&Jean&Piaget&pour&recherches
psychologiques&et&épistémologiques.
L!"#$%!&'((!)!*+")!*+,&"#!"&’!*-,*+
&."/01.2344.5.67"489:;<=>."=><"/0?>7."/@8"2A"6A<88A6:."
.7" 4B.6/"C<6" D" 2EFG." A/>27.".87" :354ABA?2."D" 2A":B3<88A6:."
3BGA6<=>." H" :355." :.77." /.B6<@B.I" <2" :368<87." .88.67<.22.J
5.67".6">6."5AB:;."1.B8"2E0=><2<?B.K"#."5L5.I".6".MM.7I"=>."
2." :3B48" .87" .6" 0132>7<36" N>8=>ED" >6" 6<1.A>" B.2A7<1.5.67"
87A?2.I" :ABA:70B<80"4AB"2EA:;@1.5.67"/."2A":B3<88A6:.".7"4AB"
2A"5A7>B<70"/.8"3BGA6.8I" /."5L5."2A"1<."5.67A2."4.>7"L7B."
:36O>." :355." 0132>A67" /A68" 2A" /<B.:7<36" /E>6." M3B5."
/E0=><2<?B."C<6A2."B.4B08.670."4AB"2E.84B<7"A/>27.K" &."/01.J
2344.5.67".87"/36:" .6">6"8.68">6."0=><2<?BA7<36"4B3GB.8J
8<1.I">6"4A88AG."4.B407>.2"/E>6"07A7"/."53<6/B."0=><2<?B."D"
>6" 07A7" /E0=><2<?B." 8>40B<.>BK" #>" 43<67" /."1>." /." 2E<67.22<J
G.6:.I" <2" .87" MA:<2." /E34438.B" A<68<" 2E<687A?<2<70" .7"2E<6:3;0J
B.6:."B.2A7<1.8"/.8"</0.8".6MA67<6.8"D"2A"898705A7<8A7<36"/."
2A" BA<836" A/>27.K" #A68" 2."/35A<6." /." 2A" 1<." AMM.:7<1.I" 36" A"
83>1.67"6370":35?<.6"2E0=><2<?B."/.8"8.67<5.678"A>G5.67."
A1.:"2EFG.K"&.8"BA443B78"83:<A>PI".6C<6I" 3?0<88.67"D"2A"5L5."
23<"/."87A?<2<8A7<36"GBA/>.22.K
Q6."/<MM0B.6:." .88.67<.22." .67B."2A" 1<." />":3B48" .7":.22."
/."2E.84B<7".87":.4.6/A67"D"83>2<G6.B"/@8"2."4B<6:<4.I"8<"2E36"
1.>7" B.84.:7.B" 2." /96A5<85." <6;0B.67" D" 2A" B0A2<70" 84<B<J
7>.22.K"&A"M3B5."C<6A2."/E0=><2<?B."A77.<67."4AB"2A":B3<88A6:."
3BGA6<=>.".87"42>8" 87A7<=>."=>.":.22."1.B8" 2A=>.22."7.6/"2."
/01.2344.5.67" 5.67A2I" .7" 8>B73>7" 42>8" <687A?2.I" /." 7.22."
83B7."=>.I" 8<7R7"7.B5<60."2E0132>7<36"A8:.6/A67.I" >6."013J
2>7<36" B0GB.88<1."/0?>7." A>735A7<=>.5.67I" =><" :36/><7"D"
2A"1<.<22.88.K"'BI":.B7A<6.8"M36:7<368"489:;<=>.8I"=><"/04.6J

/.67"07B3<7.5.67" /."2E07A7"/.8"3BGA6.8I"8><1.67">6.":3>B?."
A6A23G>." H" 2EA:><70" 1<8>.22.I" 4AB" .P.542.I" 4A88." 4AB" >6"
maximum"1.B8"2A"C<6"/."2E.6MA6:."43>B"/<5<6>.B".68><7.I".7"
42>8<.>B8" :354ABA<8368" 4.B:.47<1.8" 8367" B0G<.8" 4AB" :.77."
5L5."23<K",>":367BA<B.I"2.8"M36:7<368"8>40B<.>B.8"/."2E<67.2J
2<G.6:.".7"/."2EAMM.:7<1<70"7.6/.67"1.B8">6"S"0=><2<?B."53?<2."TI"
.7"/EA>7A67"42>8" 87A?2." =>E<2" .87" 42>8" 53?<2.I" /." 7.22." 83B7."
=>.I"43>B"2.8"F5.8"8A<6.8I"2A"C<6"/."2A":B3<88A6:."6."5AB=>."
6>22.5.67" 2." :355.6:.5.67" /."2A" /0:A/.6:.I" 5A<8" A>73J
B<8.">6"4B3GB@8"84<B<7>.2"=><"6EA"B<.6"/.":367BA/<:73<B."A1.:"
2E0=><2<?B."<670B<.>BK
UE.87" /36:" .6" 7.B5.8" /E0=><2<?B." =>."63>8" A22368" :;.BJ
:;.B"D"/0:B<B."2E0132>7<36"/."2E.6MA67".7"/."2EA/32.8:.67K" #."
:."43<67"/."1>.I"2."/01.2344.5.67"5.67A2".87">6.":3687B>:J
7<36" :367<6>.I" :354ABA?2." D" 2E0/<C<:A7<36" /E>6" 1A87." ?F7<J
5.67"=><I" 23B8"/.":;A=>."A/N36:7<36I" 8.BA<7" 42>8" 832</.I" 3>"
42>7R7"A>" 5367AG." /E>6" 50:A6<85."8>?7<2" /367"2.8" 4;A8.8"
GBA/>.22.8"/EAN>87.5.67"A?3>7<BA<.67"D">6."83>42.88.".7">6."
53?<2<70"/EA>7A67"42>8"GBA6/.8"/.8"4<@:.8"=>."2.>B"0=><2<?B."
/.1<.6/BA<7" 42>8" 87A?2.K" )A<8" A23B8I" <2" MA>7" <67B3/><B." >6."
/<87<6:7<36"<543B7A67.".67B."/.>P"A84.:78":354205.67A<B.8"
/.":."4B3:.88>8" /E0=><2<?BA7<36"H" <2" :361<.67" /E34438.B"/@8"
2EA?3B/" 2.8" 87B>:7>B.8" 1AB<A?2.8I" /0C<6<88A67" 2.8" M3B5.8" 3>"
07A78" 8>::.88<M8" /E0=><2<?B.I" .7" >6" :.B7A<6" M36:7<366.5.67"
:3687A67"A88>BA67"2."4A88AG."/."6E<543B7."=>.2"07A7"A>"6<1.A>"
8><1A67K
&3B8=>."2E36":354AB.I" .6".MM.7I"2E.6MA67"D"2EA/>27.I"7A67R7"
36".87"MBA440"4AB"2E</.67<70"/.8"B0A:7<368"V"36"4AB2."A23B8"
/E>6." S" 4.7<7." 4.B8366A2<70K" T" 43>B" /<B." =>." 2E.6MA67" 8A<7"
?<.6":."=>E<2"/08<B.".7"AG<7":355."63>8".6"M36:7<36"/E<670J
BL78"4B0:<8I" V"7A67R7"36"/0:3>1B.">6"536/."/."/<MM0B.6:.8"
V"/A68"2."N.>I"4AB".P.542.I" 3>"/A68"2A"5A6<@B."/."BA<836J
6.BI" .7" 2E36" /<7" A23B8" =>." S" 2E.6MA67" 6E.87" 4A8" >6" 4.7<7"
A/>27." TK" 'BI" 2.8"/.>P"<54B.88<368"8367" 1BA<.8I" 73>B"D" 73>BK"
#>"43<67"/."1>."M36:7<366.2I":E.87JDJ/<B.".6":368</0BA67"2.8
53?<2.8" G060BA>P" /." 2A" :36/><B." .7"/." 2A" 4.680.I" <2" .P<87."
/.8"M36:7<366.5.678":3687A678I":355>68"D"73>8"2.8"FG.8"H"
D"73>8"2.8"6<1.A>PI"2EA:7<36"8>4438."73>N3>B8">6"<670BL7"=><"
2A" /0:2.6:;." W"=>E<2" 8EAG<88."/E>6"?.83<6"4;98<323G<=>.I"
AMM.:7<MI" 3>"<67.22.:7>.2"X2."?.83<6"8."4B08.67.".6":."/.B6<.B"
73>8"2.8"6<1.A>PI"2E<67.22<G.6:.":;.B:;."D":354B.6/B."3>"D"
.P42<=>.BI" .7:KI" .7:K" Z.>2.5.67I" 8<" 2.8"M36:7<368" /."2E<670BL7I"
/." 2E.P42<:A7<36I" .7:KI" 8367" A<68<" :355>6.8" D"73>8"2.8" 87AJ
/.8I" :E.87JDJ/<B."S"<61AB<A67.8"T"D"7<7B."/."M36:7<368I" <2"6E.6"
.87" 4A8" 53<68" 1BA<" =>." S" 2.8" <670BL78" T" X4AB" 34438<7<36"D"
S"2E<670BL7"TY"1AB<.67":368</0BA?2.5.67"/E>6"6<1.A>"5.67A2"D"
>6"A>7B.I".7"=>."2.8".P42<:A7<368"4AB7<:>2<@B.8"X4AB"34438<7<36"
D"2A"M36:7<36"/E.P42<=>.BY"8367"/."M3B5.8" 7B@8"/<MM0B.67.8"
8.236" 2." /.GB0" /." /01.2344.5.67" <67.22.:7>.2K" ," :R70" /.8"
M36:7<368":3687A67.8I" <2" MA>7"/36:"/<87<6G>.B" 2.8" 87B>:7>B.8"
1AB<A?2.8" .7" :E.87" 4B0:<805.67" 2EA6A298." /." :.8" 87B>:7>B.8"
4B3GB.88<1.8I"3>"M3B5.8"8>::.88<1.8"/E0=><2<?B.I"=><"5AB=>."
2.8" /<MM0B.6:.8"3>"34438<7<368" /E>6" 6<1.A>"D" 2EA>7B." /."2A"
:36/><7.I"/.4><8"2.8":3543B7.5.678"0205.67A<B.8"/>"63>BJ
B<8836"N>8=>ED"2EA/32.8:.6:.K
&.8" 87B>:7>B.8" 1AB<A?2.8I" :." 8.B367" /36:" 2.8" M3B5.8"
/E3BGA6<8A7<36"/."2EA:7<1<70"5.67A2.I"83>8"836"/3>?2."A84.:7"
537.>B" 3>" <67.22.:7>.2I" /E>6." 4AB7I" .7"AMM.:7<MI" /EA>7B." 4AB7I"
A<68<"=>."8.236"8.8"/.>P"/<5.68<368"<6/<1</>.22.".7"83:<A2."
X<67.B<6/<1</>.22.YK" *3>8" /<87<6G>.B368I" 43>B" 42>8" /."
:2AB70I" 8<P" 87A/.8" 3>" 40B<3/.8" /." /01.2344.5.67I" =><"
5AB=>.67" 2EA44AB<7<36" /." :.8" 87B>:7>B.8" 8>::.88<1.5.67"
:3687B><7.8"H"[\"&."87A/."/.8"B0C2.P.8I" 3>"5367AG.8";0B0/<J
7A<B.8I"A<68<"=>."/.8"4B.5<@B.8"7.6/A6:.8"<687<6:7<1.8"X6>7B<J
7<368Y".7"/.8"4B.5<@B.8"0537<368K"]\"&."87A/."/.8"4B.5<@B.8"
;A?<7>/.8" 537B<:.8" .7" /.8" 4B.5<@B.8" 4.B:.47<368" 3BGA6<J
80.8I" A<68<" =>."/.8"4B.5<.B8"8.67<5.678"/<MM0B.6:<08K" ^\"&."
87A/." /." 2E<67.22<G.6:." 8.683B<J537B<:." 3>" 4BA7<=>." XA670J
B<.>B."A>"2A6GAG.YI"/.8"B0G>2A7<368"AMM.:7<1.8"0205.67A<B.8
10& JEAN&PIAGET&LE&DÉVELOPPEMENT&MENTAL&CHEZ&L’ENFANT&11

.7" /.8" 4B.5<@B.8" C<PA7<368" .P70B<.>B.8" /." 2EAMM.:7<1<70K" U.8"
4B.5<.B8"87A/.8":3687<7>.67"D".>P"7B3<8"2A"40B<3/."/>"63>BJ
B<8836"XN>8=>." 1.B8" >6" A6".7" /.5<" D"/.>P"A68I" :E.87JDJ/<B."
A670B<.>B.5.67" A>P" /01.2344.5.678" />" 2A6GAG." .7" /." 2A"
4.680."4B34B.5.67"/<7.YK"_\"&."87A/."/."2E<67.22<G.6:."<67><J
7<1.I" /.8"8.67<5.678" <67.B<6/<1</>.28"84367A608" .7"/.8"BA4J
43B78"83:<A>P"/."83>5<88<36"D"2EA/>27."X/."/.>P"D"8.47"A68I"
3>"8.:36/."4AB7<."/."2A"S"4.7<7.".6MA6:."TYK"`\"&."87A/."/.8"
340BA7<368"<67.22.:7>.22.8":36:[email protected]"X/0?>7"/."2A"23G<=>.YI".7"
/.8"8.67<5.678"53BA>P".7"83:<A>P"/.":3340BA7<36"X/."8.47"D"
36a.J/3>a."A68YK"b\"&."87A/."/.8"340BA7<368"<67.22.:7>.22.8"
A?87BA<7.8I" /."2A"M3B5A7<36"/."2A"4.B8366A2<70".7"/."2E<68.BJ
7<36" AMM.:7<1." .7" <67.22.:7>.22." /A68" 2A" 83:<070" /.8" A/>27.8"
XA/32.8:.6:.YK
U;A:>6"/.":.8"87A/.8".87"/36:":ABA:70B<80"4AB"2EA44AB<7<36"
/." 87B>:7>B.8" 3B<G<6A2.8I" /367" 2A":3687B>:7<36" 2."/<87<6G>."
/.8" 87A/.8" A670B<.>B8K" &E.88.67<.2" /." :.8" :3687B>:7<368"
8>::.88<1.8" 8>?8<87."A>":3>B8"/.8"87A/.8">270B<.>B8I" D"7<7B."
/."8>?87B>:7>B.8I"8>B"2.8=>.22.8"1<.66.67"8E0/<C<.B"2.8":ABA:J
87A/.8" 4A8808" :3BB.8436/"D" >6" 6<1.A>" 42>8" 3>"53<68" 020J
5.67A<B." 3>"02.10" /." 2A" ;<0BAB:;<." /.8" :36/><7.8K" )A<8" D"
:;A=>."87A/." :3BB.8436/.67"A>88<" /.8" :ABA:7@B.8" 535.6J
7A608" .7" 8.:36/A<B.8I" =><" 8367" 53/<C<08" 4AB" 2." /01.2344.J
5.67">270B<.>BI".6"M36:7<36"/.8"?.83<68"/E>6."3BGA6<8A7<36"
5.<22.>B.K" U;A=>." 87A/.":3687<7>." /36:I" 4AB" 2.8"87B>:7>B.8"
=><" 2." /0C<6<88.67I" >6." M3B5." 4AB7<:>2<@B." /E0=><2<?B.I" .7"
2E0132>7<36"5.67A2."8E.MM.:7>."/A68"2."8.68"/E>6."0=><2<?BAJ
7<36"73>N3>B8"42>8"43>880.K
*3>8" 43>1368" A23B8" :354B.6/B.":."=>." 8367"2.8" 50:AJ
6<85.8" M36:7<366.28" :355>68" D" 73>8" 2.8" 87A/.8K" '6" 4.>7"
/<B.I" /E>6." 5A6<@B." A?832>5.67" G060BA2." X636" 8.>2.5.67"
.6":354ABA67" :;A=>." 87A/." A>"8><1A67I" 5A<8" :;A=>." :36J
/><7.I" D" 2E<670B<.>B" /." 6E<543B7." =>.2" 87A/.I" D" 2A" :36/><7."
8><1A67.Y"=>."73>7."A:7<36"V":E.87JDJ/<B."73>7"53>1.5.67I
73>7." 4.680." 3>" 73>7" 8.67<5.67" V" B0436/" D" >6" ?.83<6K"
&E.6MA67I" 4A8" 42>8" =>. " 2EA/>27.I" 6E.P0:>7. " A>:>6 " A:7.I" .P70J
B<.>B"3>"5L5.".67<@B.5.67"<670B<.>BI" =>."5d"4AB">6"53J
?<2.I" .7" :." 53?<2." 8."7BA/><7" 73>N3>B8" 83>8" 2A" M3B5." /E>6"
?.83<6"X>6"?.83<6"0205.67A<B."3>">6"<670BL7I">6."=>.87<36I"
.7:KYK" 'BI" :355."2EA"?<.6"5367B0"U2A4AB@/.I">6"?.83<6".87"
73>N3>B8" 2A"5A6<M.87A7<36"/E>6"/080=><2<?B."H"<2" 9" A"?.83<6"
23B8=>." =>.2=>." :;38.I" .6" /.;3B8" /." 63>8" 3>" .6" 63>8"
X/A68"637B."3BGA6<85."4;98<=>."3>"5.67A2YI"8E.87"53/<M<0I"
.7" =>E<2" 8EAG<7" /." B0AN>87.B" 2A" :36/><7." .6" M36:7<36" /." :."
:;A6G.5.67K"(AB".P.542.I" 2A"MA<5"3>"2A"MA7<G>."4B313=>.J
B367"2A"B.:;.B:;."/."2A"63>BB<7>B."3>"/>"B.438"W"2A"B.6:36J
7B." /E3?N.7" .P70B<.>B" /0:2.6:;.BA" 2." ?.83<6" /." N3>.BI" 836"
>7<2<8A7<36"D"/.8"M<68"4BA7<=>.8I" 3>"8>8:<7.BA">6."=>.87<36I"
>6" 4B3?2@5."7;03B<=>." W" >6." 4AB32." /EA>7B><" .P:<7.BA" 2."
?.83<6"/E<5<7.BI" /."8954A7;<8.B"3>".6G.6/B.BA" 2A"B08.B1."
.7"2E34438<7<36"4AB:."=>E.67BA67".6":36M2<7"A1.:"7.22."/."638"
7.6/A6:.8K" c61.B8.5.67" 2EA:7<36"8." 7.B5<6."/@8" =>E<2" 9" A"
8A7<8MA:7<36" /.8" ?.83<68I" :E.87JDJ/<B." 23B8=>." 2E0=><2<?B."
.87"B07A?2<".67B."2."MA<7"63>1.A>I"=><"A"/0:2.6:;0"2."?.83<6I"
.7" 637B." 3BGA6<8A7<36" 5.67A2." 7.22." =>E.22." 8." 4B08.67A<7"
A670B<.>B.5.67"D"2><K")A6G.B"3>"/3B5<BI"N3>.B"3>"4AB1.6<B"
D"8.8"M<68I"B0436/B."D"2A"=>.87<36"3>"B083>/B."2."4B3?2@5.I"
B0>88<B" 836" <5<7A7<36I" 07A?2<B" >6" 2<.6" AMM.:7<MI" 5A<67.6<B"
836"43<67"/."1>.I" 8367" A>7A67" /." 8A7<8MA:7<368" =><I" /A68"
2.8" .P.542.8"4B0:0/.678I" 5.77B367">6"7.B5." D"2A":36/><7."
4AB7<:>2<@B."8>8:<70."4AB"2."?.83<6K",":;A=>."<687A67I"43>BBA<7J"
36" /<B."A<68<I" 2EA:7<36" .87" /080=><2<?B0."4AB"2.8" 7BA68M3BJ
5A7<368"=><" 8>BG<88.67"/A68"2."536/.I".P70B<.>B" 3>"<670J
B<.>BI".7":;A=>.":36/><7."63>1.22.":368<87."636"8.>2.5.67"
D"B07A?2<B"2E0=><2<?B.I"5A<8".6:3B."D"7.6/B."1.B8">6"0=><2<J
?B."42>8"87A?2."=>.":.2><"/."2E07A7"A670B<.>B"D":.77."4.B7>BJ
?A7<36K
UE.87".6":."50:A6<85.":367<6>".7"4.B407>.2" /."B0AN>8J
7.5.67"3>"/E0=><2<?BA7<36"=>.":368<87."2EA:7<36";>5A<6.I".7
12& JEAN&PIAGET&LE&DÉVELOPPEMENT&MENTAL&CHEZ&L’ENFANT&13

:E.87" 43>B=>3<I" .6" 8.8" 4;A8.8" /." :3687B>:7<36" <6<7<A2.I" 36"
4.>7" :368</0B.B" 2.8" 87B>:7>B.8" 5.67A2.8" 8>::.88<1.8"
=>E.6G.6/B." 2." /01.2344.5.67" :355." A>7A67" /." M3B5.8"
/E0=><2<?B."/367":;A:>6.".87".6"4B3GB@8"8>B"2.8"4B0:0/.67.8K"
)A<8"<2"MA>7"?<.6":354B.6/B."A>88<"=>.":."50:A6<85."M36:J
7<366.2I" 8<" G060BA2" 83<7J<2I" 6E.P42<=>." 4A8" 2." :367.6>" 3>" 2A"
87B>:7>B." /.8" /<MM0B.678" ?.83<68I" 4><8=>." :;A:>6" /E.67B."
.>P" .87" B.2A7<M" D" 2E3BGA6<8A7<36" />" 6<1.A>" :368</0B0K" (AB"
.P.542.I" 2A" 1>." /E>6" 5L5." 3?N.7" /0:2.6:;.BA"/.8" =>.8J
7<368"M3B7"/<MM0B.67.8":;.a">6"4.7<7".6MA67I" =><".87".6:3B."
<6:A4A?2."/.":2A88<C<:A7<36I" .7":;.a" >6"GBA6/"/367"2.8"</0.8"
8367"42>8"07.6/>.8".7"42>8"898705A7<=>.8K"&.8"<670BL78"/E>6"
.6MA67" /04.6/.67" /36:" D" :;A=>."<687A67" /." 2E.68.5?2."/."
8.8"637<368"A:=><8.8".7"/."8.8"/<8438<7<368"AMM.:7<1.8I"4><8J
=>E<28" 7.6/.67" D" 2.8" :354207.B" /A68" 2."8.68" /E>6" 0=><2<?B."
5.<22.>BK
,1A67" /E.PA5<6.B" 2." /07A<2" />" /01.2344.5.67I" <2" MA>7"
/36:"63>8"?3B6.B"D"/0GAG.B"2A"M3B5."G060BA2."/.8"?.83<68"
.7" <670BL78" :355>68" D" 73>8" 2.8" FG.8K" '6"4.>7" /<B.I" D" :.7"
0GAB/I"=>."73>7"?.83<6"7.6/"[\"D"<6:3B43B.B"2.8":;38.8".7"2.8"
4.B8366.8"D"2EA:7<1<70"4B34B."/>"8>N.7I" /36:"D"S"A88<5<2.B"T"
2."536/.".P70B<.>B"A>P"87B>:7>B.8"/0ND":3687B><7.8I" .7"]\"D"
B0AN>87.B":.22.8J:<" .6" M36:7<36"/.8" 7BA68M3B5A7<368" 8>?<.8I"
/36:" D" 2.8" S" A::3553/.B" T" A>P" 3?N.78" .P7.B6.8K" #." :."
43<67"/."1>.I" 73>7."2A"1<."5.67A2.I":355."/EA<22.>B8" 2A"1<."
3BGA6<=>." .22.J5L5.I" 7.6/" D" A88<5<2.B" 4B3GB.88<1.5.67"
2."5<2<.>"A5?<A67I".7".22."B0A2<8.":.77."<6:3B43BA7<36"GBF:."
D" /.8" 87B>:7>B.8I" 3>" 3BGA6.8" 489:;<=>.8I" /367" 2." BA936"
/EA:7<36".87" /." 42>8" .6"42>8" 07.6/>" H" 2A"4.B:.47<36".7" 2.8"
53>1.5.678" 0205.67A<B.8" X4B0;.68<36I" .7:KY" /366.67"
/EA?3B/"4B<8."8>B"2.8"3?N.78"4B3:;.8".7"/A68"2.>B"07A7"535.6J
7A60I"4><8"2A"5053<B.".7"2E<67.22<G.6:."4BA7<=>.8"4.B5.77.67"
D"2A"M3<8"/."B.:3687<7>.B"2.>B"07A7"<550/<A7.5.67"A670B<.>B"
.7"/EA67<:<4.B"2.>B8" 7BA68M3B5A7<368"4B3:;A<6.8K" &A"4.680."
<67><7<1."B.6M3B:.".68><7.":.8"/.>P"43>13<B8K"&E<67.22<G.6:.
/0/>:7<36" A?87BA<7." 7.B5<6." :.77."0132>7<36".6" B.6/A67" 2."
8>N.7"5Ae7B."/.8"0106.5.678"2.8"42>8"23<67A<68I"/A68"2E.84A:."
.7"/A68"2."7.548K" ," :;A:>6"/.":.8"6<1.A>PI" 2E.84B<7"B.542<7"
/36:"2A"5L5."M36:7<36I" =><".87"/E<6:3B43B.B"2E>6<1.B8"D"2><I"
5A<8" 2A" 87B>:7>B." /." 2EA88<5<2A7<36" 1AB<.I" :E.87JDJ/<B." 2.8"
M3B5.8" /E<6:3B43BA7<36"8>::.88<1.8" /." 2A" 4.B:.47<36".7" />"
53>1.5.67"N>8=>EA>P"340BA7<368"8>40B<.>B.8K
'BI" .6" A88<5<2A67" A<68<" 2.8" 3?N.78I" 2EA:7<36" .7" 2A" 4.680."
8367" :367BA<67.8"/."8EA::3553/.B"D".>PI" :E.87JDJ/<B."/."8."
B0AN>87.B"23B8"/.":;A=>."1AB<A7<36".P70B<.>B.K"'6"4.>7"A44.J
2.B"S"A/A47A7<36"T"2E0=><2<?B."/.":.8"A88<5<2A7<368".7"A::35J
53/A7<368" H"7.22.".87" 2A" M3B5." G060BA2."/." 2E0=><2<?B."489J
:;<=>.".7"2."/01.2344.5.67"5.67A2"A44ABAe7"/36:"8A68"42>8I"
.6" 836" 3BGA6<8A7<36" 4B3GB.88<1.I" :355." >6." A/A47A7<36"
73>N3>B8"42>8"4B0:<8."D"2A"B0A2<70K"U."8367"2.8"07A4.8"/.":.77."
5.67K
I.&LE&NOUVEAU=NÉ&ET&LE&NOURRISSON
&A"40B<3/."=><"8E07.6/".67B."2A"6A<88A6:.".7"2EA:=><8<7<36"
/>" 2A6GAG." .87" 5AB=>0." 4AB" >6" /01.2344.5.67" 5.67A2"
.P7BA3B/<6A<B.K"'6".6"83>4O366."83>1.67"5A2"2E<543B7A6:.I"
4><8=>E<2" 6." 8EA::354AG6." 4A8" /." 4AB32.8" 4.B5.77A67" /."
8><1B." 4A8" D" 4A8" 2." 4B3GB@8" /." 2E<67.22<G.6:." .7" /.8" 8.67<J
5.678I" :355.":."8.BA"2.":A8"42>8"7AB/K" c2"6E.6".87"=>."42>8"
/0:<8<M" 43>B" 73>7." 2A"8><7."/." 2E0132>7<36" 489:;<=>." H" <2" 6."
:368<87." 4A8" 53<68I" .6".MM.7I" =>E.6" >6." :36=>L7.I" 4AB" 2.8"
4.B:.47<368" .7" 2.8" 53>1.5.678I" /."73>7" 2E>6<1.B8" 4BA7<=>."
.673>BA67" 2." 4.7<7" .6MA67K" 'BI" :.77." S" A88<5<2A7<36"8.683B<J
537B<:." T" />"536/." .P70B<.>B" <550/<A7" B0A2<8." .6" MA<7I"
.6"/<PJ;><7"53<8"3>"/.>P"A68I"73>7.">6."B0132>7<36":34.BJ
6<:<.66.".6"4.7<7"H"7A6/<8"=>EA>"43<67"/."/04AB7"/.":."/01.J
14& JEAN&PIAGET&LE&DÉVELOPPEMENT&MENTAL&CHEZ&L’ENFANT&15

2344.5.67I"2."63>1.A>J60"BA5@6."73>7"D"2><I"3>I"42>8"4B0:<J
805.67I" D"836"4B34B.":3B48I"A>"43<67"/EABB<10.I" :E.87JDJ/<B."
23B8=>."/0?>7.67"2."2A6GAG.".7"2A"4.680.I"<2"8."8<7>."/0ND"4BA7<J
=>.5.67I"D"7<7B."/E0205.67"3>"/.":3B48"4AB5<"2.8"A>7B.8I"/A68"
>6">6<1.B8"=>E<2"A":3687B><7"4.>"D"4.>".7"=>E<2"8.67"/083B5A<8"
:355.".P70B<.>B"D"2><K
*3>8"A22368"/0:B<B."4A8"D"4A8"2.8"07A4.8"/.":.77."B0132>J
7<36":34.B6<:<.66.I"83>8" 836"/3>?2."A84.:7"/E<67.22<G.6:."
.7" /." 1<." AMM.:7<1." 6A<88A67.8K" #>" 4B.5<.B" /." :.8" /.>P"
43<678" /." 1>." 36" 4.>7I" :355." 63>8" 2EA1368" /0ND" 1>"42>8"
;A>7I" /<87<6G>.B"7B3<8"87A/.8".67B."2A"6A<88A6:.".7"2A"C<6"/."
:.77."40B<3/."H":.2><"/.8"B0C2.P.8I":.2><"/."2E3BGA6<8A7<36"/.8"
4.B:.47<368" .7" ;A?<7>/.8" .7":.2><" /."2E<67.22<G.6:."8.683B<J
537B<:.".22.J5L5.K
," 2A" 6A<88A6:.I" 2A" 1<." 5.67A2." 8." B0/><7" D" 2E.P.B:<:."
/EA44AB.<28" B0M2.P.8I" :E.87JDJ/<B." /." :33B/<6A7<368" 8.683J
B<.22.8" .7" 537B<:.8" 73>7.8" 53670.8" ;0B0/<7A<B.5.67" .7"
:3BB.8436/A67" D" /.8" 7.6/A6:.8" <687<6:7<1.8" 7.22." =>." 2A"
6>7B<7<36K"f3B6368J63>8I"D":.7"0GAB/I"D"637.B"=>.":.8"B0M2.P.8I"
43>B"A>7A67"=>E<28"<670B.88.67"/.8":36/><7.8"=><"N3>.B367">6"
BR2."/A68"2."/01.2344.5.67"489:;<=>.">270B<.>BI" 6E367"B<.6"
/." :.77." 4A88<1<70"50:A6<=>." =>."2E36"8.BA<7" 43B70" D" 2.>B"
A77B<?>.BI" 5A<8" 5A6<M.87.67" /@8" 2.8" /0?>78" >6." A:7<1<70"
10B<7A?2."=><"A77.87."4B0:<805.67"2E.P<87.6:."/E>6."A88<5<J
2A7<36" 8.683B<J537B<:." 4B0:3:.K" #EA?3B/" 2.8" B0C2.P.8" /." 2A"
8>::<36" 8EAMC<6.67" D" 2E.P.B:<:." H" >6"63>1.A>J60"7@7." 5<.>P"
A4B@8">6."3>"/.>P"8.5A<6.8"=>."2.8"4B.5<.B8"N3>B8K"!68><7.I"
<28" :36/><8.67"D" /.8"/<8:B<5<6A7<368"3>"B0:3G6<7<368"4BA7<J
=>.8" MA:<2.8" D" /0:.2.BK" !6C<6" .7" 8>B73>7I" <28" /366.67" 2<.>" D"
>6."83B7."/."G060BA2<8A7<36"/."2.>B"A:7<1<70"H"2."63>BB<8836"
6."8.":367.67." 4A8" /." 8>:.B" =>A6/" <2" [email protected]" <2" 8>:." A>88<" D"
1</.I"<2"8>:."8.8"/3<G78"=>A6/"<2"2.8"B.6:367B.I"4><8"6E<543B7."
=>.2" 3?N.7" 4B08.670"M3B7><7.5.67I" .7" .6M<6"<2" :33B/366."
2." 53>1.5.67" /."8.8"?BA8" A1.:"2A"8>::<36"N>8=>ED"A5.6.B"
898705A7<=>.5.67I"4ABM3<8"/@8"2."8.:36/"53<8I"836"43>:.
/A68"8A"?3>:;.K"fB.MI"<2"A88<5<2.">6."4AB7<."/."836">6<1.B8"D"
2A"8>::<36I"A>"43<67"=>."2E36"43>BBA<7".P4B<5.B"836":3543BJ
7.5.67"<6<7<A2".6"/<8A67"=>."43>B"2><I"2."536/.".87".88.67<.2J
2.5.67" >6."B0A2<70" D" 8>:.BK" c2" .87" 1BA<" =>.I" BA4</.5.67I" 2."
5L5." >6<1.B8" /.1<.6/BA" A>88<" >6." B0A2<70" D" B.GAB/.BI" D"
0:3>7.B".7I"23B8=>."2.8"53>1.5.678"4B34B.8"2."2><"4.B5.7J
7B367I"D"8.:3>.BK
)A<8":.8"/<1.B8".P.B:<:.8" B0C2.P.8I" =><"8367":355."2EA6J
636:."/." 2EA88<5<2A7<36" 5.67A2.I" 1367" BA4</.5.67" 8.":35J
42<=>.B" 4AB" <670GBA7<36"/A68" /.8" ;A?<7>/.8" .7" /.8" 4.B:.4J
7<368"3BGA6<80.8I":E.87JDJ/<B."=>E<28"8367"A>"43<67"/."/04AB7"
/."63>1.22.8":36/><7.8I"A:=><8.8"A1.:"2EA</."/."2E.P40B<.6:.K"
&A"8>::<36"898705A7<=>."/>"43>:."A44AB7<.67"/0ND"D":."8.J
:36/"87A/.I"/."5L5."=>."2.8"G.87.8"/."73>B6.B"2A"7L7."/A68"
2A"/<B.:7<36"/E>6"?B><7I"3>"/."8><1B.">6"3?N.7".6"53>1.5.67I"
.7:K" #>"43<67"/."1>."4.B:.47<M"36":3687A7.I"/@8"=>."2E.6MA67"
8."5.7" D"83>B<B."X:<6=><@5." 8.5A<6." .7"A>" /.2DYI" =>E<2" B.J
:366Ae7" :.B7A<6.8" 4.B8366.8" 4AB" 34438<7<36" D" /EA>7B.8I"
.7:K"X5A<8"GAB/368J63>8"/."2><"4BL7.B"43>B"A>7A67"2A"637<36"
/." 4.B8366." 3>" 5L5." /E3?N.7" H" :." 8367" /.8" A44AB<7<368"
8.68<?2.8".7"A6<50.8"=>E<2"B.:366Ae7"A<68<".7":.2A"6."4B3>1."
.6:3B."B<.6"=>A67"D"2.>B"8>?87A67<A2<70I"6<"=>A67"D"2A"/<883J
:<A7<36"/>"53<".7"/."2E>6<1.B8".P70B<.>BYK" !67B."7B3<8" .7"8<P"
53<8"X3B/<6A<B.5.67" 1.B8" =>A7B."53<8".7"/.5<Y" 2." 63>BJ
B<8836":355.6:." D"8A<8<B":." =>E<2"13<7".7":.77.":A4A:<70"/."
4B0;.68<36" 4><8" /." 5A6<4>2A7<36" /0:>42." 836" 43>13<B" /."
M3B5.B"/.8";A?<7>/.8"63>1.22.8K
'BI" :355.67" 8." :3687B><8.67" :.8" .68.5?2.8" 537.>B8"
X;A?<7>/.8Y" 63>1.A>PI" .7" :.8" .68.5?2.8" 4.B:.47<M8" XA>"
/0?>7"2.8"/.>P"83B7.8"/."[email protected]"6."M367"=>E>6"H"36"4.>7"
4AB2.B"D"2.>B"8>N.7"/."S"8:;@5.8"8.683B<J537.>B8"TY"g" Q6"
:9:2."B0M2.P.".87"73>N3>B8"D"2.>B" 43<67"/."/04AB7I" 5A<8" >6"
:9:2."/367"2E.P.B:<:.I" A>"2<.>" /." 8." B0407.B"8A68"42>8I" 8E<6J
:3B43B."/." 63>1.A>P"0205.678" .7":3687<7>."A1.:" .>P" /.8"
737A2<708"3BGA6<80.8"42>8"2ABG.8I"4AB"/<MM0B.6:<A7<368"4B3J
16& JEAN&PIAGET&LE&DÉVELOPPEMENT&MENTAL&CHEZ&L’ENFANT&17
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%