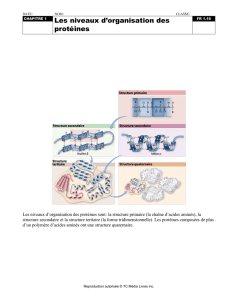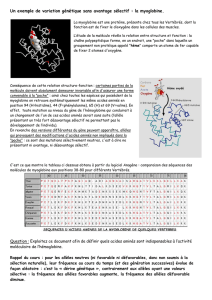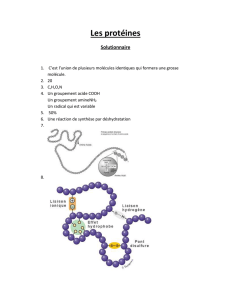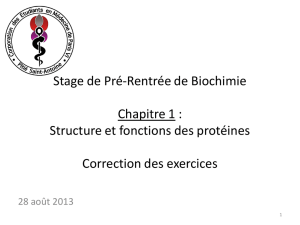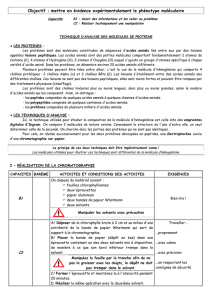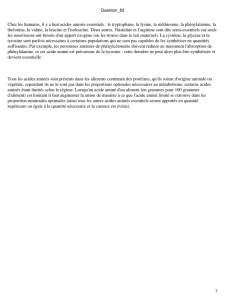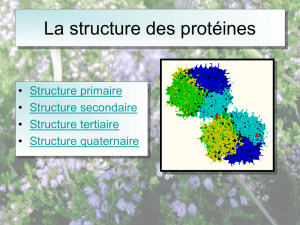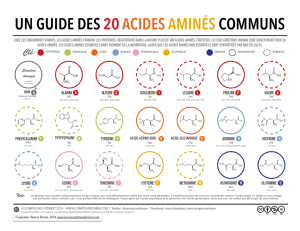Acides Aminés et Protéines : Structure, Fonction et Propriétés Biochimiques
Telechargé par
kahina.1hdd

I. Les acides aminés, des entités aux propriétés ionisables
1. Notions des pKa
Les acides aminés sont des molécules amphotères capables de se comporter
comme un acide ou une base en fonction du pH.
Chaque acide aminé possède des groupes ionisables :
o Le groupe carboxyle (-COOH), acide, avec un pKa autour de 2-3.
o Le groupe amine (-NH3+), basique, avec un pKa autour de 9-10.
o Certains acides aminés possèdent des chaînes latérales ionisables,
comme l'acide glutamique ou l'histidine. Par exemple :
Acide glutamique : pKa de la chaîne latérale ≈ 4,1.
Histidine : pKa ≈ 6,0, ce qui la rend active à des pH
physiologiques.
2. Courbe de titration
Une courbe de titration représente l'évolution de la charge nette de l'acide
aminé en fonction du pH.
Points clés :
o Zones tampon : autour des pKa, la courbe est plate, indiquant une
forte résistance au changement de pH.
o Points équivalents : lorsque le groupe carboxyle et le groupe amine
changent de forme ionique. Exemple pour la glycine :
1er plateau : H3N+-CH2-COOH → H3N+-CH2-COO- (pH ≈ 2-3).
2ème plateau : H3N+-CH2-COO- → H2N-CH2-COO- (pH ≈ 9-
10).
3. Point isoélectrique (pI ou pHI)
Le point isoélectrique correspond au pH où l'acide aminé a une charge nette
nulle.
Calcul du pI :
o
o Pour un acide aminé avec une chaîne latérale ionisable, il faut prendre
les deux pKa entourant la neutralité.

II. Les 21ème et 22ème acides aminés standards
1. La Sélénocystéine (Sec, U)
La sélénocystéine est souvent appelée le 21ème acide aminé.
Elle est codée par un codon stop (UGA) lorsqu'un signal spécifique est
présent dans l'ARN messager.
Rôle clé :
o Présente dans des enzymes comme la glutathion peroxydase,
impliquée dans la réduction des peroxydes et la lutte contre le stress
oxydatif.
o Son atome de sélénium est plus réactif que le soufre de la cystéine.
2. La Pyrrolysine (Pyl, O)
La pyrrolysine est le 22ème acide aminé, présente chez certains archaea et
bactéries.
Codée par le codon stop UAG, mais uniquement dans des conditions
spécifiques.
Exemple d'utilisation : enzymes méthanogènes impliquées dans le
métabolisme du méthane.
III. Autres acides aminés non protéinogènes
1. Les AA non constitutifs des protéines
Exemples :
o Ornithine et citrulline : intermédiaires dans le cycle de l'urée.
o GABA (acide γ-aminobutyrique) : neurotransmetteur inhibiteur dans
le système nerveux central.
o Dopa : précurseur de la dopamine.
2. Les AA précurseurs des acides biogènes
Certains acides aminés sont transformés en molécules actives :
o Tryptophane → Sérotonine : neurotransmetteur impliqué dans la
régulation de l'humeur.
o Tyrosine → Adrénaline : hormone du stress et de l'activation.

IV. Structure des protéines
1. Généralités
Les protéines sont des polymères d'acides aminés liés par des liaisons
peptidiques.
Les protéines jouent des rôles variés : enzymes, transporteurs, récepteurs,
etc.
Leur fonction dépend de leur structure tridimensionnelle.
2. Liaisons peptidiques
La liaison peptidique est une liaison covalente formée par une réaction de
condensation entre le groupe carboxyle d’un acide aminé et le groupe amine
d’un autre.
Caractéristiques :
o Plan rigide en raison de la résonance, conférant un caractère partiel de
double liaison.
o Les angles φ et ψ définissent la rotation autour des liaisons.
2.1 Caractéristiques de la liaison peptidique
Longueur moyenne de 1,33 Å.
Les groupes NH et CO sont polaires, favorisant les liaisons hydrogène.
2.2 Diagramme de Ramachandran
Permet de visualiser les combinaisons d’angles φ et ψ possibles pour une
chaîne polypeptidique.
Zones autorisées :
o Hélices α : angles spécifiques permettant des structures en spirale.
o Feuillets β : angles caractéristiques des structures étendues.
V. Les 4 niveaux architecturaux des protéines
1. Structure primaire
Définition : séquence linéaire d’acides aminés dans une chaîne
polypeptidique, liée par des liaisons peptidiques.
Elle est codée par l’ADN et transcrite en ARN messager.
Importance :

o Détermine directement les niveaux structuraux supérieurs.
o Les mutations dans la séquence peuvent altérer la fonction protéique.
Exemple : l’anémie falciforme, causée par une mutation dans
l’hémoglobine (Glu → Val en position 6).
2. Structure secondaire
Organisation locale régulière de la chaîne polypeptidique stabilisée par des
liaisons hydrogène entre les groupes CO et NH du squelette peptidique.
Les principaux types :
o Hélices α :
Structure en spirale stabilisée par des liaisons hydrogène intra-
chaîne entre un CO d’un résidu et un NH situé quatre résidus
plus loin.
Pas de l’hélice : 5,4 Å, avec 3,6 acides aminés par tour.
Acides aminés préférés : alanine, glutamate. Proline et glycine
sont souvent exclues.
o Feuillets β :
Formés par l’interaction de deux ou plusieurs segments
polypeptidiques adjacents, appelés brins β.
Les brins peuvent être parallèles ou antiparallèles, selon
l’orientation des chaînes polypeptidiques.
Les feuillets β sont stabilisés par des liaisons hydrogène inter-
chaînes.
3. Structure tertiaire
Organisation tridimensionnelle globale d’une chaîne polypeptidique, résultant
de l’interaction entre les chaînes latérales des acides aminés.
Forces impliquées :
o Liaisons hydrogène : entre chaînes latérales polaires ou avec l’eau
environnante.
o Interactions hydrophobes : entre résidus non polaires qui se
regroupent au centre de la protéine.
o Ponts disulfures : liaison covalente formée entre deux cystéines (S-S).
o Interactions ioniques : entre résidus chargés positivement (Lys, Arg)
et négativement (Glu, Asp).

Importance : cette structure confère la fonction spécifique de la protéine
(exemple : site actif des enzymes).
4. Structure quaternaire
Association de plusieurs chaînes polypeptidiques (sous-unités) en un
complexe fonctionnel.
Stabilisation : par les mêmes interactions que la structure tertiaire.
Exemples :
o Hémoglobine : tétramère composé de deux sous-unités α et deux
sous-unités β.
o Immunoglobulines : formées de chaînes lourdes et légères associées
par des ponts disulfures.
Je vais reprendre depuis le début en suivant précisément le plan donné dans votre
cours tout en le développant au maximum avec des détails supplémentaires. Voici la
structure revue et augmentée :
I. Les protéines, 4 niveaux d’architecture
1. La structure quaternaire
1.1. Les protéines globulaires à structure quaternaire
Les protéines globulaires à structure quaternaire sont constituées de plusieurs
chaînes polypeptidiques appelées sous-unités. Ces sous-unités peuvent être
identiques (homomultimères) ou différentes (hétéromultimères).
Les interactions qui stabilisent la structure quaternaire incluent :
Liaisons hydrogène entre chaînes.
Interactions hydrophobes entre régions non polaires des sous-unités.
Liaisons ioniques ou ponts salins entre les groupes chargés.
Ponts disulfures dans certains cas spécifiques.
Un exemple typique est l’hémoglobine, une protéine tétramérique composée de
deux sous-unités α et deux sous-unités β. Cette organisation permet un mécanisme
coopératif essentiel pour le transport de l’oxygène dans le sang. Lorsque l’oxygène
se lie à une sous-unité, cela augmente l’affinité des autres sous-unités pour
l’oxygène, facilitant son transport efficace.
1.2. Les protéines fibreuses à structure quaternaire : exemple des collagènes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%