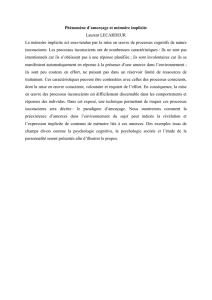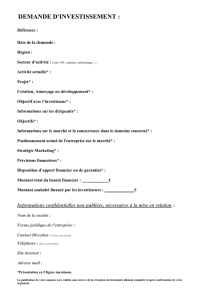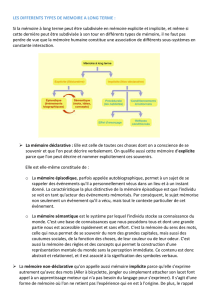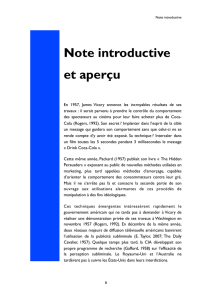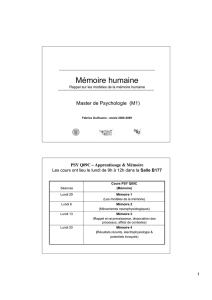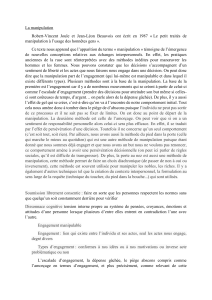Mémoire Implicite et Explicite en Psychologie Cognitive - UE PY0N401T
Telechargé par
juliedrouaine

1
UE PY0N401T
Psychologie cognitive
Responsables Elodie LABEYE & Rui DA SILVA NEVES
Année Universitaire 2021-2022

2
Chapitre 3 – Mémoire implicite, mémoire explicite
Dr. Elodie Labeye

3
Distinction entre mémoire implicite et mémoire
explicite
Serge Nicolas, Professeur de psychologie à l'Université Paris Descartes, nous
explique d’où vient la distinction entre mémoire implicite et explicite : « Graf et Schacter
proposent en 1985 [cette] distinction |…]. Pour eux, « La mémoire implicite transparait
lorsque la performance à une tâche est facilitée en l’absence de souvenir conscient de
l’influence d’un évènement antérieur investigateur, alors que la mémoire explicite exige le
souvenir conscient des évènements préalables » (Nicolas, 1994, p65).
Les tâches expérimentales faisant intervenir la mémoire explicite sont des tâches
classiques de rappel libre, de rappel indicé, ou de reconnaissance. Les tâches exigent le
souvenir conscient des événements préalables.
Les tâches expérimentales faisant intervenir la mémoire implicite en revanche, ne font pas
référence à des évènements préalablement vécus. Il s’agit de tâches qui permettent de
démontrer l’influence de la présentation préalable d’un évènement antérieur.
Dans le chapitre 2 de cette UE nous avons déjà présenté cette distinction et un protocole
expérimental classique qui permet de tester ces deux types d’accès conscient et inconscient
aux information en mémoire. Pour rappel, voici l’expérience typique : « Des sujets lisent
dans un premier temps une liste de mots […]. Lors de la phase test, un premier groupe de
sujets est invité à rappeler les mots de la liste dont le début, les trois premières lettres,
leur est donné. Il s’agit de « rappel indicé », une forme de test que l’on qualifie aujourd’hui
de test de mémoire explicite […]. Pour l’autre groupe, les mêmes indices, les trois
premières lettres d’un mot, sont donnés. Mais les sujets ne sont plus appelés à les
compléter de façon à évoquer les mots vus précédemment. Ils doivent cette fois énoncer
« le premier mot leur venant à l’esprit » commençant par ces lettres. Dans ces conditions,
les productions des sujets se révèlent influencées par leur lecture antérieure : si les trois
lettres présentées peuvent former le début d’un mot de la liste, ce mot tend à être choisi
préférentiellement à d’autres. Ce phénomène est désigné sous le terme de mémoire
implicite (ou encore d’amorçage de répétition). Le point important est que la seule
différence entre les deux tests de mémoire est dans l’intention du sujet : dans un cas, il
récupère intentionnellement le passé, dans l’autre, le passé exerce une influence sur son
comportement, à son insu. » (Besche-Richard, & Perruchet, 2000, p. 7).
Certains auteurs ont argumenté que les participants pouvaient avoir conscience de
l’influence de la première phase sur leur choix lors de la phase test. En d’autres termes,
que les tests implicites ne renvoyaient pas toujours à des contenus mentaux inconscients
lors de la récupération du matériel cible.
Pour répondre à ces critiques « Schacter, Bowers et Booker (1989) ont décidé de
distinguer par un critère d'intentionnalité la mémoire implicite de la mémoire explicite […]
[dans ce cadre] la mémoire explicite renvoie à l'acte intentionnel de récupération d'une
information récemment étudiée: le sujet « pense » délibérément à l'épisode d'étude tout
en recherchant activement l'information cible. Utilisée dans ce sens, la mémoire explicite
renvoie à la manière avec laquelle le processus de récupération est initié, et est synonyme
de souvenir délibéré, intentionnel ou volontaire. Par opposition, la mémoire implicite se
rapporte à la récupération non-intentionnelle du matériel préalablement présenté. Lorsque
Graf et Schacter (1985) disent que la performance à une tâche peut être facilitée « en
l'absence de souvenir conscient » cela veut simplement dire aujourd'hui que la
performance lors du test peut être influencée par l'information récemment acquise quand
le sujet ne s'engage pas intentionnellement dans une recherche rétrospective d'éléments
présentés lors de la tâche d'étude » (Nicolas, 1994, p69).

4
Modèle structural de l’organisation de la mémoire de
Squire (1980)
Squire (2004) a développé un modèle d’organisation (Figure 1) de la mémoire qui tient
compte des caractéristiques des informations conservées et de la façon consciente ou
inconsciente dont ces informations sont récupérées. Il oppose ainsi des mémoires
déclaratives et non-déclaratives qui sont équivalentes aux mémoire explicite et implicite
décrites par Graf et Schacter.
Dans son modèle, la mémoire déclarative (ou explicite) correspond au rappel conscient et
volontaire d’informations anciennes qui s’expriment au moyen du langage. Elle est
subdivisée en deux sous-systèmes (définis par le modèle de Tulving (voir chapitre 2 de
cette UE) : la mémoire épisodique et la mémoire sémantique.
La mémoire non-déclarative (ou implicite) correspond à la répercussion inconsciente
d’expériences qui ne sont pas consciemment verbalisées. Cette mémoire est subdivisée en
d’autres sous-systèmes: la mémoire procédurale, la mémoire relevant de l’amorçage, la
mémoire relevant du conditionnement. Nous présentons dans les parties suivantes ces
sous-systèmes. Squire ajoute également un sous-système de mémoire relevant
d’apprentissages dits non associatifs. Il s’agit entre autre de phénomènes d’habituation,
par exemple d’atténuation de la réaction d’un individu à un stimulus qui est présenté de
façon répétitive. Ce dernier sous système ne sera pas détaillé ici.
Figure 1 : Squire, L. R. (2004). Memory systems of the brain: a brief history and current perspective.
Neurobiology of learning and memory, 82(3), 171-177.

5
L’amorçage
Expérience pionnière d’amorçage sémantique
Dans une expérience pionnière menée par Meyer et Schvaneveldt en 1971, les participants
jugent à chaque essai deux séquences de lettres : Les séquences sont présentées
simultanément et les participants doivent appuyer le plus rapidement possible sur la touche
« oui » lorsque les deux séquences constituent des mots, et sur la touche « non » lorsque
l’une des deux séquences est un pseudo mot, ou lorsque les deux séquences sont des
pseudo mots. Lorsque les deux séquences constituent des mots, les mots sont soit
sémantiquement reliés, soit non : « The following test stimuli were used: 48 pairs of
associated words, e.g., BREAD-BUTTER and NURSE-DOCTOR, […]; 48 pairs of unassociated
words, e.g., BREAD-DOCTOR and NURSE-BUTTER, […]; 48 pairs of nonwords; and 96 pairs
involving a word and a nonword » (p.228).
Les résultats de l’expérience de Meyer (Figure 2) montrent que cette tâche de décision
lexicale est influencée par la sémantique des mots. En effet, lorsque les participants doivent
répondre par l’affirmative (c’est-à-dire lorsque les séquences sont toutes les deux des
mots), les réponses sont plus rapides pour des mots associés sémantiquement que pour
des mots non associés.
Que se passe-t-il d’un point de vue cognitif ? Lorsque les séquences apparaissent
simultanément à l'écran, le participant en traite une première. Pour savoir s’il s’agit d’un
mot ou d’un pseudo mot le participant doit essayer d’accéder à la sémantique de la
séquence. S’il y arrive cela veut dire que c’est un mot. Puis il traite la seconde séquence,
et là encore il essaie d’accéder à la sémantique de la séquence. S’il y arrive, il peut alors
appuyer sur le bouton « oui » pour valider le fait que les deux séquences sont des mots.
Les résultats montrent que la réponse du participant est plus rapide lorsque les deux mots
sont reliés sémantiquement plutôt que non reliés. Pour les auteurs, cela est dû au fait que
le premier traitement, qui résulte de l’accès à la sémantique du premier mot, facilite le
second traitement, c’est-à-dire l’accès à la sémantique du second mot. La facilitation du
second traitement induit une réponse au clavier plus rapide. C’est ce que l’on appelle un
amorçage sémantique.
Explications théoriques de l’amorçage sémantique
La théorie de la diffusion d’activation (Collins & Loftus, 1975) présentée dans le chapitre 2
de l’UE, explique facilement le phénomène d’amorçage. Pour les auteurs, la mémoire
sémantique est un réseau de concepts interconnectés, et deux concepts sémantiquement
proches sont reliés de façon directe l’un de l’autre dans le réseau. Lorsqu’un concept est
activé (l’individu a activé le sens du mot) alors une diffusion d’activation à lieu vers les
concepts proches, cette diffusion étant de moins en moins forte plus on s’éloigne du
concept initialement activé. Cette diffusion d’activation permet donc de « pré activer » les
concepts sémantiquement proches. Si l’individu doit traiter l’un de ces concepts « pré-
activés », alors il le traite plus rapidement que s’il n’a pas été pré-activé.
Selon le paradigme de la cognition incarnée et située lui aussi présenté dans le chapitre 2
de l’UE, cette facilitation est également aisément expliquée. Dans cette perspective, les
Figure 2 : Meyer et Schvaneveldt (1971)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%