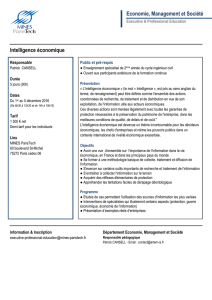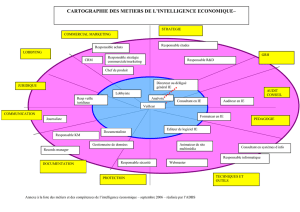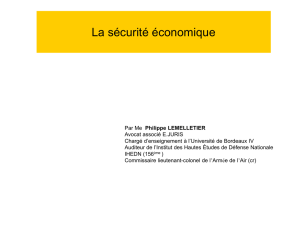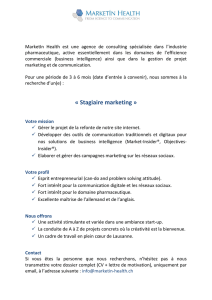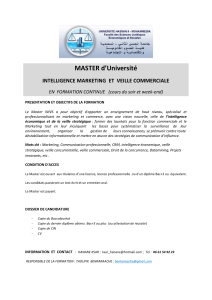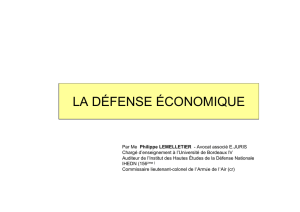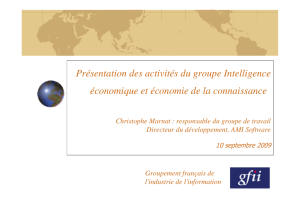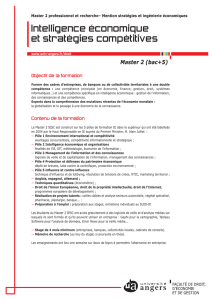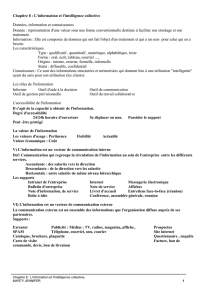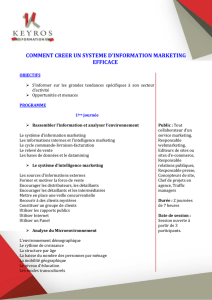La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 226-227 – Stratégie 77
Dossier
Économie de la connaissance
juillet-octobre 2007
L’intelligence économique,
un outil de management stratégique orienté
vers le développement de nouvelles connaissances
par Mourad Oubrich
1. L’intelligence économique,
un champ de recherche novateur
en management stratégique
Pour nous, l’extrait d’Oscar Wilde « Les gens ne cessent de dire
qu’il est beau d’avoir des certitudes. Il semble qu’ils aient
complètement oublié la beauté bien plus subtile du doute. Croire
est tellement médiocre. Douter est tellement absorbant. Rester
vigilant, c’est vivre; être bercé par la certitude, c’est mourir »
(Oscar Wilde, 1995) exprime bien ce qui caractérise
l’environnement actuel : fermeture et délocalisation de certaines
entreprises, des plans de licenciement, attentats, augmentation
des prix du pétrole… la liste est non exhaustive des événements
qui perturbent l’ordre économique international et affectent la
croissance des pays et des entreprises. Alors si nous étions
capables d’isoler et d’extraire de l’environnement certaines des
actions pertinentes qui participent à la structuration des disconti-
nuités, puis de les amplifier pour leur donner du sens utile pour
agir, il serait possible d’anticiper les événements (M.L.Caron,
1997 ; Lesca N, 2002). Il ne suffit pas de percevoir les événe-
ments et les actions des acteurs pertinents pour entrevoir leurs
intentions. Il faut imaginer derrière les circonstances présentes,
des possibilités d’évolution futures. La question que nous
pouvons poser à ce stade est : comment armer les entreprises
pour prévoir l’imprévisible ? Selon Ch. Harbulot et Ph. Baumard
(1996), le développement de système d’information stratégique
commun est le levier de la nouvelle économie.
Cette orientation stratégique a été adoptée pour la première fois
en avril 1989 par les membres de la Japanese Association of
Chief Information Officers qui regroupe les responsables des
structures d’information économique de 72 grandes sociétés
japonaises. Elle traduit la volonté du patronat japonais d’accorder
MMoouurraadd OOUUBBRRIICCHH
International MBA
Université de Laval (Canada)
et University of South Florida (États-Unis),
Docteur ès sciences de gestion,
Université d’Aix-Marseille II
Postdoctoral Université d’Ottawa (Canada)
Professeur, Université d’Ottawa

une place de plus en plus visible à l’information stratégique dans
la gestion de leurs affaires.
Notre article s’inscrit parfaitement dans ce contexte caractérisé
par un environnement incertain et imprévisible, notre objectif
consiste à donner des précisions et des réponses à la question :
comment armer les entreprises pour prévoir l’imprévisible ?
Pour répondre à cette question, notre article confronte le discours
académique et la pratique managériale sur le thème de
l’intelligence économique. Peu exploré jusqu’à maintenant,
thème de recherche transdisciplinaire et concept en maturation,
il fait progressivement l’objet de travaux de recherche en sciences
de gestion (S. Larivet, 2002 ; D. Phanuel et D. Levy, 2003 ;
M. Oubrich, 2004, 2005). L’intelligence économique (IE) repré-
sente une discipline récente en France (Ph. Baumard, 1991 ;
H. Lesca, 1994 ; H. Martre, 1994 ; H. Dou, 1995 ; A. Bloch, 1995;
F. Bournois et PJ. Romani, 2000,) qui se situe au carrefour de
plusieurs sciences.
1.1. Problématique de recherche
La littérature permet d’affirmer que la création des connais-
sances est désormais une préoccupation majeure pour les organi-
sations, qui les considèrent comme un avantage concurrentiel, ou
comme une nécessité dans le cadre de changements internes ou
environnementaux. La recherche en sciences de gestion a produit
une littérature riche sur le sujet (GP. Huber, 1991 ; M. Girod,
1995; J.-C. Spender, 1996 ; M. Polanyi, 1966 ; I. Nonaka, 1994,
I. Nonaka et H. Tackeuchi, 1995). Malgré le large consensus à
l’effet que l’intelligence économique contribue à la création de
nouvelles connaissances, nous dénombrons peu d’études dans
le domaine (F. Bournois et PJ. Romani, 2000 ; J.-L. Levet, 2001;
A. Du Toit, 2003 ; M. Oubrich, 2003, 2004, 2005,).
Les thèses en sciences de gestion soutenues sur le thème de
l’intelligence économique se sont focalisées sur la réalité des
pratiques d’intelligence économique dans les PME (CRM. de
Vasconcelos, 1999 ; S. Larivet, 2002), elles sont donc plutôt quali-
fiées comme des recherches sur le contenu. Or, l’intelligence
économique apparaît aussi comme un processus qui permet de
fournir une réponse « intelligente » à une problématique qui
semble aujourd’hui incontournable en sciences de gestion, celle
de la création des connaissances (M. Oubrich, 2004). Nous
estimons qu’aucun des travaux cités ne nous permet de répondre
à cette problématique. Aussi sommes-nous amené à nous inter-
roger sur l’existence d’une recherche en cours en sciences de
gestion sur ce thème. A ce propos, le fichier central des thèses
nous confirme qu’aucune recherche doctorale n’est consacréeà
cette problématique.
Finalement notre problématique de recherche est : Comment
l’intelligence économique permet-elle de créer des connais-
sances nouvelles dans l’entreprise ?
La problématique de cet article s’inscrit à la croisée des deux
thèmes : l’intelligence économique et la création des connais-
sances. Nous ne cherchons pas à apporter une nouvelle méthode
d’organisation de l’intelligence économique au sein des entre-
prises. En revanche, nous nous intéressons à la création collec-
tive de connaissances. Par création collective, nous entendons la
manière dont des individus interagissent pour arriver à une
compréhension explicite de l’environnement.
A travers cette problématique, nous répondons aux préoccupa-
tions actuelles d’une part, en gestion des connaissances qui
évoluent vers des problématiques liées à la création des connais-
sances plutôt qu’à la seule question du stockage/mémorisation
des connaissances, et d’autre part en intelligence économique
cherchant à montrer que l’intelligence économique ne se réduit
pas à la gestion de l’information, mais à la création des connais-
sances nécessaires à la prise de décision et à l’innovation.
1.2. Question de recherche
Notre problématique peut être traitée de différentes manières, il
nous apparaît nécessaire à ce stade de faire un choix qui guidera
notre raisonnement tout au long de cette recherche. Le terme
mécanisme a attiré notre attention, par rapport à d’autres termes
comme déterminant, condition… Le dictionnaire le Robert définit
mécanisme comme une « combinaison ou agencement de pièces,
d’organes, montés en vue d’un fonctionnement ». En ce qui nous
concerne, nous entendons par « mécanisme » l’agencement ou la
combinaison des éléments organisationnels, stratégiques et
cognitifs, en vue de créer des connaissances pour l’entreprise.
Nous nous plaçons dans le cas particulier de connaissances
créées par un processus d’intelligence économique, et nous
cherchons à identifier le ou les mécanismes de cette création des
connaissances. Notre recherche vise ainsi à répondre à la
question suivante : Par quel(s) mécanisme(s) le processus
d’intelligence économique crée-t-il des connaissances dans
l’entreprise ?
1.3. L’intérêt de la recherche
L’intérêt de cette recherche pour les entreprises et leurs
dirigeants découle pour une part essentielle de l’approche
théorique et empirique que nous présenterons ultérieurement.
Nous avons soulevé antérieurement quelques points qui clarifient
les objectifs de notre recherche. Nous allons ici développer un
peu plus et d’une façon plus structurée la réflexion sur les intérêts
de cette recherche. Ces intérêts s’analysent en trois points :
– sur le plan théorique : apporter une réponse à la question de
création des connaissances dans un processus d’intelligence
économique à travers une littérature centrée à la fois sur
l’information et sur la connaissance ;
– sur le plan pratique: proposer un modèle de l’intelligence
économique comme processus de création des connaissances
dans les entreprises, puis élaborer un cadre méthodologique
La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 226-227 – Stratégie78
Dossier
Économie de la connaissance
juillet-octobre 2007

qui permettra aux entreprises de structurer leur processus
d’intelligence économique ;
– sur le plan méthodologique: utiliser une méthode importée de
la psychologie sociale : l’analyse propositionnelle du discours.
Ce choix est justifié par la nature stratégique et confidentielle
des données que nous voudrions collecter. Cette technique
d’analyse sera réalisée au moyen du logiciel Tropes. L’intérêt de
cette méthode est de faciliter l’émergence d’éléments discur-
sifs « invisibles » à la seule lecture des retranscriptions.
2. Le cadre conceptuel
Dans ce point, nous souhaitons montrer que l’intelligence écono-
mique est un processus de création des connaissances et nous
espérons le faire de façon à ce que les praticiens et les théori-
ciens puissent, si possible, facilement accéder à notre vision.
2.1. Les approches opératoires
et théoriques de l’intelligence
économique
Approcher l’intelligence économique pour la reconnaître, signifie
selon G. Massé et TF. Thibaut (2001), que nous ne pouvons pas
l’atteindre pour la capturer, l’enfermer et la soumettre. Approcher
l’intelligence économique est donc tout le contraire d’une
réflexion aboutie et des certitudes qui en résultent. Nous propo-
sons une brève définition de l’intelligence économique selon trois
approches opératoires:
– approche par une définition : la multiplication des définitions de
l’intelligence économique depuis la sortie du rapport Martre,
confirme un intérêt majeur pour ce concept dans la stratégie
des entreprises. Parvenir à une définition serait un objectif de
l’approche par une définition ;
– approche par ses fonctions : un intérêt majeur pour ce concept
pour les entreprises s’explique aussi par un foisonnement des
fonctions que doit remplir ce concept. L’objectif de l’approche
par ses fonctions, est de développer certaines fonctions qui
sont indirectement traitées par les travaux antérieurs ;
– approche par processus : cette approche vise à étudier les diffé-
rentes phases du processus d’intelligence économique, et les
interactions qui peuvent se faire entre elles.
2.2. Les modèles de la création
des connaissances
Les travaux qui traitent la création des connaissances sont
aujourd’hui nombreux : Des revues spécialisées en gestion telles
qu’Organization Science, La Revue des Sciences de Gestion-
direction et gestion des entreprises, Strategic Management
Journal, Journal of Management Studies, California Management
Review, Management Learning, L’Expansion Management
Review, La Revue Française de Gestion, Journal of Organizational
Change Management, Gestion 2000 ont consacré des numéros
spéciaux à ces deux thèmes. L’objectif de ce paragraphe consiste
alors à établir une synthèse des modèles concernant la création
des connaissances.
Modèle de Nonaka
Selon I. Nonaka et al. (2000), la création des connaissances est
un processus continu de transcendance de soi-même, qui
traverse les frontières de l’ancien « soi-même » en un nouvel état
de soi même en acquérant un nouveau contexte, une nouvelle
vision du monde et une nouvelle connaissance. Ce passage de
frontière se fait grâce à l’interaction entre individus, mais aussi
entre les individus et leur environnement (Knowledge creation is
a continuous, self-transcending process through which one trans-
cends the boundary of the old self into a new self by acquiring a
new context, a new view of the world, and new knowledge. In
short, it is a journey from being to becoming. One also transcends
the boundary between self and other, as knowledge is created
through the interactions amongst individuals or between indivi-
duals and their environment. Une organisation crée de la connais-
sance par le biais de l’interaction entre la connaissance explicite
et la connaissance tacite. Cette interaction entre ces formes
tacite et explicite de la connaissance forme, selon I. Nonaka et
H. Takeuchi (1995), la base d’une spirale dynamique de création
des connaissances.
I. Nonaka fournit un éclairage déterminant quant à la création des
connaissances. Pour lui, la création des connaissances vient du
dialogue perpétuel entre la connaissance tacite et explicite. Pour
SDN. Cook et J.-S. Brown (1999), le dialogue entre les formes de
connaissance est possible grâce à un AO (apprentissage organi-
sationnel).
Le modèle de Wenger
Un autre modèle, plus centré sur les interactions que sur la
connaissance en elle-même, cherche à progresser dans la
compréhension de la problématique de création des connais-
sances, sous l’angle de pratique collective.
Il s’agit de penser la relation entre les pratiques, qui mettent
toujours en jeu des connaissances, à la fois tacites et explicites,
et la réification de ces pratiques, sous forme qui peut être égale-
ment tacite ou explicite. Nous retrouvons cette dualité dans les
travaux sur les communautés de pratique (E. Wenger, 1998).
H. Amblard et al (1996) définissent les communautés de pratique
comme un groupe d’individus ayant une identité forte, engagés
dans des luttes de pouvoir, préservant des zones de flou leur
autorisant des marges de manœuvre et de négociation. Alors que
pour Ph. Baumard (1991), les communautés de pratique sont des
La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 226-227 – Stratégie 79
Dossier
Économie de la connaissance
juillet-octobre 2007

groupes d’individus ayant une identité forte, et partageant une
connaissance tacite commune, acquise dans la pratique.
Les communautés de pratique ont fait l’objet de travaux
théoriques importants (E. Wenger, 1998, 2002). Les travaux sur
le management de la connaissance expliquent que la création
des communautés de pratiques facilite le développement des
connaissances (K. Goglio, 2003). E. Wenger désigne par
« création des connaissances » ce qui se manifeste dans la
pratique et dans la modification permanente des routines, du fait
de l’activité quotidienne. La pratique constitue alors un support à
la création des connaissances collectives, et contribue à créer
des cadres d’interprétation nécessaires à l’accomplissement des
tâches. Au sein de ces communautés, les nouvelles connais-
sances qui sont tacites et socialement localisées sont essentiel-
lement le « savoir-faire » (JS. Brown et B. Duguid, 1991). La nature
de la connaissance est dépendante de l’objectif et de la structure
des communautés de pratique. Enfin, elles produisent un réper-
toire partagé de connaissances communes (routines, sensibilités,
artéfacts, vocabulaires, styles… etc.). Ce répertoire est principale-
ment d’une nature tacite et la création des connaissances
s’apparente essentiellement au mode de conversion de connais-
sance de type « socialisation » (I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995).
Ce modèle offre un cadre original de lecture de phénomène de
création des connaissances et permet d’envisager celui-ci sous
un angle d’AO.
Modèle de Senge
Le modèle de Senge souligne l’importance de la qualité du raison-
nement des individus, de leurs visions partagées, de leur aptitude
à la réflexion, de l’apprentissage en équipe et de la compréhen-
sion des problèmes complexes de la vie des affaires dans la
création des connaissances.
B. Garvin (1993) critique les approches adoptées par PM. Senge;
il pense que les entreprises gèrent de façon active leur processus
d’apprentissage en intégrant dans le tissu opérationnel cinq
principales activités : la résolution systématique des problèmes,
l’expérimentation de nouvelles approches, l’apprentissage à
partir des expériences propres et des enseignements du passé,
l’apprentissage à partir des expériences et des succès des autres,
le transfert de la connaissance à travers l’organisation.
Ainsi, grâce à ces pratiques, l’entreprise possède l’aptitude de
créer, d’acquérir des connaissances, ainsi que celle de modifier
son comportement, afin de refléter de nouvelles connaissances
et de nouvelles manières de voir les choses.
Les trois modèles montrent que la création des connaissances
sur le plan collectif implique la dynamique de l’apprentissage en
groupe. Il faut s’assurer que les groupes sont créés avec des gens
possédant des compétences complémentaires et que chaque
groupe définit des objectifs réalistes.
De plus, une atmosphère d’ouverture doit être soutenue et
développée, au même titre que des espaces de communication
permettant de déboucher sur des brainstormings, des centres de
compétences, d’apprentissage, de retenir les leçons apprises…
etc.
Et grâce au développement de communautés des pratiques, une
entreprise peut développer des connaissances de manière
efficiente et efficace. Pour cela, il faut comprendre le processus
par lequel se fait l’apprentissage organisationnel.
Modèles de création de connaissances Principes Auteurs
Modèle de Nonaka
La création de la connaissance doit être
comprise comme un processus qui amplifie de
façon organisationnelle les connaissances
créées par les individus, et les cristallise en
tant que par tie d’un réseau de connaissances
de l’organisation.
Nonaka (1994) ; Nonaka et Takeuchi (1995) ;
Spender (1996) ; Grant (1996)
Modèle de Wenger
Les individus accumulent la connaissance
d’après leurs propres expériences. La qualité
de cette connaissance dépend de deux
facteurs. Le premier est la variété des
expériences individuelles en interaction. Le
second facteur est la connaissance de
l’expérience.
Brown et Duguid (1991) ; Wenger (1998) ;
Baumard (1999) ; Amblard et al (1996) ;
Lesourne (1991).
Modèle de Senge
Une organisation apprenante est une organisa-
tion qui possède l’aptitude de créer, d’acquérir
et de transférer des connaissances, ainsi que
celle de modifier son comportement, afin de
refléter de nouvelles connaissances.
Senge (1990) ; Garvin (1993) ; Tobin (1993) ;
Anciaux (1994) ; Baumard (1991) ; Mack (1995)
La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 226-227 – Stratégie80
Dossier
Économie de la connaissance
juillet-octobre 2007
Tableau: Modèles de création des connaissances.

2.3. L’apprentissage organisationnel,
quelles leçons pouvons-nous tirer
pour la création des connaissances?
L’apprentissage organisationnel a fait, et fait encore l’objet de
nombreux écrits. Ce thème complexe et ses différents aspects
semblent loin d’être épuisés. L’apprentissage organisationnel est
un concept multidisciplinaire utilisé pour décrire certains types de
phénomènes qui ont lieu dans une organisation. Nous allons
tenter dans ce paragraphe d’étudier les sources de
l’apprentissage organisationnel dans le cadre du processus
d’intelligence économique. Pour ce faire, nous allons choisir une
définition et un modèle de l’apprentissage qui correspondent
parfaitement à notre objectif de la recherche.
Le choix d’une définition synthétique
de l’apprentissage organisationnel (AO)
Les définitions de l’AO sont aujourd’hui pratiquement aussi
nombreuses que les travaux qui lui sont consacrés. Il est possible
de doter d’une définition incorporant un certain nombre
d’éléments émanant des efforts de conceptualisation de l’AO.
Celle proposée par C. Argyris et D. Schön (1978) semble bien
correspondre à cette volonté de synthèse: « le processus qui
implique la détection et la correction d’une erreur. Lorsque
l’erreur détectée et corrigée permet à l’organisation de poursuivre
ses politiques actuelles ou d’accomplir ses objectifs présents,
alors ce processus de détection et correction d’erreur est un
apprentissage en double boucle […] l’apprentissage en double
boucle apparaît lorsque l’erreur est détectée et corrigée de telle
façon qu’elle implique la modification des normes, politiques, et
objectifs fondamentaux d’une organisation ».
L’AO comme détection et correction d’erreurs
Pour ces auteurs, l’AO représente un concept d’action, en ce sens
que, d’une part, l’apprentissage est une condition de l’action
efficace, et d’autre part, l’acteur apprend dans l’action.
Leur modèle montre que lorsque l’individu découvre une erreur, il
élabore et met en pratique une théorie d’usage sensiblement
différente de la théorie qu’il professe. « Quand les erreurs sont
embarrassantes ou menaçantes, c’est-à-dire au moment précis
où il est capital de savoir apprendre efficacement, l’individu
développe des plans pour rester à l’ignorance de cette diver-
gence » (C. Argyris, 1993).
L’intérêt de l’analyse de C. Argyris et D. Schön (1978) réside,
selon nous, dans la distinction qu’ils opèrent entre différents
niveaux d’apprentissage. Ils insistent sur l’existence de boucles
inhibitrices d’apprentissage lorsque les individus se bornent à
corriger les erreurs de façon locale, ce qui ne leur permet pas de
repérer les dysfonctionnements de la théorie en usage et de
réaliser un apprentissage en double boucle.
L’apprentissage en double boucle dans un processus
d’intelligence économique, résultat de transformation des
programmes maîtres
Après avoir défini l’AO, nous allons aborder ici les déterminants
d’un apprentissage en double boucle dans un processus
d’intelligence économique (M. Oubrich, 2004, 2005).
Changement des représentations collectives
Partant de ce principe, les acteurs au sein d’un processus
d’intelligence économique se réfèrent sans cesse à ces cadres de
représentation collective pour agir. Dans ce sens, l’intelligence
économique peut être considérée comme une « agence » dans
laquelle les individus cherchent à se forger une représentation de
l’environnement interne et externe. Les individus, dans ce
processus, interagissent pour affiner et compléter leurs repré-
sentations, les tester et les faire évoluer. Dans la même tentative
d’explication de l’AO comme source de construction d’une repré-
sentation collective dans un processus d’intelligence écono-
mique, certains auteurs, et nous retrouvons ici les idées de
R. Cyert et J. March (1963), qui notent que l’apprentissage
provient d’un écart ponctuel ou continuel entre un niveau
d’aspiration associé à un objectif et le niveau réel de perfor-
mance.
Changement de l’intention stratégique
F. Charue (1992) précise qu’« il y a AO lorsque les membres de
l’organisation construisent des savoirs pertinents par rapport à la
mission de l’organisation et que ces derniers sont codés ou
mémorisés dans l’organisation ». Le concept de mission de
l’organisation est lié à celui d’intention stratégique. D’après
A. Campbell et S. Yeung (1991a) et M. Lipton (1996), la mission
de l’organisation est la réponse à la question « pourquoi
l’entreprise existe-t-elle ? », tandis que pour N. Thornberry (1997),
elle est « les missions fondamentales de l’organisation pour
exister au-delà du simple fait de faire de l’argent ». Alors, pour
l’intention stratégique, les auteurs américains notent qu’elle crée
une inadéquation extrême entre les ressources et les ambitions.
Pour E. Métais et C. Roux-Dufort (1997), cette inadéquation entre
les ressources et les ambitions est la source de la tension
créatrice décrite par PM. Senge (1990), et qui est à l’origine de
l’atteinte de l’intention. Ils notent également que le niveau
adéquat pour faire naître cette tension créatrice dépend égale-
ment de l’organisation : « une organisation apprenante, habituée
au changement est capable de supporter un niveau de tension
nettement supérieur à une organisation statique, peu sollicitée
au cours de son expérience passée ». L’idée de tension ne peut
donc se concevoir que de manière absolument relative. E. Métais
et C. Roux-Dufort (1997) distinguent plusieurs niveaux de tension
selon l’importance de l’écart entre l’intention et la réalité. A
La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 226-227 – Stratégie 81
Dossier
Économie de la connaissance
juillet-octobre 2007
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%