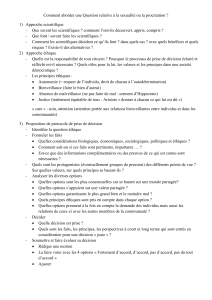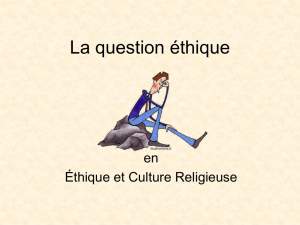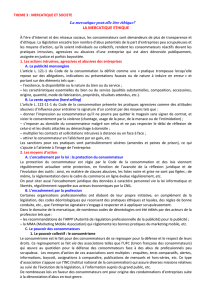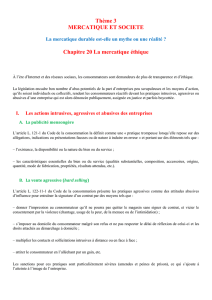L'IMPACT DE LA RELATION « ÉTHIQUE-CONFIANCE » SUR L'INTENTION
D'ACHAT DU CONSOMMATEUR
Cas des produits respectueux de l'environnement
Aïda Baccouche Ben Amara et Mustapha Zghal
Direction et Gestion | « La Revue des Sciences de Gestion »
2008/6 n° 234 | pages 53 à 64
ISSN 1160-7742
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2008-6-page-53.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Direction et Gestion.
© Direction et Gestion. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 234 – Marketing 53
Dossier
Responsabilité et environnement
novembre-décembre 2008
L’impact de la relation
« éthique-confiance » sur l’intention
d’achat du consommateur :
cas des produits respectueux de l’environnement
par Aïda Baccouche Ben Amara et Mustapha Zghal
Aïda BACCOUCHE BEN AMARA
Maitre Assistant
Faculté des Sciences économiques
et de gestion de Tunis
(Tunisie)
Notre société actuelle est sous l’emprise de divergences
socioculturelles issues des échanges entre partenaires
sociaux, d’une médiation prononcée des crises sanitaires
et des catastrophes naturelles et d’un élargissement de l’éventail
de produits offerts au consommateur.
Ces différents facteurs de contexte sont à l’origine de l’émer-
gence d’une société post-moderne caractérisée par l’apparition
de nouvelles aspirations de consommation, d’une plus grande
interpellation sociétale des entreprises et d’une exigence d’adap-
tation des pratiques du marketing.
Les consommateurs manifestent de nouvelles revendications en
matière de consommation et prennent de plus en compte des
attributs éthiques d’ordre qualitatif dans leur choix de produits
tels que, les conditions de production, l’origine géographique,
les moyens de communication, la conformité aux normes, la
traçabilité, les labels et les dates de péremption.
L’éthique est devenue une exigence dans la gestion des entre-
prises du XXIe siècle qui sont désormais contraintes de modifier
leurs comportements en vue de concilier les exigences éthiques
de leurs partenaires sociaux et la rationalité économique indis-
pensable à leur pérennité.
Le marketing qui joue le rôle d’interface entre l’entreprise et ses
différents environnements, doit suivre cette nouvelle donne et
proposer de nouveaux facteurs de différenciation répondant aux
nouvelles exigences de consommation.
Les pratiques commerciales doivent être plus responsables, en
vue de rassurer les partenaires sociaux, légitimer les actions des
entreprises et garantir le bien-être collectif à tout un chacun.
Les études portant sur l’éthique dans les relations d’achat/vente
et dans les choix de consommation ainsi que celles relatives à
l’analyse des implications éthiques générant la confiance dans
le domaine transactionnel mériteraient beaucoup plus d’attention
de la part des chercheurs académiciens soucieux d’analyser les
processus décisionnels individuels.
Nous focaliserons principalement notre recherche sur l’analyse
du comportement d’achat du consommateur qui inclut en plus
Mustapha ZGHAL
Professeur Émérite
Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion de Tunis
(Tunisie)
Article available at http://www.larsg-revue.com or http://dx.doi.org/10.1051/larsg/2008054Article available at http://www.larsg-revue.com or http://dx.doi.org/10.1051/larsg/2008054
Article available at http://www.larsg-revue.com or http://dx.doi.org/10.1051/larsg/2008054
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 234 – Marketing54
Dossier
Responsabilité et environnement
novembre-décembre 2008
des critères traditionnels de choix de consommation, des attri-
buts éthiques d’autant plus que les recherches sur cet axe sont
plutôt rarissimes.
Notre problématique générale à travers cette étude vise à répondre
à la question suivante : dans quelle mesure les attributs éthiques
intégrés par le consommateur en amont de son processus
d’achat, peuvent-ils générer sa confiance et influencer son
intention d’achat ?
Les objectifs visés sont les suivants :
– dans une première partie, proposer et justifier une conceptua-
lisation de l’éthique dans le domaine de la consommation et
ses rapports avec la confiance issue de la psychologie sociale
et du marketing en vue de proposer une modélisation du
comportement d’achat du consommateur incorporant la relation
« éthique - confiance » ;
– dans une seconde partie, valider empiriquement le modèle
conceptuel proposé dans le cas particulier de l’achat des
produits respectueux de l’environnement ;
– la dernière partie, propose une discussion des principaux
apports de cette recherche, et en précise les limites et voies
futures de recherche.
1. Cadre conceptuel
de l’éthique dans le domaine
de la consommation
L’éthique dans le domaine particulier du comportement du consom-
mateur est un axe de recherche qui a intéressé les chercheurs
soucieux d’analyser l’intégration des valeurs morales en matière
de choix individuels. Les consommateurs expriment de plus en
plus leurs valeurs morales dans leur choix de consommation à
travers des attitudes de consommation plus socialement respon-
sables et de
nouvelles aspirations aussi bien en amont qu’en
aval de leur consommation. (Vitell et Muncy, 1992)
1
, (Singhapakdi
et al. 1999)2.
Cette première partie exposera l’éthique comme base du jugement
du consommateur, puis analysera l’éthique en tant que déter-
minant de la confiance du consommateur pour enfin, aborder
l’éthique comme facteur discriminant ses achats et agissant sur
son intention d’achat.
1.1.
L’éthique : un préalable au jugement
du consommateur
L’éthique est définie comme la recherche du bien vivre et du bien
faire, fondée sur une disposition individuelle à agir de manière
1. Vitell, S. J. & Muncy, J. A.,
Consumer ethics : an investigation of the ethical
beliefs of the final consumer,
Journal of Business Research, 1992, 24,
p. 297-311.
2. Singhapakdi A, Mohammed Y.A. Rawwas, Janet K. Marta, M. I,
A cross-cultural
study of consumer perceptions about marketing ethics,
Journal of Consumer
Marketing, 1999,16, 3, p. 257-272.
constante en vue du bien d’autrui et dans des institutions justes,
(Rawls, 1971)3. Elle traduit le sens d’une réflexion profonde sur
les principes généraux qui guident l’action humaine, (Lenoir,
1991)4. Elle sert d’évaluation ou d’appréciation de nos actions,
de notre conduite et de nos règles de vie, selon le registre du
bien et du mal, du juste ou de l’injuste, (Duhamel et al. 2001)5.
Elle est matérialisée par tout l’ensemble de principes gouvernant
l’action des individus pour autant qu’ils agissent en fonction de
leur appartenance à un groupe social déterminé et que cette
appartenance impose des règles de conduite, (Auroux)6.
L’éthique traduit les systèmes moraux se rapportant
aux intentions
et aux règles de l’action humaine. Elle oriente ainsi la conduite
des individus en société à travers certaines valeurs fondamen-
tales : la loyauté, l’honnêteté, le courage, la diligence, la justice,
la responsabilité et le respect.
Lors du processus d’achat d’un produit, si l’on s’intéresse à la
question de savoir si le consommateur se soucie de la façon dont
il a été conçu et, ou du produit lui-même ou, au contraire, des
deux à la fois : cela traduit un raisonnement éthique.
En effet, la
première évaluation est d’ordre déontologique et concerne les
moyens utilisés, la deuxième, est d’ordre
téléologique et concerne
les fins visées, la troisième est à la fois déontologique et téléolo-
gique et tient compte à la fois des moyens et des fins.
Nous retiendrons dans le cadre de cette recherche l’éthique,
comme base essentielle du jugement du consommateur lors
son processus d’achat, intervenant dans la phase d’évaluation
des possibilités offertes et visant à rechercher une adéquation
entre les fins visées et les moyens utilisés lors des processus
de production et de commercialisation des produits. Le consom-
mateur éthique intègre l’éthique comme base essentielle de ses
jugements et justifie ses décisions par un raisonnement réflexif
basé sur les notions de bien et de mal, du bon et du mauvais,
du juste et de l’injuste, etc.
Le jugement éthique du consommateur est par ailleurs tributaire
de ses croyances, de sa conviction, de son propre système de
valeurs, de ses prédispositions personnelles, de son expérience,
de sa religion, de sa sensibilité à tout ce qui fait sens, de l’intérêt
qu’il accorde aux règles éthiques, et enfin, de son respect pour
autrui.
Le consommateur éthique serait celui qui manifeste un certain
intérêt aux attributs éthiques en tant que caractéristiques intan-
gibles du produit : ses conditions de production, son origine
géographique, son cycle de vie, ses impacts sociaux et environ-
nementaux, ses processus commerciaux, etc. À côté des critères
économiques traditionnels, les individus sont influencés par des
3. Rawls, J.
Théorie de la justice,
traduction de Catherine Audard
, Editions Seuil,
Paris, 1987. Titre original : A theory of justice, Belknap Press of Harvard University
Press, 1971, in Racine Louis,
L’éthique et les affaires
, Revue Internationale de
gestion, 1991,volume 16- N° 2 Mai p. 51-56.
4. Lenoir,
Le temps des responsabilités,
Fayard, 1991, in Jean Moussé, Éthique
et entreprise, Vuibert, Paris, 1993, 192.
5. Duhamel A et Mouelhi N. avec la collaboration de Sylviane C,
Éthique, politique,
application
, Canada, Éd Gaétan Morin, 2001, 306.
6. In Doucet René,
L’éthique et la gestion des ressources humaines
, Revue
Internationale de Gestion, mai 1991, volume 16- N° 2, p. 70-77.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 234 – Marketing 55
Dossier
Responsabilité et environnement
novembre-décembre 2008
critères éthiques dans leurs comportements d’achat. (Smith et
al, 1993)7, (Dowell et al. 1998)8, (Thogersen, 1999)9.
L’engagement éthique du consommateur peut être considéré
comme une variable explicative de son comportement, (Vitell et
al. 2001)10, un attribut intangible de ses choix de consommation,
(Crane, 2001)11 voire même une source de motivation à l’achat,
(Canel-Dépitre, 2003)12.
Une catégorisation des consommateurs en fonction de l’intérêt
qu’ils portent à l’éthique, élaborée par « Carrigan et Attalla, 2001 »13
nous emble assez éclairante dans notre conceptualisation de
l’éthique dans le domaine du comportement du consommateur.
Ces auteurs ont analysé l’attitude des consommateurs à l’égard
de l’achat éthique en croisant la conscience éthique et l’intention
éthique d’achat. Ils ont dégagé quatre catégories de consomma-
teurs : 1. Les compréhensifs et éthiques : font une discrimination
entre les entreprises éthiques et non éthiques et sont enclins à
répondre positivement au comportement éthique réel des entre-
prises, 2. Les confus et incertains : voudraient acheter éthique
mais ils demeurent déconcertés par le manque d’orientation
et les messages contradictoires concernant le comportement
éthique des entreprises, 3. Les cyniques et désintéressés : ne
souffrent pas d’un manque d’information mais d’un manque de
conviction que les entreprises sont réellement éthiques, 4. Les
inconscients : le manque de connaissance sur l’éthique signifie
qu’elle n’est pas encore entrée dans leur équation d’achat. Un
accroissement de leur conscience éthique peut engendrer une
intention d’achat éthique plus forte. »
Il ressort de cette catégorisation des consommateurs éthiques
que l’analyse de l’éthique dans les choix de consommation repose
tant sur les facteurs personnels que sur les systèmes de valeurs,
de conviction, de perception, d’orientation, et d’information en
matière d’éthique.
Cette réflexion sur l’éthique dans le cadre du domaine particulier
du comportement du consommateur, laisse présager que l’éthique
peut être examinée comme une variable décisionnelle de choix
guidant et orientant les actions de tout un chacun tout.
L’éthique peut par conséquent être appréhendée comme garant de
l’honnêteté des moyens utilisés et de la traçabilité des produits.
Elle constitue de ce fait un antécédent de choix à la genèse d’une
certaine confiance et d’une relation durable entre les partenaires de
7. Burke S.J., Milberg S.J. & Smith N. C,
The role of ethical concern in consumer
purchase behaviour, understanding alternative processes
, Advances in Consumer
Research, 1993, 20, p. 119-122,
8. Dowell R.S., Goldfarb, R. S, Griffith W.B.,
Economic man as a moral individual,
Economic Injury, vol XXXVI, 1998,p. 645-653.
9. Thogersen J.,
The ethical consumer, moral norms and packaging choice
,
Journal of Consumer Policy, 1999, 22, 4, p. 439-460.
10. Vitell S J., Singhapakdi A. & Thomas J,
Consumer ethics : an application
and empirical testing of the Hunt-Vitell theory of ethics
, Journal of Consumer
Marketing, 2001, 18, 2, p. 153-178.
11. Crane A.,
Unpacking the ethical product
, Journal of Business Ethics, 2001,
30, 4, p. 361-373.
12. Canel-Dépitre B.,
L’incidence de la consommation engagée sur la fixation
des prix,
Actes du Congrès sur les Tendances du Marketing en Europe, 2003,
Paris, p. 1-32.
13. Carrigan M., Attalla A.,
The myth of ethical consumer : do ethics matter
in purchase behaviour ?,
Journal of Consumer Marketing, 2001, 18, 7,
p. 560-577.
l’échange. Les garanties écologiques sont une motivation d’achat
pour des préoccupations d’éthique sociale, l’achat de produits
dont le fabricant soutient des projets de développement dans
des pays pauvres, l’achat de produits d’une entreprise soucieuse
des droits des salariés ou qui soutient une cause humanitaire.
(Pontier et Sieriex. 2003)14.
Nous tenterons dans ce qui suit de relater les liens entre éthique
et confiance tout en mettant en exergue leur impact en matière
de choix de consommation.
1.2. L’éthique : un déterminant
de la confiance du consommateur
Dans le contexte économique actuel caractérisé par une concur-
rence accrue entre les divers partenaires, nous assistons à une
montée en puissance du scepticisme des consommateurs à l’égard
de leurs fournisseurs de biens et de services. « La multiplication
des affaires à scandales et des fautes professionnelles entraîne
une réelle méfiance des consommateurs et soulève la question
de l’éthique de l’entreprise et de la confiance du consommateur ».
(Gatfaoui et Lavorata, 2001)15.
L’évolution des besoins socioculturels des consommateurs est
caractérisée depuis quelques années, par l’apparition de nouvelles
aspirations en matière de consommation basées essentiellement
sur des dimensions symboliques, intangibles et immatérielles.
Les consommateurs sont toujours à la recherche de transactions
avec des vendeurs envers lesquels ils ont confiance. L’attente
d’une démarche éthique de la part des producteurs par les
consommateurs est intimement liée à l’existence d’une relation
de confiance. Cette dernière les rassure sur la qualité des produits
et sur l’honnêteté des moyens utilisés.
L’analyse des modèles explicatifs de la décision d’achat du
consommateur devrait par conséquent incorporer des variables
ignorées antérieurement : éthique, risque perçu, qualité perçue
et confiance. L’importance accordée aux éléments symboliques
de la consommation permet de considérer la confiance, non plus
seulement dans sa composante cognitive, mais d’en rechercher
les sources dans un faisceau d’éléments culturels symboliques,
(Filser, 1998)16.
La confiance est une variable médiatrice des échanges, qui est
d’autant plus consolidée, que le partenaire manifeste un certain
comportement éthique. Ainsi tout comportement éthique adopté
mutuellement par les partenaires d’une sphère marchande
contribue au renforcement de leur confiance et poursuit un double
objectif : hausser l’épanouissement personnel de tout le monde
et veiller à entretenir des relations gagnantes durables.
14. Pontier S & Sieriex L,
Les préoccupations éthiques des consommateurs et
leur expression dans la consommation de produits biologiques
, Actes du Congrès
de l’Association Française de Marketing, Tunis, 2003, p. 62-74.
15. Gatfaoui S., Lavorata L.,
De l’éthique de l’enseigne à la fidélisation du
consommateur, le rôle de la confiance,
Revue Française du Marketing, 2001,
N° 183/184, p. 213-226.
16. Filser M.,
Confiance et comportement du consommateur
, Économies et
Sociétés, Sciences de Gestion, Série 1998, SG n° 8-9, p. 279-294.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 234 – Marketing56
Dossier
Responsabilité et environnement
novembre-décembre 2008
L’étude de la relation « éthique-confiance » gagnerait à être
minutieusement étudiée et mériterait beaucoup plus d’attention
aussi bien de la part des chercheurs académiciens que de celle
des professionnels du marketing et ce, dans le domaine particulier
du comportement du consommateur. Alors que la nécessité de la
confiance a été largement reconnue en marketing des services,
les implications morales et éthiques générant et entretenant la
confiance dans le contexte d’échange transactionnel n’a pas été
entièrement explorée. (Rao et Singhapakdi, 1997)17.
Il serait donc opportun de définir la confiance par rapport à notre
thématique de recherche. La confiance reflète l’attente par une
personne, un groupe ou une firme d’un comportement éthique-
ment justifiable. La confiance est le résultat d’un comportement
« juste », « vrai » et équitable dans le sens où les décisions morale-
ment correctes et les actions basées sur les principes éthiques
d’analyse reconnaissent et protègent les droits et intérêts des
autres dans la société. (Hosmer, 1995)18.
Au regard des travaux antérieurs, la confiance a été conceptua-
lisée de deux manières :
Variable psychologique : située en amont de l’intention de compor-
tement : présomption, attente, croyance vis-à-vis du partenaire de
l’échange : dimensions cognitives et affectives : une présomption :
(Gurviez et Korchia, 2002)19, une attente
: (Sirdeshmukh et al.,
2002)
20
ou encore une croyance vis-à-vis du partenaire de l’échange
(Ganesan, 1994)21.
Variable comportementale : une action ou une intention compor-
tementale : volonté d’être vulnérable, volonté de compter sur le
partenaire de l’échange : dimensions conatives, en tant qu’attente
positive vis-à-vis du partenaire, la confiance sous-tend le postulat
qu’elle se fonde sur l’anticipation et la prévisibilité, (Doney et
Cannon, 1997)22.
Nous avons considéré la confiance comme une résultante d’un
comportement éthique du partenaire de l’échange et comme
variable psychologique située en amont de l’intention de compor-
tement (présomption) explicative du comportement d’achat du
consommateur.
Nous avons par ailleurs adopté la définition tri dimensionnelle de
la confiance dans la marque proposée par (Gurviez et Korchia,
2002)23 que nous avons tenté d’adapter à notre cadre d’analyse
dans l’explication du comportement d’achat du consommateur basé
17. Rao C.P. & Singhapakdi A.,
Marketing ethics : a comparison between services
and other marketing professionals,
The Journal of Services Marketing, 1997, 11,
6, p. 409-426.
18. Hosmer L. Tone,
Trust : the connecting link between organizational theory
and philosophical ethics
, Academy of Management Review, 1995, 20, 2,
p. 379-403.
19. Gurviez P. & Korchia M.,
Proposition d’une échelle multidimensionnelle de
la confiance dans la marque
, Recherche et Applications en Marketing, 2002,
17, 3, p. 1-58.
20. Sirdeshmukh D. Singh J. & Sabol B.
Consumer trust, value and loyalty in
relational exchange
s, Journal of Marketing, 2002, 66, p. 15-37.
21. Ganesan S. & Hess R.,
Dimensions and levels of trust : implications for
commitment to relationship,
Marketing Letters, 1997, 8, 4, p. 439-448.
22. Doney P. & Cannon J.,
An examination of the nature of trust in buyer-seller
relationships, Journal
of Marketing, 1997, 61, p. 35-51.
23. Gurviez P. & Korchia M.,
Proposition d’une échelle multidimensionnelle de
la confiance dans la marque
, Recherche et Applications en Marketing, 2002,
17, 3, p. 1-58.
sur des attributs éthiques. « La confiance dans une marque, du
point de vue du consommateur, est une variable psychologique
qui reflète un ensemble de présomptions accumulées quant à
la crédibilité, l’intégrité et la bienveillance que le consommateur
attribue au partenaire de l’échange. La crédibilité attribuée à la
marque est l’évaluation de ses capacités à remplir les termes
de l’échange concernant les performances attendues, c’est-à-dire
à répondre aux attentes « techniques » du consommateur, elle
repose sur l’attribution à la marque par le consommateur d’un
degré d’expertise quant à ses attentes fonctionnelles sur la satis-
faction de ses besoins. L’intégrité est l’attribution de motivations
loyales et fiables à la marque quant au respect de ses promesses
concernant les termes de l’échange, autrement dit de l’honnêteté
de son « discours » pris au sens large. La bienveillance est l’attri-
bution à la marque d’une orientation « consommateur » durable,
concernant la prise en compte des intérêts du consommateur, y
compris avant les siens propres à court terme ».
Cette définition de la confiance du consommateur considérant la
marque comme partenaire de l’échange, a été adaptée à notre
cadre d’étude, en retenant comme partenaire de l’échange « les
attributs éthiques » du produit, revendiqués par le consommateur
dans son processus d’achat.
En vue d’expliquer de quelle manière ces critères de choix désirés
par le consommateur en amont de son processus d’achat pouvaient
générer sa confiance à l’égard de son partenaire de l’échange
et influencer son jugement, nous avons retenu l’approche de
(Crane, 2001)24 qui propose un cadre d’analyse assez pertinent
sur les différentes façons dont l’éthique peut influencer la décision
d’achat du consommateur. Il a étudié le produit d’un point de vue
du consommateur, en incorporant à ses caractéristiques tangi-
bles un ensemble complexe d’attributs et de bénéfices perçus,
qualifiés d’éthiques. Ces attributs peuvent aussi bien représenter
des bénéfices supplémentaires ou augmentations éthiques par
rapport à la valeur intrinsèque du produit, qu’être négatifs et non
désirés par le consommateur. Ils peuvent se traduire à quatre
niveaux différents : le niveau produit, le niveau marketing, le niveau
de l’organisation et le niveau du pays d’origine.
Dans le cadre de cette analyse nous avons retenu les attributs
éthiques reflétant l’offre éthico-marchande d’un produit à trois
niveaux : celui du produit, celui de l’entreprise et celui de la
communication comme principales variables explicatives du
jugement éthique du consommateur. Le pays d’origine ayant été
négligé compte tenu de la difficulté de gérer les différences de
perceptions éthiques issues de contextes culturels différents.
Nous nous proposons de démontrer dans ce qui suit comment les
attributs éthiques constituent une base essentielle du jugement du
consommateur traduisant ainsi son implication tant en amont qu’en
aval du processus de consommation des produits et dans quelle
mesure ces attributs éthiques intégrés par le consommateur parmi
ses attributs de choix et perçus positivement, peuvent renforcer
sa confiance à l’égard de son partenaire de l’échange ?
24. Crane A., (2001), Op. Cit.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Martin Emmanuel - 109.205.4.97 - 24/02/2020 17:12 - © Direction et Gestion
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%