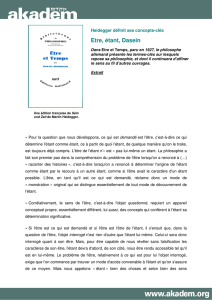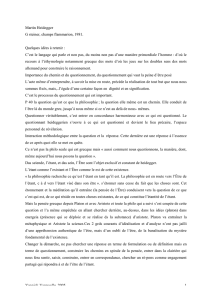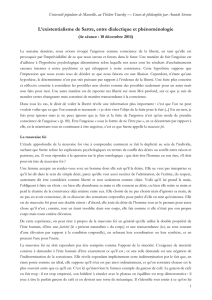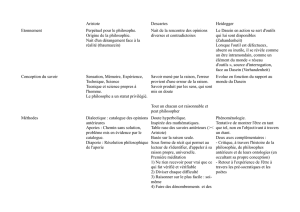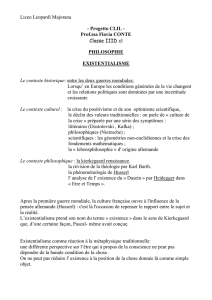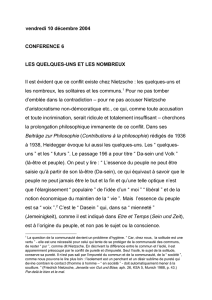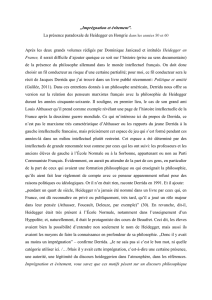Dasein, monde et mouvement chez Heidegger
1
Introduction
Dans cet article, nous voulons dégager dans l’analytique existentiale de
Heidegger la présence d’une philosophie implicitement tournée contre le
mouvement, compris comme possibilité du changement au niveau des formes
mêmes de l’existentialité. De manière plus large, le but de notre propos consiste à
questionner la phénoménologie heideggerienne sous l’angle de la mobilité, laquelle
représente selon nous une perspective fondamentale pour penser notamment les
mutations introduites par la technique dans « l’existence ».
Plus précisément, nous examinerons pourquoi la mobilité que Heidegger confère
à la structure du Dasein n’est qu’apparente. Le primat de l’avenir parmi les ekstases
temporelles propres au Dasein, déployant tout le vocabulaire de la projection, ainsi
que le primat de la constitution, déployant le champ sémantique de l’activité,
peinent à masquer la tendance inhérente à Être et temps qui se résume dans le primat
implicite de la finalité. Nous développerons l’idée qu’à travers la domination de la
structure du renvoi, la structure du Dasein est une totalité auto-finalisée et fermée
au devenir.
Nous voudrions ainsi nouer notre propos, dans sa continuité, à l’aide de trois fils
conducteurs qui peuvent se formuler comme des hypothèses : 1) L’analytique du
Dasein ne parvient pas à éliminer de sa structure la présence d’une forme de
passivité : bien plus, elle l’organise, lui fait entièrement droit, et prépare ainsi la
conception « attentiste » du rapport à l’être qui gouvernera peu à peu l’évolution
ultérieure de Heidegger. 2) Les conséquences de cette centralité de la passivité dans
l’expérience du Dasein s’expriment dans un parti pris anti-cinétique, c’est-à-dire
que l’attribution par Heidegger d’un a priori à la totalité de l’existence a pour effet
de rendre impensables les mutations potentielles qui pourraient affecter ses formes
mêmes. 3) Enfin, l’ensemble de ces critiques peut se réunir sous le concept
d’hypertélie. L’unité de l’analytique existentiale est permise par une saturation
sémantique des modes d’être du Dasein, c’est-à-dire qu’en existant toujours en vue
de lui-même, celui-ci se trouve pris dans un réseau où les structures du renvoi, de
la significativité et de la compréhension clôturent le Dasein dans sa sphère d’ipséité.
Nous parlerons alors d’hypertélie pour désigner à la fois la primauté du rapport de
renvoi, sa dimension auto-renvoyante (ipséité) et le caractère a priori qui lui est
dévolu, conduisant à saturer de finalité la dynamique de l’existence et à faire de
cette finalité une dimension transcendantale qui par définition échappe et se ferme
à toute modification issue des processus empirico-mondains (et notamment des
évolutions techniques). Ainsi, en tentant une analogie avec la définition
simondonienne de l’hypertélie, il s’agit de critiquer la forme même d’une analytique
existentiale dans son intention. Pour Simondon
1
, il y a hypertélie lorsqu’un objet
technique n’est adapté qu’aux conditions de milieu qui le précèdent et sont déjà
données, tandis qu’un objet véritablement « concret » (c’est-à-dire souple, inventif,
et non saturé dans ses fonctions) est capable d’inventer son propre milieu, c’est-à-
dire de s’auto-conditionner et s’individualiser avec ce nouveau milieu : un objet
hypertélique, lui, est condamné à mourir dans la mesure où il est excessivement
finalisé vers, dépendant de et adapté à un milieu déjà donné, incapable d’évolution.
Oser l’analogie et formuler une telle critique à l’adresse de Heidegger revient
dès lors à plaider pour une conception naturaliste de l’existence, à savoir comme
1
G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 2012, p. 68-69.

Dasein, monde et mouvement chez Heidegger
2
d’un champ d’expérience susceptible d’évolution et de transformation sous la
poussée de la vie et de sa puissance de « déliaison » à l’égard des formes de vie
constituées. Entreprendre de déconstruire toute constitution transcendantale de
l’existence implique ainsi de déterminer le sens de la mobilité originaire qui
conteste sans cesse les formes familières de notre expérience, au niveau même de
leur valeur a priori. Une conception naturaliste de l’existence reconduit dès lors
l’intériorité des champs transcendantaux à une extériorité à partir de laquelle ils se
constituent. Dans une perspective simondonienne, l’existence se laisse décrire
comme un rapport non phénoménologique entre un être et son milieu – pour le
vivant et les objets techniques, et entre un être et son monde dans le cas de l’homme,
c’est-à-dire comme une individuation. Or nous tenons à montrer ici que Heidegger
ne réfléchit pas, dans la période d’Être et temps, aux conditions évolutives de la co-
appropriation de l’homme et de son monde. En prétendant décrire une structure
achevée (dans ses éléments fondamentaux), non évolutive, et représentative des
possibilités essentielles d’un étant éminent, il élude ce que le rapport à l’être
comporte en tensions, potentiels et incompatibilités susceptibles d’appeler une
restructuration radicale de ses modalités mêmes.
1. La rectification ontologique de l’attitude naturelle
Il faut tout d’abord examiner en quoi le problème de la réceptivité, dans sa
réélaboration transcendantale-existentiale, loin d’ouvrir la structure elle-même de
l’existence à une mobilité capable de la surmonter et de la transformer, se sert au
contraire de l’héritage transcendantal pour fixer de façon univoque le rapport au
monde. S’il y a un primat de la réceptivité dans l’analytique existentiale, celle-ci
n’a d’autre fonction que d’organiser une attitude d’écoute à l’égard de l’être. Mais
puisque celui-ci ne se donne qu’à partir de l’ouverture déployée par le Dasein, il
n’y a plus qu’une réceptivité ontologique envers le sens de l’être, qui ne renvoie in
fine qu’aux structures appartenant au Dasein. Si l’être ne se donne que dans les
structures de l’existence, celle-ci ne peut s’ouvrir qu’à elle-même, à son niveau
transcendantal, pour autant qu’elle est traversée de rapports ontologiques.
Pourtant, s’il importe de soulever une question qui, apparemment, semble réglée
d’avance par Heidegger, c’est parce qu’en écartant la question épistémologique de
la réceptivité sensible au profit de la réceptivité à l’être, l’analytique existentiale se
retrouve devant l’étrange situation où le transcendantal est délivré dans l’existence,
c’est-à-dire se retrouve lui-même objet d’expérience : de ce fait, les modes de
l’existence authentique exercent leur emprise à la fois comme conditions de
possibilité de l’inauthentique, et comme manières d’être devant être concrétisées et
réalisées en acte sur la base de l’affect et du contact. Le transcendantal investit ainsi
jusqu’aux modes de la sensibilité qui fait l’objet d’une conversion ontologique (la
tonalité, que nous aborderons plus loin). Dès lors, c’est bien le sens de la facticité
qui est mis en jeu dans le questionnement de la mobilité — et surtout de
l’immobilité — de la vie facticielle, dans la mesure où ce qui pose problème c’est
l’affirmation de la présence, dans le vécu concret, d’une charge de signification en
un sens déjà accomplie : ce à quoi il faut s’ouvrir c’est à ce qui, en étant déjà
accompli, doit donc bien être reçu et éprouvé ; mais d’autre part, ce sens déjà
accompli n’est pas autre, extérieur, mais essentiellement mien. Le sens ontologique
de l’existence est à recevoir, parce qu’il est déjà-là : le Dasein doit être réceptif à sa

Dasein, monde et mouvement chez Heidegger
3
propre activité projetante afin de se l’approprier. Voici là ce que nous avons à
établir.
Dans le cours du semestre d’été de 1925
2
, Heidegger attribue à Husserl trois
découvertes fondamentales pour la « percée phénoménologique » :
l’intentionnalité, l’intuition catégoriale, et l’inflexion donnée au sens de l’a priori.
L’élaboration phénoménologique de l’intentionnalité permet d’ouvrir la voie à
une appréhension non naturaliste des comportements psychiques et de leur relation
aux objets, c’est-à-dire qu’elle établit la corrélation d’une visée et d’un intentum,
objet visé qui n’est pas « extérieur » à la conscience, logé dans un monde physique,
mais le vis-à-vis direct de sa visée
3
, du fait que la conscience opère un « se-diriger-
sur… » et obtient son objet dans une coappartenance réciproque. Les processus
psychiques doivent ainsi être pensés comme des actes, dans lesquels est par
définition impliquée une relation intentionnelle avec, selon les niveaux, des choses
perçues, voulues, aimées, etc. et également avec d’autres actes (actes « fondés » sur
des actes « simples »). Heidegger porte au crédit de cette innovation un
élargissement
4
du voir au-delà de la perception purement sensible, élargissement
qui permettra de donner un statut ontologique à ce qui est perçu en tant que chose
du monde ambiant, caractère du monde pratique, tout ce qui apparaît sous le regard
naïf que tente toujours de réduire l’investigation théorique de la nature.
Du côté de l’intuition catégoriale, Heidegger dégage à partir de Husserl la
possibilité que le voir, dont les corrélats sont de plein droit dotés d’une présence et
d’un « là », puisse également et surtout saisir des catégories, c’est-à-dire des
relations logiques et des états de choses. À même les perceptions de choses
singulières sont donnés des caractères généraux (prédicats, relations) : si le voir est
légitimant
5
pour tous ses corrélats, alors nous « voyons » — au sens large et non
sensible — des catégories dans des propositions telles que « cette chaise est jaune
et rembourrée », à savoir « jaune », « rembourrée », « cette », « est », « et », etc.
Les prédicats et les relations de jugement — « l’idéal » — ne sont ainsi pas logés
« dans l’esprit » et ajoutés à la chose, mais visibles à même la chose donnée
6
. Les
actes de synthèse et d’idéation
7
sont ceux par lesquels le général est
intentionnellement visé à même la chose singulière (dans les premiers, les choses
singulières données dans la perception sensibles apparaissent d’emblée constituées
comme états de choses, c’est-à-dire investies par des caractères généraux ; dans les
seconds, la vision va directement viser l’idéalité, elle est une intuition donatrice du
général). On sait que Heidegger a puisé ici un certain élan pour conquérir la question
de l’être, dans la mesure où la possibilité d’une donation en personne des
caractéristiques générales des choses ouvre celle de saisir l’être lui-même. Mais on
peut aussi apercevoir que ce qui intéresse Heidegger ici, c’est le caractère
omniprésent de l’activité constituante, puisqu’à rebours de la tradition kantienne,
2
M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, in Gesamtausgabe, B.20 (GA20) ;
traduction française par Alain Boutot, Prolégomènes à l’histoire du concept de temps, Paris,
Gallimard, 2006.
3
Ibid., p. 36-46 ; trad. fr. p. 54-64.
4
Ibid., p. 51 ; trad. fr. p. 69 : « Quand nous disons : "nous voyons", nous ne prenons pas "voir" au
sens étroit de sensation optique, mais "voir" ne signifie rien d’autre que :"prendre simplement
connaissance de ce qui se trouve là"». On obtient ainsi le « perçu comme tel », c’est-à-dire ce qui se
présente et tel qu’il se présente, avant toute analyse objectivante et scientifique.
5
Ibid., p. 69-71 ; trad. fr. p. 86-87.
6
Ibid., p. 51-53 ; trad. fr. p. 93-95.
7
Ibid., p. 85-99 ; trad. fr. p. 101-115.

Dasein, monde et mouvement chez Heidegger
4
« les formes catégoriales ne sont pas des fabricats des actes, ce sont au contraire des
objets, lesquels deviennent visibles dans ces actes ». Ainsi, « "Constituer" ne veut
pas dire produire au sens de fabriquer et de confectionner, mais de faire voir l’étant
dans son objectivité »
8
. Il n’y a pas de matière passive faisant face à l’activité
organisatrice du sujet, mais des secteurs et des niveaux d’intuition plus ou moins
généraux et plus ou moins remplis, où le remplissement n’équivaut plus à une
réception passive mais à une forme de confirmation de la visée intentionnelle (c’est-
à-dire la mise en présence du visé, son actualisation, et non pas une prise de contact
avec un extérieur radicalement autre).
Enfin, l’explicitation du sens de l’a priori comme « saisissable directement en
lui-même »
9
, puisque non subjectif et corrélé à l’intentionnalité, est provisoirement
ajourné en raison de son lien avec le temps et l’être, lesquels sont précisément ce
qui est recherché et ne peut donc pas encore constituer un objet de discussion.
Or, ces trois acquis, Heidegger ne les remet pas en cause lorsqu’il expose
l’inflexion qu’il entend faire subir à la pensée husserlienne. Plus encore, il cherche
bien à en élargir la portée en vue de questionner la couche d’existence à partir de
laquelle seulement il peut y avoir de l’intentionnalité — ce qui s’appellera
questionner le sens d’être de celle-ci.
En effet, si Husserl a restreint le champ d’investigation phénoménologique à la
conscience théorétique et à ses opérations de connaissance, il faut alors conquérir
le champ où sont déjà actifs « les comportement sur lesquels la structure de
l’intentionnalité doit être recueillie »
10
. Or, c’est sur la base d’une révision de ce
que Husserl nommait l’attitude naturelle que le sens ontologique de
l’intentionnalité pourra apparaître. Cela signifie qu’entre rapidement, dans
l’intention de Heidegger, le projet de soumettre l’existence concrète de l’étant en
lequel l’intentionnalité se rencontre à une investigation phénoménologique. Car si
la phénoménologie se veut être un retour « aux choses mêmes », alors le champ des
comportements qui actualisent un déploiement de phénomènes est bien plus large
que celui des comportements de connaissance. L’a priori des structures
intentionnelles devra être cherché ailleurs que dans la sphère idéale de la conscience
pure, c’est-à-dire à partir de « l’étant lui-même » dans ses comportements
singuliers, pratiques, non théoriques, tels qu’ils se présentent dans l’attitude
naturelle. Or, du même coup, c’est le projet même de soumettre l’étant intentionnel
(déjà nommé, dans le cours, Dasein, ou « Dasein humain ») à une analyse
apriorique qui doit poser question.
Un tel problème s’annonce, comme nous l’avons indiqué, dans l’intention de
faire émerger la question de l’être à même les comportements concrets et quotidiens
qui composent « l’attitude naturelle ». Plus précisément, en logeant au sein même
des comportements quotidiens le lieu de constitution de la question de l’être,
Heidegger est conduit à inscrire des formes de vie contingentes et évolutives dans
un cadre authentifiant qui, par là, se donne pour fonction d’approprier à chaque
instant le Dasein à des possibilités a priori décrites comme « siennes ». Ne faut-il
donc pas questionner la levée elle-même du Dasein à partir de la réinterprétation de
l’attitude naturelle, c’est-à-dire questionner l’existentialité à partir de la contingence
des comportements qu’elle érige en transcendantaux ?
Chez Husserl, la contingence du monde des choses perçues dans l’attitude
naturelle est préservée, dans la mesure où l’analyse eidétique des différentes régions
8
Ibid., p. 97-98 ; trad. fr. p. 112-113.
9
Ibid., p. 102 ; trad. fr. p. 118.
10
Ibid., p. 131 ; trad.fr. p. 146.

Dasein, monde et mouvement chez Heidegger
5
de l’être
11
conduit à séparer radicalement la donation absolue de la région des vécus
et le mode d’être des choses transcendantes. Tandis que celles-ci, données et
organisées dans la perception, peuvent par essence être annihilées par la réflexion,
le vécu ne peut pas se nier lui-même. Les réductions phénoménologiques révèlent
à propos du monde naturel son essentielle contingence, la possibilité qu’il ne soit
pas (ou bien, moins radicalement, qu’il soit autre), quand bien même c’est le regard
de la conscience qui en constitue l’essence. Chez Husserl, la position absolue de la
conscience laisse place à la possibilité que le monde naturel, comme bain primitif
d’expérience puis comme « région », conserve une forme d’altérité dont rend
compte la conscience à travers l’intentionnalité spécifique qui lui correspond (la
transcendance).
Or, Heidegger cherche au contraire à étendre au monde naturel la présence d’une
activité intentionnelle déjà porteuse d’un sens ontologique. Le questionnement du
point de départ de la phénoménologie, du sol où elle se procure son champ
d’investigation (la conscience pure, par séparation d’avec le monde naturel), doit
pour Heidegger « être porté sur les déterminations d’être de l’étant dans lequel la
conscience et la raison se concrétisent, sur la détermination d’être de l’étant concret
appelé humain. »
12
Dans sa discussion avec Husserl, Heidegger retourne explicitement le regard
phénoménologique vers le sol de l’expérience « naturelle » pour montrer que celle-
ci n’a rien d’une position naïve d’un donné extérieur mais qu’au contraire les
comportements ordinaires « de l’étant concret appelé humain » sont animés par une
intentionnalité originaire et constitutive. Il faut dès lors que cette couche
d’expérience soit soumise à une investigation qui révèlera son a priori.
Or l’investigation phénoménologique de l’existence concrète peut-elle laisser
intacte cette couche d’expérience ? Lui conférer un sens ontologique ne revient-il
pas à perdre la possibilité de l’accidentel et du contingent, non pas au niveau
ontique, mais précisément sur le plan des formes « existentiales » de l’existence ?
Si celle-ci est de part en part investie de structures a priori, n’en ressort-il pas une
conception immobiliste de l’existence ? Puisque le sens de l’a priori implique une
« priorité » temporelle, celle de l’être sur l’étant, c’est-à-dire « la structure d’être de
l’être »
13
, peut-on loger au sein même de l’expérience concrète de l’homme une
constellation apriorique — laquelle manifeste « son indifférence spécifique vis-à-
vis de la subjectivité »
14
— sans perdre la possibilité que cette expérience continue
d’être une source imprévisible de formes d’existence ? Heidegger cherche à
déterminer comment « l’être de l’intentionnel est […] effectivement expérimenté »,
« dans une expérience qui n’a pas encore été modifiée théoriquement », laquelle est
« déjà présent[e] dans la posture qu’abandonnent les réductions »
15
à savoir
l’attitude naturelle. Mais comment permettre qu’une détermination originaire de
l’intentionnel dans son a priori fasse droit, en même temps, à une mobilité au niveau
de ces possibilités a priori elles-mêmes ? Ces possibilités peuvent-elles encore
changer, se reconfigurer ? Franco Volpi a indiqué en quoi la métaphysique du
Dasein s’avère être une reprise de l’analyse aristotélicienne de la praxis, avec pour
motif de montrer que le regard théorique de la conscience pure n’est pas la seule
11
E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie I, traduction française par Paul Ricoeur,
§42, 49, Paris, Gallimard, 1950.
12
GA20, p. 148 ; trad. fr., p. 161.
13
Ibid., p. 102 ; trad. fr. p. 118.
14
Ibid., p. 101 ; trad. fr. p. 117.
15
Ibid., p. 152 ; trad. fr. 166.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%