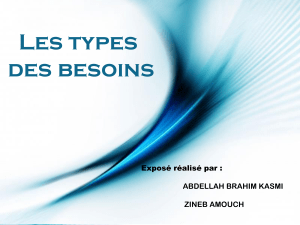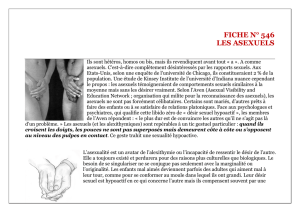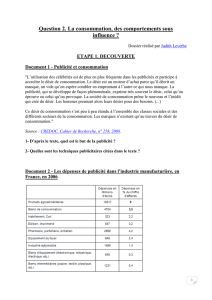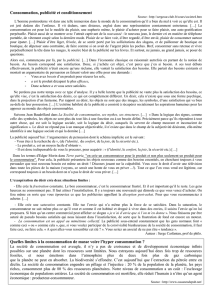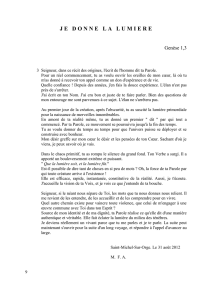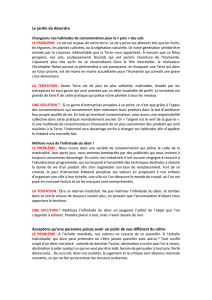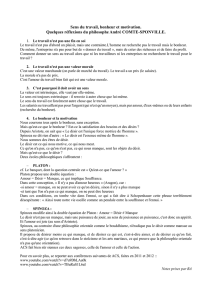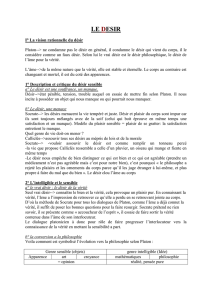Raphaël Badawi - Mémoire de Master 2 - Sur Maine de Biran. Le désir insensible
Telechargé par
badawiraphael

Raphaël BADAWI
Mémoire de Master II de Philosophie.
Année universitaire 2012-2013.
Soutenu à l’Université de Poitiers.
Sous la direction d’Alexandra ROUX.

2
Table des matières
Introduction – Lettre morte .................................................................................................................... 3
Première partie – De substantialisme à la question du désir ............................................................... 15
Biran, lecteur de Descartes ............................................................................................................... 15
Biran, lecteur des empiristes ............................................................................................................. 23
La conversion de Biran au biranisme ................................................................................................ 29
Deuxième partie – Le lieu secret du désir ............................................................................................. 40
Besoin, désir, volonté ........................................................................................................................ 40
Lové dans le berceau du système perceptif ...................................................................................... 44
Libido duplex ..................................................................................................................................... 52
Troisième partie – De la sécrétion de la foi ........................................................................................... 59
L’attente d’une conciliation .............................................................................................................. 59
Le saut à pieds joints : sur la prière ................................................................................................... 63
L’esprit du désir souffle où il veut ..................................................................................................... 71

3
Introduction – Lettre morte
Vous demanderiez mille ans durant à la vie "Pourquoi vis-tu ?", si elle pouvait répondre, elle ne dirait rien
d'autre que : "Je vis parce que je vis." La raison en est que la vie tire sa vie de son propre fonds et jaillit de ce qui
lui est propre : c'est pour cela qu'elle vit sans demander le pourquoi, parce qu'elle ne vit que d'elle-même.
Maître ECKHART, Sermon n°56.
Mais, si vous définissez, abstrayez, supposez et s'il en résulte que, d'après vos définitions, abstractions et
suppositions, il ne peut y avoir de liberté dans l'homme, et si vous en inférez que l'homme n'est pas responsable,
j'oserai me séparer de votre sens abstrait métaphysique pour en appeler au sens commun de l'humanité.
BERKELEY, Alciphron, VII, 18.
Une question fréquente en philosophie est celle-ci : « qu’est-ce qu’un acte libre ? »
Demander « ce qu’est », c’est demander l’essence, « ce que la définition dit que la substance est »
1
.
Or, peut-on réduire un acte à des qualités énumérables ? Lorsque je dis, par exemple, que la balle est
rouge, le prédicat « rouge » est déjà donné, déjà fait, je suis devant le fait accompli. Je ne suis pas
devant l’acte par lequel il se fait que la balle est rouge. Comment se fait-il que la balle est rouge ?
Nous voyons bien que réduire l’acte à l’essence, c’est le réduire à ce qu’il n’est en aucune façon.
« Qu’est-ce qu’un acte libre ? » est une question extraordinairement contradictoire. En effet, une
connaissance objective, parce qu’elle doit pouvoir faire l’objet d’un discours rationnel, doit être
essentiellement prédicative, et nous place de fait devant des choses effectuées, non devant
l’effectuation, et ce de façon parfaitement conséquente avec le caractère foncièrement après coup
du jugement prédicatif. Il n’est pas de science, entendue au sens traditionnel, de l’acte, et c’est sans
doute la raison pour laquelle la « science de l’homme » que cherchait Maine de Biran n’avait rien de
traditionnel.
Pourtant, la science du vivant, de ces êtres agissants, a très tôt eu conscience de la différence
de son objet par rapport à celui de la philosophie naturelle, mais elle a reconduit le présupposé d’une
description objective, si bien que nous ne pouvons que relever sa persévérance à reporter ad
infinitum la question de l’acte. La vie appartient à un autre ordre que les phénomènes mécaniques
dont Galilée élabore les lois en 1590 et dont Newton marque la consécration en 1687. Le corps
humain n’est pourtant pas une table de billards. La vie appartient à un autre ordre. C’est à la jonction
1
Etienne GILSON, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 1989, p. 70.

4
des XVIIème et XVIIIème siècles qu’avec Stahl
2
verront jour des interrogations en ce sens, et Kant fut
assurément celui qui exprima cette différence avec le plus de rigueur. Définissant la spécificité du
vivant, il écrit : « Ce principe, qui constitue en même temps la définition des êtres organisés, est le
suivant : un produit organisé de la nature est celui dans lequel tout est fin et aussi réciproquement
moyen. »
3
Tout d’abord, l’usage ici de l’expression « êtres organisés » n’est pas anodin. La notion
d’organisme a été inventée par Leibniz
4
, et à lire sa définition, on voit bien que le terme renvoie à un
ordre infiniment subtil des choses entre elles, et cet ordre, faute d’être conçu comme spécifique au
vivant, est du moins opposé à l’artefact. « L’organisme est essentiel à la matière, mais à la matière
arrangée par une sagesse souveraine. Et c’est pour cela que je définis l’Organisme, ou la Machine
naturelle, que c’est une machine dont chaque partie est machine, et par conséquent que la subtilité
de son artifice va à l’infini, rien n’estant assez petit pour être négligé, au lieu que les parties de nos
machines artificielles ne sont point des machines. »
5
La différence entre l’organisme et l’artefact se
situe à ce niveau que dans l’artefact, le composant n’est jamais qu’un moyen en vue du tout, et
diffère donc togo genere de celui-ci, alors que dans l’organisme, il n’y a pas cette différence. Comme
l’écrit Leibniz : « il faut qu’il y ait de l’organique dans ce qui représente l’organique. » Et comme
l’écrit à son tour Kant : « produit organisé de la nature dans lequel tout est fin et aussi
réciproquement moyen. » Il faut entendre ici que si le tout est fin, les parties qui participent de ce
tout ne le sont pas moins.
Ce rapprochement que nous effectuons entre Leibniz et Kant sur l’émergence de la notion
d’organisme n’est pas si forcé qu’il en a l’air. Nous nous excusons toutefois de nos grandes
insuffisances en la matière. Comme en témoigne la conclusion de ce fameux §66 de la Critique de la
faculté de juger : « Il est toujours possible que, par exemple dans un corps animal, maintes parties
puissent être comprises comme des concrétions d’après de simples lois mécaniques (comme la peau,
les os, les cheveux). Pour autant, force est de toujours juger de manière téléologique la cause qui
procure la matière appropriée, la modifie dans ce sens, lui donne forme et la dépose aux endroits
convenables, en sorte que tout dans ce corps doive être considéré comme organisé et que tout soit
aussi, à son tour, organe dans une certaine relation à la chose elle-même [nous soulignons]. » Une
2
Georg Ernet STAHL (1659 – 17 34), médecin allemand, est connu pour le développement de la théorie du
phlogistique, qui postulait pour expliquer la combustion l’existence d’une matière nommée phlogiston ; cette
théorie sera réfutée par Lavoisier en 1789. Il est également connu pour sa thèse de l’animisme dont nous
ferons cas plus bas.
3
Immanuel KANT, Critique de la faculté de juger, §66, Paris, GF, 1995, p. 368.
4
Du rapport général de toutes choses, A (Akademie-Ausgabe) VI iv, Berlin, 1999, p. 1615 : « Le rapport général
et exact de toutes choses entre elles, prouve que toutes les parties de la matière sont pleines d’organisme. Car
chaque partie de la matière devant exprimer les autres et parmy les autres y ayant beaucoup d’organiques, il
est manifeste qu’il faut qu’il y ait de l’organique dans ce qui représente l’organique. »
5
Lettre de Leibniz à Lady Masham du 30 juin 1704, in Die philosophischen Schriften, herausgegeben von C. I.
Gerhardt, Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1875-1890, réed. Hildesheim : G. Olms, 1978, vol. III, p. 356.

5
machine dont chaque partie est machine. Cette cause n’en a pas moins un statut problématique au
regard de la connaissance, puisqu’il s’agit chez Kant d’un produit de l’imagination, et non de
l’entendement : il s’agit d’un jugement réfléchissant – comme un miroir réfléchit le faisceau
lumineux – de l’imagination, subsumé après coup sous le pouvoir des concepts, sans être en lui-
même un concept que la raison utilise légitimement pour connaître le monde. L’expérience y est
réfléchie, elle n’y est pas déterminée, si bien que des notions comme celle d’organisme (de « finalité
interne dans les êtres organisés ») ne peuvent servir que de « fil conducteur »
6
pour cheminer à
travers les phénomènes dont la description mécanique est trop complexe pour notre finitude
7
. La
cause de la finalité interne de l’organisme échappe donc à l’expérience, elle est un postulat de travail,
nous ne l’observons nulle part en tant que telle. Revenons-en au §66. Kant écrit que « ce concept [à
prendre ici dans un sens général, pas au sens propre à la philosophie spéculative de Kant] conduit ici
la raison dans un tout autre ordre de choses que celui d’un simple mécanisme de la nature, qui ne
parvient plus ici à nous satisfaire […] dès lors que nous rapportons un tel effet [un produit de la
nature], dans sa globalité, à un fondement de détermination suprasensible [nous soulignons] situé
au-delà du mécanisme aveugle de la nature, il nous faut aussi juger cet effet tout entier d’après ce
principe [etc.] » Le principe à l’œuvre est invisible. En voulant fonder scientifiquement la spécificité
du vivant, la pensée se brise contre les récifs du visible, et doit recueillir l’écume de l’invisible. Cela
était déjà le cas chez Stahl et Barthez, et il est intéressant de voir en quoi l’interprétation qu’ils
proposent est du point de vue du biranisme finalement impropre à la connaissance de l’acte libre,
demeure au creux de l’idéal d’une connaissance prédicative, et partant pourquoi il est nécessaire de
se frayer un autre chemin.
« Stahl le premier, rappelle Maine de Biran, se plaça dans le point de vue le plus
diamétralement opposé à ceux qui prétendaient appliquer les lois d’un pur mécanisme, aux fonctions
de la vie et de l’organisme. »
8
C’est qu’il voyait dans les phénomènes physiques des mouvements
calculables à l’avance en fonction de la quantité de matière et de la force
9
, tandis que dans les
phénomènes organiques, il voyait « les mouvements variables à chaque instant persister, s’arrêter,
renaître et s’interrompre encore sans cause extérieure, et par la pure spontanéité de leur force
6
Critique de la faculté de juger, op. cit., §72 .
7
Ibid., §71 : « Mais que, par rapport à notre faculté de connaître, le simple mécanisme de la nature ne puisse
pas non plus fournir de fondement d’explication pour la production d’êtres organisés, c’est tout aussi
indubitable pour certains. » C’est au sein même de l’expérience que sa détermination est bornée par notre
finitude, et que la place est ménagée pour la croyance, sous la forme de jugements réfléchissants dont la valeur
est essentiellement heuristique.
8
BIRAN Maine de, Rapports du physique et du moral chez l’homme, Œuvres complètes, T. VI, Paris, Vrin, p. 28.
Nous citerons dorénavant, en ce qui concerne les œuvres de Biran, et sauf mention du contraire, cette édition
placée sous la direction de H. Gouhier et F. Azouvi, en donnant la tomaison et la pagination précédées de la
mention A. Ici par exemple : A VI, 28.
9
Stahl prenait donc sur ce point comme référence Newton, et non Descartes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
1
/
84
100%