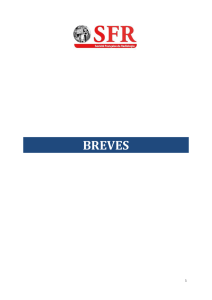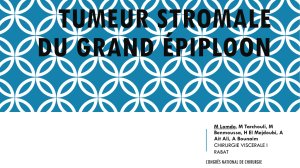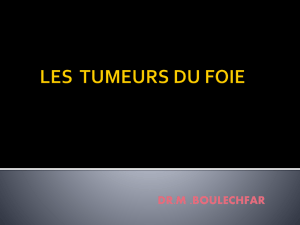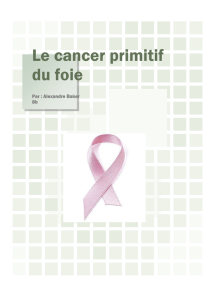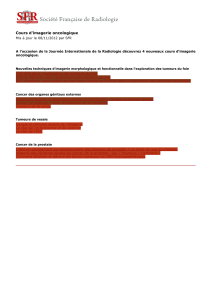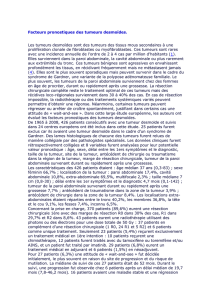Tumeurs bénignes du foie - Chirurgie

SOMMAIRE
Organisateurs :
J. HARDWIGSEN (Marseille)
1. Du diagnostic au traitement des tumeurs bénignes du foie : évolution des
concepts
J. HARDWIGSEN (Marseille)
2. Nature des tumeurs bénignes les plus fréquentes
J. CALDERARO (Paris)
3. Quelle stratégie iconographique doit-on mettre en œuvre après la
découverte d’une tumeur supposée bénigne du foie (tumeurs kystiques et
solides) ?
A. LUCIANI (Créteil)
4. Les adénomes hépatocellulaires : anatomopathologie et choix
thérapeutiques
J. CALDERARO (Paris)
5. Synthèse : le rôle du chirurgien (diagnostique, prise en charge, traitement)
A. LAURENT (Créteil)

DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT DES TUMEURS BENIGNES DU FOIE :
EVOLUTION DES CONCEPTS
Jean HARDWIGSEN
Service de chirurgie générale et transplantation hépatique, Aix-Marseille Université,
Hôpital de la Conception, 147 boulevard Baille, 13005 Marseille
Tel : 04 91 38 36 57 - fax : 04 91 38 16 55 - e-mail : jean[email protected]
Les tumeurs bénignes du foie sont nombreuses (plus de cent types différents ont été
colligés (1)), variées, de présentation et d’évolution différentes. Leur diagnostic comme leur
traitement peuvent être complexes, parfois mal codifiés et très souvent guidés par la crainte
de méconnaitre une tumeur maligne (2).
Cette rhétorique de "sous-traiter" une pathologie potentiellement grave doit être pondérée par
les risques de "sur-traiter" une pathologie bénigne qui dans la grande majorité des cas ne sera
même pas évolutive.
L'accès facilité et généralisé à des procédés d'imageries performants permet de découvrir des
lésions hépatiques de plus en plus petites. Que ce soit dans le cadre d'un bilan d'extension de
cancers, pour l'exploration d'une symptomatologie abdominale ou de manière fortuite, le
chirurgien, très souvent sollicité lors de la découverte d'une tumeur du foie dispose : du
contexte épidémiologique, des données biologiques et des informations iconographiques pour
décider d'un recours à une biopsie avant de choisir : entre l'abstention thérapeutique, une
surveillance ou l'exérèse (ou la destruction) de la tumeur.
Par ailleurs, des études récentes de cohortes ont confirmé le faible risque évolutif de la plupart
des tumeurs bénignes du foie, dont l’histoire naturelle a été mieux caractérisée : impact des
modifications de taille, risques de dégénérescence maligne et de complications létales
(hémorragie). De fait, le recours à une exérèse chirurgicale diagnostique ou thérapeutique
diminue dans le temps (3). En parallèle, le développement des procédés de chirurgie mini-
invasive a complété l’offre de soins. La chirurgie du foie par cœlioscopie connaît une place
grandissante et reconnue qui mérite d’être précisée pour cette indication (4).

Quelle est la place de l'exérèse tumorale ?
Les principales indications justifiant le recours à une résection chirurgicale pour une tumeur
supposée bénigne sont au nombre de trois (5) :
– l’incertitude diagnostique,
– le traitement de symptômes rattachés à la présence ou au développement tumoral,
– la prévention de complications « majeures » (hémorragie et transformation maligne).
Plus rarement la requête d’un patient anxieux peut justifier d'une résection tumorale (6).
Ce recours, après un bilan exhaustif, est estimé à 1 cas sur 5 ; les 2/3 des indications sont
liées à l'incertitude diagnostique (3)
Une résection pour incertitude diagnostique
En dehors de l’HNF typique, de l’angiome et du kyste biliaire simple, aucun examen
radiologique, quelle que soit sa performance, n’apporte de diagnostic formel. Le doute persiste
dans 10 à 40 % des cas (6) et le recours à une biopsie doit être envisagé. Outre l’information
primordiale sur l’éventuelle malignité, cette biopsie doit permettre de distinguer le type de TBF
pour en adapter le suivi (7). Hormis les risques d’hémorragie sur le trajet de ponction ou de
dissémination tumorale (estimé à 2 % environ (8)), l’obtention d’une information inadéquate
ou erronée n’est pas négligeable. La performance de cette procédure était estimée au début
des années 2000 à 30 % (9). La biopsie par voie percutanée des lésions hypervascularisées
n’est pas recommandée ; il en est de même pour les tumeurs de petite taille (9). La
concordance, entre les résultats issus d’une biopsie à l’aiguille et les spécimens opératoires,
serait de 35 à 40 % (6). Une biopsie « chirurgicale » par cœlioscopie autorise un « large »
prélèvement histologique ; sa sensibilité est de l’ordre de 80 % et sa valeur prédictive positive
de 100 % (10). Cette large biopsie, en fonction du diagnostic final, ne règle pas le choix de
l’exérèse à proposer. Par ailleurs, les tumeurs centrohépatiques ou situées dans les segments
postérieurs du foie ne sont pas toujours d’un accès facile.
Une résection pour traiter des symptômes
En présence d'un patient symptomatique, la découverte d'une (ou plusieurs) tumeur(s) du foie
doit systématiquement aboutir à la question de l’imputabilité du développement de cette lésion

dans la genèse des signes. Bien que le rôle de l’exérèse comme traitement des tumeurs
bénignes symptomatiques soit souligné par plusieurs publications (issues d’études non
contrôlées), des précautions sont nécessaires. Des explorations à la recherche de pathologies
intriquées (principalement gastriques ou lithiasiques) sont utiles (11) tout en conservant en
mémoire que la corrélation entre taille tumorale et symptômes aspécifiques (dyspepsie, toux,
douleurs...) est non établie dans bon nombre des cas (5). Par prudence, en présence d'une
tumeur de petite taille, une période d’observation, durant laquelle une résolution des
symptômes est possible, est souhaitable (11).
Parmi les symptômes, la douleur représente environ deux tiers des indications (12).
Récemment, une analyse bicentrique de mesure de la qualité de vie pour des patients opérés
d’une tumeur bénigne du foie (12) a souligné que l’amélioration des scores de la douleur se
prolongeait dans le temps à 6 mois et à 1 an, qu’elle est d’autant plus importante que la douleur
préopératoire était intense, et que la laparoscopie apportait un bénéfice significatif à 6 mois et
à 1 an mais pas à 1 mois.
Une résection pour prévenir une complication
Les deux complications majeures observées comme révélatrices ou lors du suivi de tumeurs
bénignes sont la transformation maligne et l'hémorragie.
- Seules deux tumeurs ont un potentiel dégénératif connu: l'adénome hépatocellulaire et le
cystadénome hépatobiliaire. Les recherches menées sur les adénomes (13, 14) dans les
années 2000 ont permis de caractériser une sous- population à risque de cancérisation (celle
porteuse de la mutation de la béta caténine) : une biopsie et une recherche de cette mutation
sont devenues des standards de leur prise en charge (15). En ce qui concerne les
cystadénomes hépatiques, la dégénérescence est difficile à établir au début : hors cas
caricaturaux, la transformation partielle d'un cystadénome peut être méconnue par les
données iconographiques (échographie, TDM, IRM, Pet Scan…), biologiques et des examens
plus spécifiques comme une analyse du contenu kystiques (marqueurs tumoraux ou cellules
malignes). Une fois le diagnostic de cystadénome établi (ou suspecté comme souvent), la
résection complète de la lésion est recommandée (2).
- En pratique "quotidienne" l'hémorragie intra tumorale et ou intra péritonéale est l'apanage
des adénomes. Le risque théorique lié à la taille (au-delà de 50 mm de diamètre) a été
complété par une détermination des sous populations issues de l'analyse moléculaire à risque,
justifiant une nouvelle fois du recours "systématique" à la biopsie des adénomes (16).

Une surveillance : oui, mais…
Si l’amélioration des procédés d’imagerie hépatique et une meilleure connaissance de
l’histoire naturelle des tumeurs bénignes du foie autorisent plus fréquemment une surveillance,
les modalités et la durée de celle-ci ne sont pas clairement précisées (3, 11). L’équipe du
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center à New York prône un contrôle par IRM 3 à 6 mois
après la découverte de la tumeur incidentale, puis un intervalle entre 2 examens de 6 mois à
1 an en fonction de la stabilité lésionnelle (3). Finalement lors de la surveillance sur des
périodes d’observation inférieures à 5 ans, un changement de stratégie a été rare car une
résection justifiée par une modification lésionnelle n’a été pratiquée que dans 5 à 7,5 % (3, 17)
des cas.
Dans bon nombre de cas la découverte d'une tumeur bénigne du foie ou supposée telle
nécessite des examens complémentaires pour établir un diagnostic précis qui dictera les choix
thérapeutiques. Cependant la difficulté de ce diagnostic peut justifier d'examens
progressivement invasifs. La discussion pluridisciplinaire est dans ces situations
recommandée. Le recours à des centres experts décidant des choix stratégiques intriquant la
surveillance, les actes biopsiques ou les résections chirurgicales, est conseillé.
Références
1. Cong WM, Dong H, Tan L, Sun XX, Wu MC. Surgicopathological classification of
hepatic space-occupying lesions: a single-center experience with literature review. World J
Gastroenterol. 2011;17(19):2372-8.
2. Hardwigsen J, Laurent A. Tumeurs bénignes du foie. Rapport du 115e Congrès
français de chirurgie. Arnette ed2013.
3. Mezhir JJ, Fourman LT, Do RK, Denton B, Allen PJ, D'Angelica MI, et al. Changes
in the management of benign liver tumours: an analysis of 285 patients. HPB: the official
journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association. 2013;15(2):156-63.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%