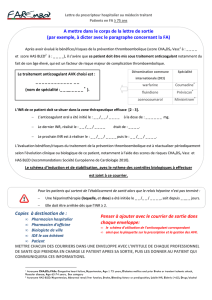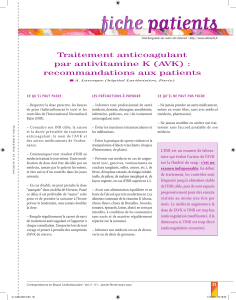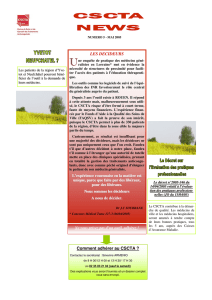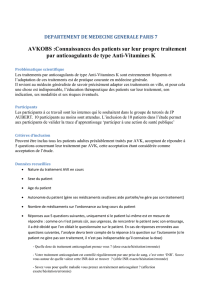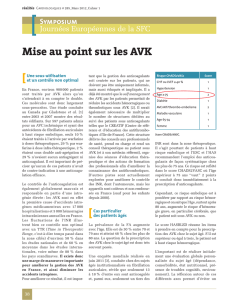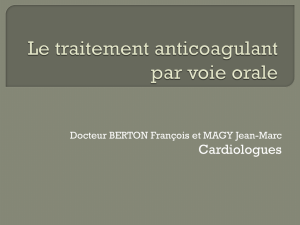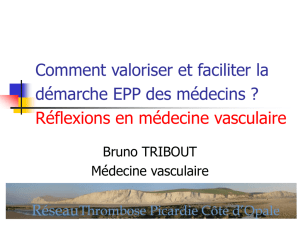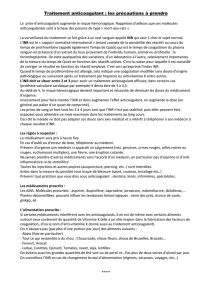Lire l'article complet

La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002
27
n France, 1 % de la population (600 000 patients envi-
ron) reçoit des antivitamines K (AVK), dans deux tiers
des cas pour une cardiopathie (fibrillation auriculaire,
valvulopathie, infarctus du myocarde) et dans un tiers des cas
pour une maladie thromboembolique veineuse. Quatre-vingt-dix
pour cent des traitements anticoagulants sont surveillés par le
médecin généraliste.
Les anticoagulants oraux sont aujourd’hui de plus en plus utili-
sés, car leurs indications augmentent et concernent essentielle-
ment les sujets âgés, dont l’espérance de vie s’allonge (1)
(tableau I). Ainsi, dans le cas de la fibrillation auriculaire (FA),
qui s’accroît régulièrement avec l’âge pour toucher près de 10 %
des sujets de plus de 80 ans, les anticoagulants permettent de
réduire de deux tiers les accidents thromboemboliques artériels,
notamment cérébraux, en prévention primaire et secondaire (2).
C’est également le cas de la pathologie veineuse thromboembo-
lique, dans laquelle l’âge représente le principal facteur de risque
acquis, l’incidence annuelle passant de 1/10 000 avant 40 ans à
1/1 000 après 75 ans (3) ; les anticoagulants y sont utilisés en trai-
tement curatif et en prévention du risque de récidive, lequel
dépend de l’existence ou non de facteurs de risque thromboem-
boliques veineux identifiés et de la durée du traitement anticoa-
gulant (4) (tableau II).
LES RISQUES LIÉS AUX TRAITEMENTS
ANTICOAGULANTS
Par crainte essentiellement du risque hémorragique potentiel, les
AVK restent insuffisamment prescrits en regard des indications,
sans que soit pris en compte le bénéfice potentiel en termes de
réduction d’événements thromboemboliques (5).
Le risque lié aux traitements anticoagulants peut se concevoir à
deux niveaux : efficacité insuffisante et risque hémorragique.
Le risque hémorragique et ses facteurs
Le risque hémorragique d’un traitement anticoagulant est le plus
redouté, en particulier le risque d’hémorragie majeure ou fatale.
Ce risque est apprécié de façon variable selon la définition adop-
tée et le profil de risque des patients inclus dans les études (6).
La plupart des auteurs distinguent hémorragies mineures et
hémorragies majeures, définies comme fatales ou mettant en jeu
le pronostic vital (hémorragies cérébrales ou rétropéritonéales),
MISE AU POINT
Comment réduire le risque
lié aux anticoagulants ?
●I. Mahé, A.S. Grenard, J.F. Bergmann*
*Service de médecine A, hôpital Lariboisière, 75475 Paris Cedex 10.
E
Tableau I. Indications des AVK et INR cible, d’après (1).
Indications INR cible
Prophylaxie de thrombose veineuse profonde
(chirurgie à haut risque)
Traitement de thrombose veineuse profonde
Traitement d’embolie pulmonaire
Prévention d’embolies systémiques 2-3
Valves cardiaques
Cardiopathie valvulaire
Fibrillation auriculaire
Prothèse cardiaque mécanique 2,5-3,5
Valve mécanique aortique à ailettes 2-3
Tableau II. Récurrences thromboemboliques après un premier épisode de
thrombose veineuse profonde selon le contexte de survenue et la durée du traite-
ment par anticoagulants oraux (4).
Nombre Durées Récurrences
Études
de patients
Contexte de traitement Suivi (%)
comparées
Schulman 887 1er épisode 6 sem./6 mois 2 ans
18,1 vs 9,5
1995 (20) OR = 2,1
p < 0,001
Kearon 162 1er épisode 3 mois/2 ans 10 mois 27,4 vs 1,3
1999 (21) idiopathique p < 0,001
Schulman 227 Récidive 6 mois/indéfinie 4 ans
20,7 vs 2,6
1997 (22) RR = 8
p < 0,001
Agnelli
267 Idiopathique 3 mois/12 mois 3 ans
À 12 mois : 8 vs 0,7
2001 (23) (p = 0,003)
À 3 ans : 15,8 vs 15,7
(p = NS)

ou associées à une chute définie d’hémoglobine nécessitant la
transfusion d’une quantité définie de culots globulaires ou une
hospitalisation (6). Les complications hémorragiques majeures
surviennent chez 2 à 5/100 patients par année de traitement et
sont fatales chez 0,1 à 0,7/100 patients par année de traitement
(7).Toutefois, dans des essais évaluant les anticoagulants dans la
FA, l’incidence annuelle de saignements majeurs chez les patients
avec un INR cible entre 2 et 3 a été d’environ 1,3 % versus 1 %
dans le groupe placebo (5), mais les sujets inclus dans ces études
étaient a priori exempts de facteurs de risque hémorragique et
bénéficiaient d’une surveillance rapprochée.
En France, une enquête du Réseau national de pharmacovigilance
a été réalisée en 1997, un jour donné, dans un échantillon repré-
sentatif d’hôpitaux publics, afin d’estimer la prévalence des réac-
tions secondaires liées aux médicaments : elle a révélé que les
AVK motivaient 13 % du nombre total des hospitalisations pour
effet iatrogénique et que plus de 17 000 patients par an étaient
hospitalisés pour un accident hémorragique lié aux AVK (8).
Le risque hémorragique lié au traitement par AVK dépend essen-
tiellement de l’intensité du traitement, de sa durée, des carac-
téristiques du patient et des associations médicamenteuses
(aspirine notamment).
L’intensité du traitement anticoagulant est le principal déter-
minant du risque d’hémorragie cérébrale, indépendamment de
l’indication de l’anticoagulation ; ce risque augmente dès que
l’INR dépasse 3, et plus encore au-delà de 4, en particulier chez
les sujets de plus de 75 ans (5, 6). Le meilleur rapport réduction
d’événements thromboemboliques/risque hémorragique s’ob-
serve pour un INR entre 2 et 3, que ce soit chez les patients en
FA chronique (9) ou chez ceux atteints d’une pathologie veineuse
thromboembolique (10) (tableau I).
L’incidence d’accidents hémorragiques majeurs dépend aussi lar-
gement de la durée du traitement anticoagulant ; elle semble
plus importante au début du traitement : 3 % pendant le premier
mois, puis 0,8 % par mois pendant la première année, puis 0,3 %
par mois ensuite (11).
Les caractéristiques du patient (âge ≥75 ans, antécédent de
saignement digestif, hypertension traitée, pathologie cérébro-
vasculaire, cardiopathie sévère, insuffisance rénale, néoplasie)
sont susceptibles de majorer le risque hémorragique des AVK.
L’âge ≥75 ans est un facteur de risque hémorragique discuté, car
il est difficile de le distinguer de celui lié aux pathologies asso-
ciées, plus fréquentes à cet âge. Le risque d’hémorragie cérébrale
semble cependant majoré chez le sujet âgé, surtout de plus de
75 ans, quand l’INR dépasse la zone thérapeutique (5). Si, selon
certains auteurs, une prise en charge rapprochée du traitement
anticoagulant (clinique d’anticoagulation par exemple) pourrait
permettre de ramener le risque hémorragique des sujets âgés au
niveau de celui des sujets plus jeunes (12, 13), d’autres ne sont
pas de cet avis et considèrent tous les sujets âgés comme étant à
risque hémorragique élevé (14). Dans tous les cas, un sujet âgé
présentant une indication aux AVK et un rapport bénéfice/risque
a priori favorable doit être impérativement surveillé de manière
rapprochée.
Enfin, l’association d’AVK à des anti-inflammatoires non sté-
roïdiens, et surtout l’aspirine en raison de sa durée d’action pro-
longée, majore le risque hémorragique des AVK par inhibition
de la fonction plaquettaire, ces traitements pouvant par ailleurs
générer des érosions ou ulcérations gastriques à l’origine de
saignements digestifs (1).
Manque d’efficacité du traitement anticoagulant
En partie, au moins, à cause de la crainte d’accidents hémorra-
giques et de la prescription de posologies suboptimales qui en
découlent, les anticoagulants ne permettent pas d’éviter toutes les
récidives thromboemboliques veineuses (4)(tableau II) ni de pré-
venir tous les accidents thromboemboliques liés à la FA (4).Ainsi,
l’analyse des résultats des essais de prévention par les anticoa-
gulants dans la FA chronique montre que les AVK permettent de
réduire le taux annuel d’accidents vasculaires cérébraux de 4,5 %
à 1,5 % en prévention primaire (réduction de risque relatif : 68 %,
nombre nécessaire de sujets à traiter pendant un an pour éviter
un événement : 32) et de 12 % à 4 % en prévention secondaire
(réduction de risque relatif : 66 %, nombre nécessaire de sujets à
traiter pendant un an pour éviter un événement : 13) (2). C’est
pourquoi de nouvelles voies thérapeutiques ont été developpées.
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LIMITER
LE RISQUE DES ANTICOAGULANTS
La campagne d’information de l’AFSSAPS
sur le bon usage des AVK
Devant l’ampleur du risque hémorragique du traitement anticoa-
gulant, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS) a lancé une campagne d’information sur le bon
usage des AVK qui a débuté en janvier 2001. Elle est destinée à
tous les acteurs concernés : patients, spécialistes, médecins géné-
ralistes, paramédicaux (infirmières, biologistes, pharmaciens),
CNAM, industriels. Une conférence pour la presse profession-
nelle a été tenue, dont le contenu est disponible sur le site Inter-
net de l’AFSSAPS (www.afssaps.sante.fr).
La notice d’information destinée aux patients a été particulière-
ment développée et a mis l’accent sur la nécessité de la sur-
veillance de l’INR et sur le risque des associations médicamen-
teuses et de l’automédication. Une information grand public
figure également sur le site Internet de l’AFSSAPS.
L’ensemble des médecins (cardiologues, angiologues, généra-
listes, biologistes) et des pharmaciens a reçu un courrier de mise
au point sur les AVK. Ils disposent également des mentions légales
à travers un schéma d’AMM commun à cette classe et d’une fiche
de transparence, notamment sur les messages essentiels suivants :
iatrogénicité, respect des indications et évaluation du rapport
bénéfice/risque, contrôle mensuel de l’INR, interactions médi-
camenteuses et alimentaires, information et éducation du patient.
L’impact de cette campagne sera évalué par trois enquêtes épi-
démiologiques réalisées avec le Réseau national de pharmaco-
vigilance avant et après la mise en place de ces mesures.
La première vise à déterminer le niveau des INR et la fréquence
des INR non adaptés ainsi que la périodicité de leurs mesures en
fonction des résultats précédents (en phase d’équilibration ou de
La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002
28
MISE AU POINT
.../...


suivi). Elle sera menée auprès de laboratoires d’analyse médicale
privés et publics par un questionnaire soumis à un échantillon
représentatif.
La deuxième, effectuée auprès des pharmaciens, concerne la
compréhension par les patients de l’indication et de la surveillance
de leur traitement, au moyen d’un questionnaire remis à chacun
des 5 premiers patients se présentant avec une ordonnance d’AVK.
La troisième a pour objectif de mesurer l’incidence des hospi-
talisations pour accident vasculaire cérébral hémorragique dans
les services de neurochirurgie, et se fera sur 3 000 entrants (le
nombre annuel d’entrées dans ces services est estimé à 90 000).
L’expérience des cliniques d’anticoagulation
Pour tenter de réduire le risque d’accidents iatrogéniques liés aux
anticoagulants, le concept de clinique d’anticoagulation (CAC)
a été développé, aux Pays-Bas, puis en Italie.
Les CAC ont trois objectifs principaux : l’éducation du patient,
une aide à l’équilibration et à la surveillance du traitement anti-
coagulant assistée par informatique, une fonction de conseil en
cas de situations plus complexes, comme la survenue d’une patho-
logie intercurrente ou d’une complication liée au traitement. Leur
fonctionnement repose sur une équipe associant des médecins,
des biologistes et une infirmière (figure).
Les données de la littérature, qui ne fournissent que des analyses
rétrospectives d’études cas-contrôles ou descriptives, ne permet-
tent pas une évaluation exacte de l’effet de ces CAC. Malgré ces
limites, les résultats semblent très encourageants. Ainsi, dans une
enquête prospective conduite par la Fédération italienne des CAC,
le nombre des accidents hémorragiques majeurs sous AVK a été
estimé à 1,1 pour 100 patients-années (15), alors qu’il était de 4,9
pour 100 patients-années dans une méta-analyse portant sur des
études rétrospectives (7).
Les CAC permettent aussi de réduire les accidents thrombotiques,
liés le plus souvent à un traitement insuffisant. En comparant une
série de 271 patients porteurs de valves cardiaques suivis dans
une CAC à 271 patients ayant une prise en charge traditionnelle,
Cortelazzo a montré que l’incidence des accidents hémorragiques
majeurs, mais aussi des accidents thrombotiques, était significa-
tivement inférieure chez les patients suivis dans les CAC : 1,0 %
versus 4,7 % et 0,6 % versus 6,6 % respectivement (16).La dimi-
nution du nombre des hospitalisations pour accidents thrombo-
tiques et hémorragiques pourrait donc avoir un impact écono-
mique favorable (6).
Alors que les CAC se sont largement développées dans certains
pays voisins, la seule expérience française est celle de Toulouse,
même si d’autres projets sont actuellement en cours et pourraient
prochainement voir le jour.
Intérêt de l’autosurveillance du traitement
anticoagulant
L’autosurveillance du traitement anticoagulant, voire l’adapta-
tion des doses par les patients eux-mêmes grâce à un appareil uti-
lisable à domicile, pourrait également permettre une surveillance
plus régulière et rapprochée des INR (5),limiter le risque de varia-
bilité des mesures liée à la technique utilisée selon les labora-
toires et impliquer davantage le patient dans son traitement, ce
qui améliore souvent sa compliance. Cependant, ces méthodes,
qui nécessitent une compréhension, une adhésion et une partici-
pation importantes au traitement ne sont pas utilisables chez tous
les patients.
Des études ont montré qu’il n’y avait aucune différence entre
l’INR des patients se surveillant seuls et celui des patients suivis
dans leur laboratoire habituel, et que les sujets pratiquant l’auto-
surveillance passaient significativement plus de temps dans la
zone d’INR cible que ceux suivis dans des CAC (6).
Pour élargir l’idée de la prise en charge du traitement anticoagu-
lant par les patients eux-mêmes, il est concevable que les patients
mesurant leur INR puissent adapter par la suite la posologie
d’AVK. Cette méthode permettrait d’obtenir plus longtemps
l’INR cible, avec moins de modifications de dose et en laissant
présager moins de complications hémorragiques (6).
VERS DE NOUVELLES VOIES THÉRAPEUTIQUES
Pour améliorer le rapport bénéfice/risque des anticoagulants en
traitement curatif et préventif des pathologies thrombotiques arté-
rielles et veineuses, de nouvelles stratégies thérapeutiques ont été
développées (17-19). Elles se sont essentiellement axées
sur trois cibles privilégiées : la thrombine, le facteur Xa et le
complexe facteur tissulaire/VII activé.
L’avenir peut donc laisser espérer la possibilité de faire appel à
de nouveaux antithrombotiques au mécanisme d’action plus spé-
cifique. Certains d’entre eux pourront offrir non seulement un
rapport bénéfice/risque plus intéressant par rapport aux anticoa-
gulants actuels, mais aussi plus de maniabilité, du fait de leur
administration plus pratique. ■
La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002
30
MISE AU POINT
Laboratoire de référence (charte)
FAX
Clinique d’anticoagulation
(gestion informatisée de l’INR, date du prochain contrôle)
FAX
Médecin traitant
Patient
Figure. Fonctionnement de la CAC de Toulouse.
…/…

La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002
31
MISE AU POINT
Bibliographie
1. Hirsch J, Dalen JE, Anderson DR et al. Oral anticoagulants : mechanism of action,
clinical effectiveness, and optimal therapeutic range. Chest 2001 ; 119 : 8S-21S.
2.Albers GW, Dalen JE, Laupacis A et al. Antithrombotic therapy in atrial fibril-
lation. Chest 2001 ; 119 : 194S-206S.
3. Drouet L. Pathologie thromboembolique veineuse. Nouveaux facteurs de
risque acquis ou nouvelles données sur les facteurs de risque acquis. Arch Mal
Cœur 2001 ; 94 : 1318-26.
4. Ferrari E, Schiano N, Benhamou M, Baudouy M. Durée du traitement AVK dans
la pathologie thromboembolique veineuse. Arch Mal Cœur 2001 ; 94 : 1307-12.
5. Levine M, Raskob G, Landefeld S, Kearon C. Haemorrhagic complications of
long-term anticoagulation therapy. Chest 2001 ; 119 : 108S-121S.
6. Ansell J, Hirsch J, Dalen J et al. Managing oral anticoagulant therapy. Chest
2001 ; 119 : 22S-38S.
7. Landefeld CS, Beyth RJ. Anticoagulant-related bleeding : clinical epidemiolo-
gy, prediction and prevention. Am J Med 1993 ; 95 : 315-28.
8. Imbs JL, Pouyanne P, Haramburu F et al. Iatrogénie médicamenteuse : estima-
tion de sa prévalence dans les hôpitaux publics français. Therapie 1999 ; 54 : 21-7.
9. Hylek EM, Skates SJ, Sheehan MA et al. An analysis of the lowest effective
intensity of prophylactic anticoagulation for patients with nonrheumatic atrial
fibrillation. N Engl J Med 1996 ; 335 : 540-6.
10. Hyers TM, Agnelli G, Hull RD et al. Antithrombotic therapy for venous
thromboembolic disease. Chest 2001 ; 119 : 176S-193S.
11. Landefeld CS, Goldman L. Major bleeding in outpatients treated with war
fa-
rin : incidence and prediction by factors known at the start of outpatient therapy.
Am J Med 1989 ; 87 : 144-52.
12. Mc Cormick D, Gurwitz JH, Goldberg J et al. Long-term anticoagulation
therapy for atrial fibrillation in elderly patients ; efficacy, risk and current
patterns of use. J Thromb Thrombolysis 1999 ; 7 : 157-63.
13. Copland M, Walker ID, Tait RC. Oral anticoagulation and haemorrhagic
complications in an elderly population with atrial fibrillation. Arch Intern Med
2001 ; 161 : 2125-8.
14. Pengo V, Legnani C, Noventa F, Palareti G, ISCOAT Group. Oral anticoagu-
lant therapy in patients with nonrheumatic atrial fibrillation and risk of bleeding.
Thromb Haemost 2001 ; 85 : 418-22.
15. Palareti G, Leali N, Coccheri S et al. Bleeding complications of oral anti-
coagulant treatment : an inception-cohort, prospective collaborative study
(ISCOAT). Italian Study on Complications of Oral Anticoagulant Therapy. Lancet
1996 ; 348 : 423-8.
16. Cortelazzo S, Finazzi G, Viero P et al. Thrombotic and hemorrhagic compli-
cations in patients with mechanical heart valve prosthesis attending an anticoa-
gulation clinic. Thromb Haemost 1993 ; 69 : 316-20.
17.Weitz JI, Hirsch J. New anticoagulant drugs. Chest 2001 ; 119 : 95S-107S.
18. Lecompte T. Les nouveaux médicaments antithrombotiques (activateurs du
plasminogène exclus). Arch Mal Cœur 2001 ; 94 : 1225-32.
19. Drouet L, Gruel Y, Mismetti P. Les nouveaux antithrombotiques. STV 2000 ;
12 (n° spécial) : 48-55.
20. Schulman S, Rhedin AS, Lindmarker P et al. A comparison of six weeks with
six months of oral anticoagulant therapy after a first episode of venous thrombo-
embolism. N Engl J Med 1995 ; 332 : 1661-5.
21. Kearon C, Gent M, Hirsch J et al. A comparison of three months of anticoa-
gulation with extended anticoagulation for a first episode of idiopathic venous
thromboembolism. N Engl J Med 1999 ; 340 : 901-7.
22. Schulman S, Granqvist S, Holmström M et al. The duration of oral anticoa-
gulant therapy after a second episode of venous thromboembolism. N Engl J Med
1997 ; 336 : 393-8.
23. Agnelli G, Prandoni P, Santamaria MG et al. Three months versus one year
of oral anticoagulant therapy for idiopathic deep venous thrombosis. N Engl
J Med 2001 ; 345 : 165-9.
1
/
5
100%