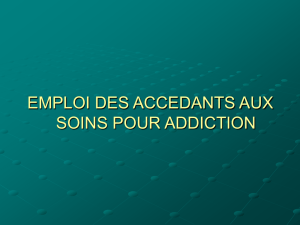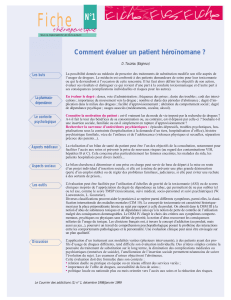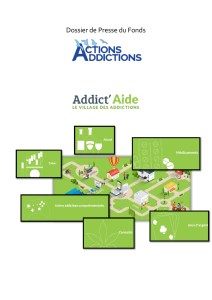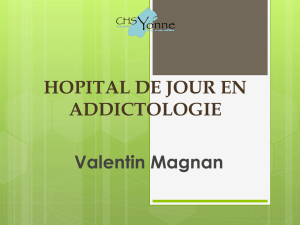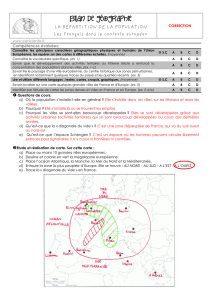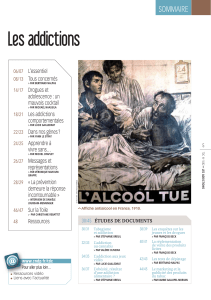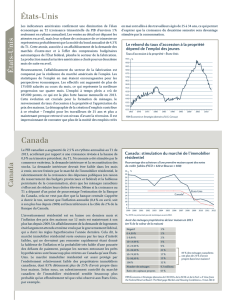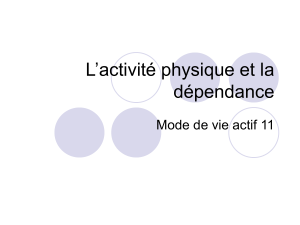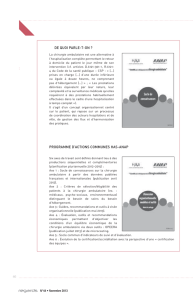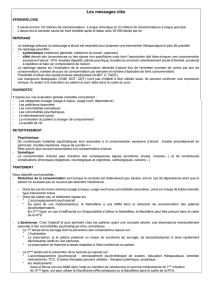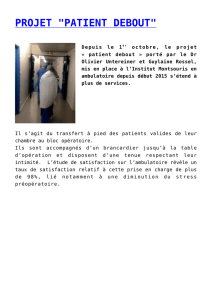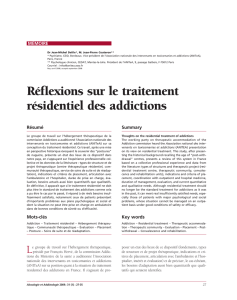D P '

Le Courrier des addictions (13) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2011 26
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
4XHOOHRULHQWDWLRQ
SRXUTXHOSDWLHQW"
Les critères de placement en hébergement
résidentiel (voir encadré "Un outil d’aide à
l’orientation") proposent une orientation fon-
dée sur l’évaluation de la situation des patients
au travers de six dimensions cliniques, psycho-
logiques et sociales : nature de la consomma-
tion et nécessité de prise en charge médicale
pour une aide au sevrage ou un traitement de
substitution ; condition physique, problèmes
physiques (hors sevrage) ou facteurs physiques
et traitements à prendre en compte… ; troubles
émotionnels et comportementaux, antécé-
dents psychiatriques éventuels… ; situation
du patient dans sa dynamique de changement
par rapport à son addiction conditionnant
l’adhésion au traitement ; niveau de risque
de rechute du patient et de connaissance par
rapport à la nature et à la dynamique de son
* Président de la Fédération addiction, pyschologue
clinicien, CSAPA, Mantes-la-Jolie.
** Vice-président de l'European Federation of Therapeutic
Communities (EFTC), fondateur du réseau européen
d’échanges de savoirs (ECE Training by Travel : projet
d’échange de connaissances fondé sur le partage de
bonnes pratiques et sur le compagnonnage entre les pays
de l’Union européenne). Licencié en communications so-
ciales, directeur de l’association Trempoline (communauté
thérapeutique en Belgique).
Place de la communauté thérapeutique
dans l’indication d’un soin résidentiel
Ou comment les aider à gérer leurs stress
et leur détresse sans substance
Jean-Pierre Couteron*, Georges Van Der Straten**
Les approches thérapeutiques des addictions ne peuvent plus reposer sur un standard
unique, comme on l’a connu avec le sevrage et l’abstinence. Pour autant, "le projet
abstinence" doit rester une des réponses plurielles adaptées à la diversité des "entrées"
dans les comportements addictifs (recherche de performance, auto-thérapeutique, hé-
donisme, gestion de la douleur…), mais également graduées, adaptées à la notion de
cycle motivationnel et de projet de vie, ouvrant des accès correspondant aux différentes
étapes de leur trajet.
Une telle ouverture dans l’approche de la prise en charge des sujets rend d’autant plus
important la question de l’indication du cadre de traitement. Celle-ci doit tenir compte
des substances consommées, de l’intérêt de l’orientation résidentielle versus ambu-
latoire et de l’objectif visé : abstinence, réduction des risques ou autres. Elle découle
du dialogue avec l’usager, qui permet de préciser ses capacités à coopérer avec l’offre
de traitement, à en bénéficier, s’abstenir d’user de drogues et éviter des conduites de
risques, dans le cadre le moins restrictif possible. Enfin, elle tiendra compte également
de l’existence ou de la disponibilité de la structure adéquate…
problème de dépendance ; environnement du
patient (logement, quartier), social (réseau de
soutien, organismes sociaux) et financier (re-
venu, recherche d’emploi).
Pour chacune de ces dimensions, le niveau de
gravité oriente la prise en charge de l’abus et de
la dépendance dans un continuum de services
classés par degré de gravité, allant de l’inter-
vention précoce, puis au traitement ambula-
toire, à l’ambulatoire intensif ou hospitalisa-
tion partielle, pour terminer par le traitement
résidentiel ou l’hospitalisation et, enfin, l’hos-
pitalisation intensive.
Cela permet d’identifier quatre types de be-
soins : sociaux et sanitaires pouvant être trai-
tés par les dispositifs de droit commun (mé-
decine de ville, centres ambulatoires, services
sociaux de secteur…) : c’est la politique des
mêmes droits pour tous ; besoins sanitaires qui
"passent" devant les sociaux et nécessitent un
primat du médical et inversement, primat des
besoins sociaux qui induisent celui de l’inser-
tion ; besoins sanitaires et sociaux également
primordiaux qui demandent une inscription
du soin dans le projet de vie.
Pour que ces parcours de l’usager soient pos-
sibles, une conception commune doit relier les
différents acteurs potentiellement impliqués.
L’appel au dispositif de droit commun nécessite
la formation de l’ensemble des acteurs sanitaires
et sociaux, afin que l’addiction ne soit plus un
motif de rejet des personnes et de non-traite-
ment de situations parfois systématiquement
renvoyées aux dispositifs spécialisés. De même,
la formation des personnels des dispositifs so-
ciaux (centres d’hébergement et de réinsertion
sociale [CHRS], hébergement d’urgence, mai-
sons relais, résidences sociales…) devrait faci-
liter la prise en charge de ces personnes dont la
problématique addictive n’obère pas la capacité
d’insertion (c’est le cas de personnes en traite-
ment ambulatoire ou stabilisées).
Les dispositifs sanitaires (services hospitaliers,
service de soins de suite et de réadaptation…)
interviennent lorsque la problématique sani-
taire est dominante pour prendre en charge
les sevrages, les soins résidentiels complexes et
leurs suites, incluant les problématiques psy-
chiatriques contemporaines de l’addiction. Ils
s’articulent avec les dispositifs médico-sociaux
intervenant après stabilisation de la personne,
soit sur le court terme (hébergement d’urgence,
quand il faut "mettre à l’abri" et aider la per-
sonne à prendre conscience de son besoin de
soins) soit le moyen terme (centre thérapeu-
tique résidentiel, appartement thérapeutique,
familles d’accueil) ou le long terme (commu-
nautés thérapeutiques) [CT]. Il s’agit alors de
personnes nécessitant un suivi rapproché et un
accompagnement dans leur insertion sociale et/
ou professionnelle, pour les aider à intégrer le
soin dans leur projet de vie par une réorgani-
sation de leur vie. Ces dispositifs ont vocation
à rester "généralistes", tout en tenant compte
des publics et des problématiques particulières
nécessitant l’adaptation de certains d’entre eux.
/·LPSDFWGHVSURGXLWV
GDQVOHFKRL[GXFDGUH
Bien sûr, l’orientation tient compte aussi des
substances, notamment pour ce qui est du choix
entre soin ambulatoire et résidentiel. Ainsi, le ta-
bac comme le cannabis relèvent d’un traitement
essentiellement ambulatoire. En dehors des se-
vrages complexes, la plupart des prises en charge
pour abus ou dépendance d’alcool peuvent être
conduites en ambulatoire ou en hospitalisation
de jour. La prise en charge résidentielle concerne
des patients à très haut niveau d’usage d’alcool,
polytoxicomanes ou ayant des comorbidités mé-
dicales ou psychiatriques, ou encore des usagers
qui ont connu des échecs antérieurs de prises en
charge ambulatoires et dont l’état se détériore.
Pour la cocaïne, hors polytoxicomanie, un trai-
tement ambulatoire global et intensif est efficace,
le résidentiel pouvant fonctionner comme un
temps d’appui.
Enfin, pour les opiacés, si l’hospitalisation est
indiquée en cas de cures de sevrage complexes,
les risques élevés de rechute imposent un suivi
continu. Les traitements de substitution sont
d’une remarquable efficacité quand ils sont
prodigués dans un cadre ambulatoire global et

Le Courrier des addictions (13) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2011
27
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
contrôlé. Comme dans le cas des patients dé-
pendants de l’alcool, le traitement résidentiel
est utile pour ceux qui on eu des antécédents
répétés de rechute, une désocialisation, des
troubles médicaux ou psychiatriques associés,
un environnement socio-familial défavorable.
/HVWURLVSXEOLFV
L’attente des usagers est aussi un facteur im-
portant dans le choix de l’orientation. Selon le
lieu auquel s’adresse cette attente des usagers
(Centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction de risques pour usagers de drogues
[CAARUD], Centres de soins d’accompagne-
ment et de prévention en addictologie [CSAPA],
cabinet du médecin), l’offre de prise en charge
peut aller d’un bout à l’autre d’un continuum de
propositions. L’hébergement n’est pas une prio-
rité pour tous les usagers et leur demande d’hé-
bergement peut-être inversement proportion-
nelle à celle des soins. Une étude conduite par
des étudiants de l’université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne pour la Fédération addiction dé-
crit ainsi trois types de public (2).
Le premier est inscrit dans la société, en
lien avec sa famille. Même avec des éléments
de désaccords, celle-ci reste un soutien plus ou
moins régulier qui l’aide à intégrer les repères
sociaux. Ces usagers ont acquis une sécurité
matérielle et affective. Ils ont suffisamment
de repères pour s’inscrire dans une démarche
professionnelle, disposent d’un logement et de
revenus. C’est suite à une rupture, un accident
de vie professionnelle ou familial, que le désir
de soins se fait jour. Ils sont actifs dans la re-
cherche d’une solution, demandeur d’une prise
en charge structurée, soucieux de préserver leur
insertion professionnelle et peuvent souhaiter
un certains confort dans le soin résidentiel.
Deuxième "public", désocialisé, struc-
turé en marge de la société, à double dépen-
dance: pour celui-ci, les ruptures scolaires et
familiales ont eu lieu à un âge précoce. Il ne
dispose donc pas des mêmes repères sociaux.
Il cumule précarité, absence de logement, de
profession ou d’expérience professionnelle et il
conserve peu de lien avec sa famille. Il vit dans
les groupes de pairs, en fait plutôt des groupes
d’auto-reforcement. Ces sujets ont donc des
difficultés à accéder aux structures de soins,
que d’ailleurs ils sollicitent peu, et relèvent
plus de l’approche réduction des risques. Ils
se sentent également exclus des dispositifs de
l’urgence sociale et de l’insertion dont ils récu-
sent les exigences : ils refusent la promiscuité
des dortoirs et l’obligation d’intégrer le lieu en
début de soirée. La complexité des démarches
pour y accéder finit par les en dissuader. Un
hébergement en chambre d’hôtel s’est déve-
loppé, mais ce sont souvent des taudis qui ne
les aident pas à se détacher de leurs réseaux et
ils s’y sentent mal considérés. En fait, ils sont
demandeurs d’une mise à l’abri (sleep in)…
Entre les deux, on rencontre un public
intermédiaire, avec des repères sociaux,
mais dépendant actuellement du groupe de
pairs. Il ne demande pas un logement et arrive
à conserver le sien, mais il attend du soin rési-
dentiel une évolution de ses conduites.
'HO·KpEHUJHPHQWVRFLDO
DXVRLQUpVLGHQWLHO
Ou encore : de la lutte contre l’exclusion à la
prise en compte de la conduite addictive.
Pour préciser l’indication, il n’est donc pas
inutile de revenir sur trois des paramètres qui
fondent le soin résidentiel : changement d’en-
vironnement, durée du séjour et programme
thérapeutique. Il est donc indiqué pour des
patients dont la vie et les interactions sociales
se sont totalement organisées autour de l’usage
de substances, quand la dépendance physique
et le craving sont renforcés par l’attachement
à un mode de vie. La perte de compétences
sociales et professionnelles, le manque de mo-
tivation personnelle et/ou d’un soutien social
fragilisent l’acquisition et le maintien d’une
abstinence, complète ou partielle, dans le seul
cadre ambulatoire. L’offre de soins résidentiels
procure alors un environnement nouveau,
sans drogues, dans lequel les résidents peu-
vent développer leurs aptitudes personnelles et
"groupales" à prévenir la rechute.
Sur l’autre versant du continuum des réponses
proposées, l’hébergement social offre des
éléments comparables, mais avec comme fi-
nalité de lutter contre l’exclusion qui conduit
à privilégier un autre public, pour lequel le
logement est un support de l’insertion, d’une
démarche de remobilisation. L’arrêt de l’usage
de substance n’y est pas forcément un préa-
lable ou une condition d’accès. Du squatt ou
de l’errance à des hébergements collectifs, c’est
bien aussi d’un changement d’environnement
dont il est question, dans cet hébergement qui
apporte un soutien transitoire selon une du-
rée également variable. Enfin, si la notion de
programme thérapeutique n’est pas centrale,
celles de progression, d’évolution du sujet ne
sont pas absentes d’hébergements qui sont
tout sauf des lieux où l’usager serait enfermé
sur ses usages ! À partir de l’expérience acquise
avec les publics des squatts, des pratiques nou-
velles prolongent et complètent l’expérience
des sleep in, sur le mode du housing first, ou
d’une insertion et d’une aide au logement qui
précède et s’autonomise d’une décision d’abs-
tinence (3). Ces projets reposent sur le concept
de rétablissement, issu d’une revendication
des personnes souffrant de troubles psychia-
triques sévères et luttant pour accéder à une
citoyenneté pleine et entière. Il est aujourd’hui
devenu ensuite une nouvelle façon d’organiser
les soins dans le champ de la santé mentale. Le
programme "Un chez-soi d’abord" est une dé-
clinaison autour des problématiques particu-
lières des personnes sans chez-soi.
Le changement d’environnement du soin ré-
sidentiel convient aux patients dont le réseau
social s’est structuré uniquement autour des
produits et qui ne bénéficient pas du soutien
qu’il apporte dans le processus de rémission
(4). Le changement proposé va d’un isolement
complet ou relatif à une vie en pleine nature ou
une confrontation quotidienne à la vie sociale,
une abstinence souhaitée ou une tolérance
des usages. Avec, comme dénominateur com-
mun, la capacité de ce nouvel environnement
à fournir à des patients qui, autrement, n’ont
pas accès à de tels soutiens, des points d’ap-
pui plus solides sur les plans émotionnel, rela-
tionnel (équipe et groupe de pairs) mais aussi
médical et psychiatrique. Un environnement
qui permet des soins plus intensifs, durables
et contrôlés ainsi qu’un support social et un
travail de réinsertion plus suivi. On retrouve
donc la double finalité possible de l’accom-
pagnement : confrontation au comportement
addictif et/ou offre d’un étayage social et en-
vironnemental, ou savant équilibre des deux.
La littérature internationale souligne l’intérêt
particulier d’approches adaptées à des publics
spécifiques : personnes présentant des comor-
bidités psychiatriques, détenus/sortants de
prison, femmes enceintes et dyades mère-en-
fant, adolescents et jeunes addicts en errance
(avec chiens…).
Quant il s’agit d’admission et de séjour en
centre résidentiel, un engagement clair est
nécessaire. L’usager doit bien en connaître la
finalité, tant pour ne pas se fourvoyer que par
respect des choix faits par les autres usagers.
La durée du soin résidentiel est à relier à sa
finalité et au délai nécessaire pour que l’usa-
ger remplisse les critères spécifiques prédictifs
d’une transition réussie vers un autre cadre
de traitement. Ces critères peuvent inclure la
démonstration d’une motivation réelle à s’en-
gager dans un programme ambulatoire à la
sortie, l’aptitude à rester abstinent dans des
situations où les drogues sont potentiellement
disponibles (sorties de week-ends, travail de
réinsertion à l’extérieur du centre, sorties non
accompagnées, etc.), un cadre de vie soutenant
à l’extérieur (famille, pairs abstinents, emploi,
etc.), une stabilisation suffisante des comor-
bidités médicales et psychiatriques. Si aucune
étude ne permet de fixer une durée optimale
de prise en charge, une durée d’au moins
3mois est associée aux meilleurs résultats (5).
SURJUDPPHWKpUDSHXWLTXH
OHFDVGHVFRPPXQDXWeV
Troisième composante importante de la pro-
position de soin résidentiel, son programme
thérapeutique, particulièrement bien forma-
lisé par le dispositif des CT. C’est celui-ci que

Le Courrier des addictions (13) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2011 28
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
nous voulons ici présenter, autour de la notion de
réhabilitation, dont la mode récente peut parfois
perturber une appréhension trop idéologique.
Le terme de communauté thérapeutique, utilisé
aux alentours de la Seconde Guerre mondiale
par Maxwell Jones et Harold Bridger, définit
un processus thérapeutique de groupe mis en
œuvre auprès de patients psychiatriques. Plus
proche de nous, l’un des co-auteurs de cet ar-
ticle, Georges Van der Straten, voit dans la CT,
dédiée spécifiquement aux pratiques addictives,
une "institution thérapeutique qui privilégie l’in-
tensification des relations entre soignants et soi-
gnés comme principal outil thérapeutique" (6). Il
s’agit bien d’un lieu de vie auquel un usager peut
s’adresser, avec ou sans indication médicale, et
qui s’organise autour de tâches, d’actions collec-
tives, loisirs et groupes de parole. Elle se définit
comme un centre résidentiel de long séjour qui
procure un environnement sûr et sans drogues
(drug free) à des personnes dépendantes (opia-
cés, stimulants, alcool, polytoxicomanies…).
Mais elle va plus loin : elle fournit aux patients
des éléments de restructuration, à travers la vie
communautaire, par des modèles identificatoires
positifs et la pression groupale (modeling). Cette
action va aider les résidents à développer leurs
capacités à gérer leurs stress et leur détresse sans
substance, à reprendre confiance en eux-mêmes.
Par une responsabilisation croissante, elle les
replace sur les rails de l’autonomie et de la re-
socialisation. C’est donc la vie en communauté
et le travail en groupe qui vont être le principal
support de l’évolution du patient et de la réhabi-
litation espérée. Le travail pédagogique au quoti-
dien, l’intégration aux normes du groupe et l’ad-
hésion au modèle fourni par les autres résidents
plus avancés dans le programme, conduisent
le sujet à mieux se connaître lui-même, identi-
fier ses vulnérabilités, facteurs de rechute, pour
mieux y faire face par lui-même et avec le soutien
du groupe (7).
L’intensité du processus collectif qui rend la
liberté de l’interrompre très difficile, est l’une
des grandes difficultés du fonctionnement des
CT qui peut conduite à des dérives totalitaires.
Les CT sont aujourd’hui majoritairement or-
ganisées selon un modèle hiérarchique strict,
même si le modèle démocratique n’en n’est pas
totalement absent. Le modèle hiérarchique orga-
nise la structure de la communauté (fonction et
missions de chacun), alors que le démocratique
dynamise le travail de groupe, de confrontation,
qui se déploie de personne à personne (8). Les
résidents accèdent à des statuts et des niveaux de
responsabilité croissants au fur et à mesure que
leur comportement témoigne d’un réel respect
des personnes et des règles collectives (notam-
ment l’abstinence de produits). Les principes
fondamentaux de la communauté thérapeu-
tique restent la coresponsabilité, la progressivité
de l’évolution et le cadre apporté par des règles
claires et explicitées. Cette crainte des dérives
sectaires a été corrigée par le portage profession-
nel qui est devenu la règle. En France, le cahier
des charges garantit le droit des usagers et le res-
pect de la laïcité.
Une deuxième difficulté vient du fait que les
objectifs de rétablissement d’un séjour ne se li-
mitent pas à la seule réalisation et la stabilisation
de l’abstinence. Il s’agit également de développer
des changements de style de vie et de l’iden-
tité sociale et personnelle par des programmes
thérapeutiques, qui vont des 12 étapes des
Narcotic Anonymous (NA) aux programmes
spécifiques de telle ou telle CT. Dans cet espace-
temps structuré et sécurisant, le résident rejoue
effectivement ses difficultés à gérer son stress et
ses conflits, ses problèmes d’affirmation de soi
et d’attachement, qui sont autant de facteurs de
rechute, afin d’apprendre à y faire face. Le sou-
tien communautaire vise par les réunions collec-
tives permettant des échanges sur l’expérience
de chacun, à réduire les mécanismes de déni ou
de projection qui relativisent l’impact négatif
des usages de substances dans la vie du sujet et
celle de ses proches. Ces groupes se réunissent
chaque jour pour aborder les comportements
concrets observés et les émotions ressenties dans
la vie communautaire (9). Face à cette crainte
d’un formatage comportemental, les CT, telles
qu’elles fonctionnent aujourd’hui, répondent
que le travail d’apprentissage et de découverte
de soi se fait en lien avec la vie en société, pour
permettre une intégration sociale et un retour
dans la vie "normale".
7URLVPRLVGHVpMRXUHQ&7
F·HVWXQPLQLPXP
Les données internationales mettent en évi-
dence une bonne efficacité de l’approche CT
mais pour les personnes qui vont au bout du
programme, c’est à dire 15 à 25 %. La plupart
des abandons ont lieu dans les trois premiers
mois de séjour. Les études de follow-up indi-
quent qu’un minimum de 3 mois est nécessaire
pour obtenir des premiers bénéfices et que la
durée de séjour optimale est largement supé-
rieure : 6 ou plutôt 12 voire 24 mois (10-12). Ces
programmes communautaires ont des taux de
rechutes plus faibles et obtiennent de meilleurs
résultats que les programmes ambulatoires. Des
travaux récents mettent en valeur l’intérêt d’as-
socier approche communautaire par les pairs
et prise en charge psychiatrique (y compris par
traitement de substitution aux opiacés) pour
traiter les problèmes duels, addictologiques et
psychiatriques. Pour des raisons voisines, cette
approche semble également être l’une des op-
tions les plus efficaces pour la prise en charge de
toxicomanes sortant de prison (13).
8QYUDLHpGXFDWLRQ
GXFRPSRUWHPHQW
Dans une époque hyper-moderne où la question
de la "contenance" se repose de plus en plus vi-
goureusement, interrogeant jusqu’au rôle de la
médicalisation dans les réponses proposées, la
communauté thérapeutique assume la fonction
d’"éducation du comportement". Elle vient renou-
veler une contenance sociale en partie perdue
(14). Chacun y est sous le regard d’un autre, dès
lors qu’il est dans l’exercice de ses compétences
sociales (15). Tous les membres de la CT sont
des observateurs quotidiens du fonctionnement
des autres et peuvent encourager la personne à
expérimenter de nouvelles habilités relation-
nelles ou sociales. La confrontation des compor-
tements et la proposition d’attitudes alternatives
sont des leviers thérapeutiques. Ils deviennent
habituels, presque routiniers car progressifs, ré-
pétés et soutenus dans le temps.
Mais le bon fonctionnement des groupes dépend
de la garantie d’un climat secure et de l’intégra-
tion par tous du concept de "responsabilité". Ce
concept de "responsabilité partagée" correspond
à la transmission par les anciens de la culture
de la CT (valeurs, conventions et habitudes)
aux nouveaux arrivants ainsi qu’à la vérification
de son maintien. Ces derniers représentent des
modèles d’évolution pour les jeunes résidents, ce
qui peut renforcer leur motivation et les rassurer.
Donald Ottenberg parle de la notion "d’amour
responsable" là où les CT américaines insistent
sur le "concern", c’est-à-dire cette attention, cette
capacité à être solidaire, soucieux de l’autre.
Le récent débat sur les salles de consommation
à moindre risque, a montré en France la diffi-
culté à ne pas se servir d’une approche pour en
disqualifier une autre. Ainsi que le remarque le
Pr Rowdy Yates (université de Stirling, Écosse)
dans une communication faite par l’un d’entre
nous en 2010, la dernière décennie a vu la ré-
surgence de l’intérêt pour la réhabilitation. Il
attribue ce mouvement autant à une évolution
des politiques publiques qu’à celle des attentes
des usagers des services de soins. En France, la
création des CT s’est ainsi faite, non dans l’op-
81287,/'·$,'(O·25,(17$7,21
Pour effectuer le choix du cadre de traitement, on peut s’appuyer sur le travail de l’Association
américaine de psychiatrie, publié dans e American Journal of Psychiatry (16). Ses recom-
mandations précisent la place du cadre résidentiel de traitement, en accord avec le consensus
de l’American Society of Addiction Medicine (ASAM) sur les critères de choix du cadre de trai-
tement (ASAM Patient Placement Criteria, ASAM-PPC-2R) et de son algorithme décisionnel
validé (16). Ils ont été déterminés à partir d’études visant à s’assurer que les usagers bénéficient
du niveau de soins approprié, afin d’éviter aussi bien la mise en place de sous-traitements inef-
ficaces que de surtraitements inutiles et onéreux.

Le Courrier des addictions (13) – n ° 1 – janvier-février-mars 2011Le Courrier des addictions (13) – n ° 1 – janvier-février-mars 2011
29
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
'
P
D
V
T
position aux traitements de substitution et à la
réduction des risques, mais pour les compléter
par une offre de soin résidentiel et sa proposition
d’accompagnement vers l’abstinence. L’abandon
du standard unique permettrait aujourd’hui
que se juxtaposent l’hébergement d’insertion
avec son concept de rétablissement et la com-
munauté thérapeutique avec celui de réhabili-
tation. Ils seraient reliés par une offre de soins
résidentiel déclinant des programmes théra-
peutiques différents, adaptés à des publics di-
versifiés aux demandes toutes aussi variées.
v
Références bibliographiques
1. Delile JM, Couteron JP. Réflexion sur le traitement
résidentiel des addictions. Alcoologie addictologie
2009;31(1):27-35.
2. La place de l’hébergement thérapeutique dans le
parcours de vie des usagers de drogues. De la parole
de l’usager à l’évaluation du dispositif, Université Pa-
ris-Est Créteil Val-de-Marne, UFR Sciences de l’Edu-
cation et Sciences Sociales , ANDESI-ENS, diplôme
d’État d’ingénierie sociale.
3. Klingemann H, Sobell L. Promoting self-change
from addictive behaviors, pratical implications for
policy, prevention and treatment. Springer 2007.
4. Housing first.
5. APA, idem.
6. Van Der Straten G, Broekaert E et al. La nouvelle
communauté thérapeutique. Apprendre à vivre sans
drogues n’est pas une utopie. Academia-Bruylant,
1997, 2008.
7. Farges F, Patel P. Les communautés thérapeutiques
pour toxicomanes. Revue documentaire toxibase, 22.
8. Broekaert E, Vandevelde S, Soyez V, Yates R, Slater
A. e third generation of therapeutic communities:
e early Development of the TC for Addictions in
Europe. Eur Addict Res 2006;12:1-11.
11. Delile J-M, Bourgeois M. Les Communautés
érapeutiques aux USA. Interventions (Revue de
l'ANIT). 1994;46:28-33.
12. Bourgeois M, Delile J-M, Rager P, Peyré F. Les
"Communautés thérapeutiques" pour toxicomanes.
Bilan et évaluation des soins. Annales Médico-Psy-
chologiques. 1987;145(8):699-704.
13. Couteron JP. Discours d’ouverture des 30èmes
journées de l’Anitea. Grandir avec les addictions.
2009. A publier dans Psychotropes, Janvier 2010.
14. Bauman Z. La décadence des intellectuels. Des
legislateurs aux interprètes. Traduit de l’anglais par
Manuel Tricottaux. Actes Sud, 2007.
15. Donald Ottenberg. e TC essentials. Internatio-
nal Symposium on Substance Abuse Treatment and
Special Groups “Community as Method”. Den Haan,
Vakgroep Orthopedagogiek Gent, 1999.
/HWDEDJLVPHSDVVLIDOWpUHUDLWO·DXGLWLRQ
vLes effets du tabac ont déjà été associés à une perte auditive,
mais pas ceux du tabac fumé par les autres. C’est ce qu’ont
cherché à évaluer les membres de l’équipe de K.J. Cruiks-
hanks. Ils ont donc fait passer un examen audiométrique à une popu-
lation de 3 000 non-fumeurs volontaires âgés de 20 à 69 ans. Puis les
sujets ont, d’une part, mentionné leur exposition antérieure au bruit
et, d’autre part, à la cigarette. Le degré de perte auditive a été mesuré
en testant la capacité à entendre des sons dans diverses gammes (fré-
quences basses ou moyennes et hautes fréquences). Résultat : l’expo-
sition passive au tabagisme est associée à une perte significative de
l’audition dans les basses, moyennes et hautes fréquences, et cela de
façon d’autant plus nette que l’exposition était importante et que les
sujets étaient des anciens fumeurs. Conclusion : les anciens fumeurs
ont une probabilité plus élevée d’altération de l’audition, ils perdent
14 % dans les fréquences basses ou moyennes et 46 % dans les fré-
quences élevées.
Fabry DA, Davila EP, Arheart KL et al. Secondhand smoke exposure and the risk
of hearing loss. Tob Control 2011;20(1):82-5.
6DOOHVGHFRQVRPPDWLRQ
O·$FDGpPLHGH0pGHFLQHHVWFRQWUH
vS’exprimant "à propos d'un projet de création en France de
salles d'injections pour toxicomanes", Roger Nordmann, au
nom de la Commission VI "Addictions" de l’Académie natio-
nale de médecine le 11 janvier dernier, a dit non ! L’Académie de mé-
decine se dit pourtant "totalement consciente de la nécessité pour les
toxicomanes de bénéficier, comme tous les malades, d’une attention vi-
gilante et de l’empathie de l’ensemble du corps médical". Mais elle juge
que ce projet de structures "réputées expérimentales (…), aurait pour
effet de sortir, de facto, les drogues les plus détériorantes du statut illi-
cite où elles sont actuellement et de remettre ainsi en question l’image
répulsive qu’il convient de leur conserver pour éviter toute confu-
sion dans la population dans son ensemble et, en particulier, chez les
jeunes". L’Académie de médecine a pris cette décision à l’issue de
l’audition de plusieurs experts et de l’analyse des résultats des expé-
riences menées à l’étranger, dans des pays pratiquant une politique
de réduction des risques différant notablement de celle conduite en
France. "On ne peut demander à des médecins de superviser ou même
de se livrer à de telles 'intoxications médicalement assistées', ce d’au-
tant plus que les 'drogues de la rue' peuvent correspondre à des mé-
langes de toxicité potentiellement mortels. En cautionnant, même in-
directement, l’injection d’une solution non stérile d’une substance non
identifiée, le médecin superviseur engagerait sa responsabilité, qu’elle
soit personnelle ou administrative. Les moyens matériels inévitable-
ment importants que mobiliserait cette initiative seraient bien mieux
utilisés pour renforcer les actions de prévention et d’aide au sevrage.
On dispose, en effet, de médicaments de substitution et de centres
spécialisés dont l’usage doit s’inscrire dans un schéma thérapeutique
d’administration dégressive visant à une meilleure adaptation sociale
et, à terme, à l’abstinence", a précisé l’Académie de médecine.
Communiqué du 11 janvier 2011.
'HS/XVHQSOXVG·$9&SDUPL
OHVWR[LFRPDQHVGHUXH
vL’incidence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) a beau-
coup augmenté entre 1994 et 2007 chez les plus jeunes, selon
une étude épidémiologique rendue publique à Los Angeles
par les Centers for Disease Control of Prevention américains lors du
congrès international sur l’AVC de février dernier (American Heart
Association). Ainsi, dans la tranche d’âge des 15 à 34 ans, le nombre des
hospitalisations pour ischémies dues à des AVC a augmenté de 17 %
chez les jeunes femmes et de plus de 50 % chez les jeunes hommes.
Dans le même temps, l’incidence des AVC a notablement baissé chez
les sujets d’âge moyen et âgés. À ceci, beaucoup d’explications, dont,
bien sûr, l’augmentation de l’incidence de l’obésité, de l’hypertension
artérielle, mais aussi les consommations de sel et de boissons aux
édulcorants en constante progression et… la toxicomanie de rue. Se-
lon une étude des National Institutes of Health, la consommation de
drogues de rue (marijuana, cocaïne et crack surtout) serait neuf fois
plus fréquente par les victimes d’AVC.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
1
/
4
100%