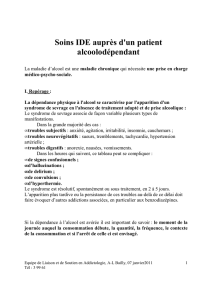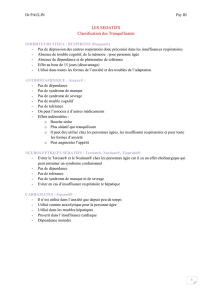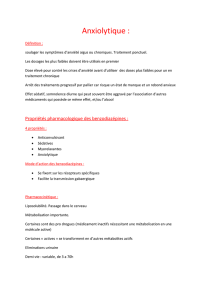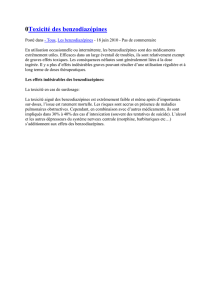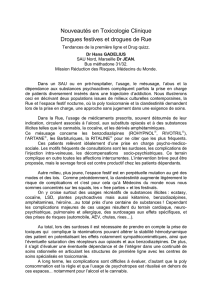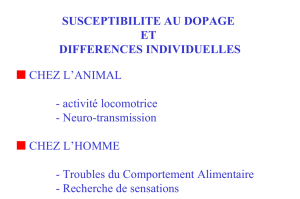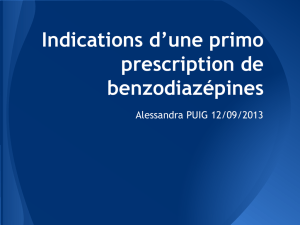Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE
126
REVUE DE PRESSE
Premier Žpisode psycho-
tique et prise de produits
Cantwell R., Brewin J., Glazebrook C.,
Dalkin T., Fox R., Medley I.,
Harrison G. : Prevalence of substance
misuse in first episode psychosis.
British Journal of Psychiatry, 1999,
174 : 150-4.
Les consommations de produits psy-
choactifs parmi des sujets schizo-
phrènes ont pu être estimées dans de
nombreuses études, mais elles restent
discutées avec des prévalences qui
varient de 20 à 50 %. Ces consomma-
tions sont souvent associées à des
tableaux cliniques et des à évolutions
plus sévères. Les difficultés méthodo-
logiques dans ce type d’approche sont
nombreuses. L’alcool, le cannabis, les
psychotropes sont souvent sous-esti-
més ; la durée d’évolution ou les
modes de consommation des produits
sont assez peu mentionnés et les
populations étudiées représentent
souvent des groupes hétérogènes,
avec des durées variables d’évolution
des schizophrénies. Cantwell s’est
donc intéressé aux premiers épisodes
psychotiques hospitalisés de 1992 à
1994 dans les services psychiatriques
de Nottingham. Cent cinquante-quatre
patients ont été évalués avec les cri-
tères diagnostiques de la CIM-10 et
les consommations prises en compte
à partir du SCAN (Schedules for cli-
nical assessment in neuropsychiatry).
Trente-sept pour cent des sujets répon-
daient au moins à l’un des diagnostics
suivants : abus d’alcool, utilisation ou
abus de drogues, 20 % ayant consom-
mé des drogues au cours de l’année et
12 % de l’alcool. Neuf pour cent des
patients ont présenté un épisode psy-
chotique lié à leur consommation. Les
produits utilisés étaient par ordre d’im-
portance : le cannabis, l’alcool, les
psychostimulants et les hallucino-
gènes. Les utilisations de produits se
retrouvaient davantage parmi la popu-
lation des plus jeunes malades et avec
une représentation essentiellement
masculine.
Les critères cliniques au cours d’en-
tretiens restent moins sensibles que
les analyses biologiques à la
recherche de produits qui auraient pu
compléter cette étude. Ce type d’ana-
lyse épidémiologique gagne à être
reproduite dans le temps, puisque, en
comparant ses résultats avec une éva-
luation précédente, Cantwell a pu
repérer une augmentation des épi-
sodes psychotiques liés aux produits
et hospitalisés dans la zone géogra-
phique de Nottingham.
Inhibiteur calcique et coca•ne
Kosten T., Woods S., Rosen M.,
Pearsall H. : Interactions of cocaine
with nimodipine : a brief report. The
American Journal on Addictions,
1999, 8 : 77-81.
Les inhibiteurs calciques réduisent les
poussées de tension et la tachycardie
induites par la cocaïne, mais semblent
aussi posséder une action centrale qui
limiterait les prises de cocaïne dans
les modèles animaux. Des études cli-
niques chez l’homme paraissent
confirmer ces résultats, mais leurs
résultats sont discutés. Kosten a donc
réalisé une étude en double aveugle
parmi des sujets recevant, dans le pro-
tocole expérimental, 2 mg/kg de cocaï-
ne par voie nasale deux heures avant la
prise de 60 ou 90 mg de nimodipine ou
de placebo. Les effets sur la tension se
sont manifestés aux posologies utili-
sées, avec une diminution de la pres-
sion systolique sans que l’action de la
nimodipine sur la tension diastolique
ne soit significative. Toutefois les
effets subjectifs de la cocaïne n’ont
pas été altérés aux doses de traitement
choisies.
Les cinq patients recrutés étaient des
cocaïnomanes, en majorité des
fumeurs, avec une consommation
moyenne de 2 g/j, qui rapportaient un
usage évoluant depuis onze ans en
moyenne.
La nimodipine passe dans le cerveau
et elle est indiquée dans les accidents
ischémiques neurologiques avec spas-
me artériel et dans l’hypertension qui
suit les hémorragies subarachnoï-
diennes. Elle possède un métabolisme
hépatique important qui en limite la
biodisponibilité. Son action discutée
sur la réduction des effets de la cocaïne
pourrait s’expliquer par un effet sur
les transporteurs de la dopamine. Des
études en neuro-imagerie ont pu mon-
trer, parmi des cocaïnomanes, des
défauts de perfusion cérébrale encore
mal expliqués et pouvant s’accompa-
gner de troubles cognitifs durables.
Kosten suggère que la nimodipine
pourrait être utilisée dans ces cas
d’abus de cocaïne avec retentissement
cognitifs et syndrome d’hypodébits
cérébraux localisés.
PrŽvention des overdoses
par les pairs
Strang J., Powis B., Best D., Vingoe L.,
Griffiths P., Taylor C., Welch S.,
Gossop M. : Preventing opiate over-
dose fatalities with take-home
naloxone : pre-launch study of pos-
sible impact and acceptability.
Addiction, 1999, 94 (2) : 199-204.
La survenue d’overdoses au cours des
prises d’héroïne représente encore
une cause de mortalité conséquente
parmi les usagers de drogue. La
réduction du nombre de décès depuis
les autorisations de prescription des
traitements de substitution représente
en France un point fort du développe-
ment de la politique sanitaire. La persis-
tance de l’évolution fatale d’un certain
nombre d’accidents de surdosage conti-
nue, dans la littérature internationale, de
soulever des interrogations multiples
quant aux actions sanitaires qu’il fau-
drait engager pour réduire la mortalité
des usagers de drogue. Le nombre
d’overdoses est souvent considéré
comme un indicateur des politiques
d’aide et de soins dans des populations
plus ou moins bien ciblées (Courrier
des addictions, 1).
Strang du Maudsley Institute et coll
.
se sont intéressés aux accidents de
surdosage non plus du point de vue de
la politique sanitaire mais en faisant
l’hypothèse que des accidents pour-
raient être prévenus par les toxico-
manes eux-mêmes.
Le traitement des overdoses nécessite
l’utilisation d’un antagoniste opiacé,

REVUE DE PRESSE
127
la naloxone injectable, et des soins de
réanimation cardiorespiratoire. Et
avant de développer un programme de
prévention spécifique (avec des
séances de secourisme et une distribu-
tion de naloxone) ouvert aux usagers
de drogue, Strang s’est intéressé aux
conditions de faisabilité de ce type de
programme en interrogeant des usa-
gers de la banlieue sud de Londres
(312) et des patients suivis dans le
centre de soins spécialisés rattaché au
Maudsley Hospital (142), le but était
d’évaluer le nombre d’overdoses en
présence de témoins et de savoir si ce
programme serait accepté et avec quel
impact. La définition de l’accident de
surdosage retenue pour les entretiens
structurés réalisés au cours de cette
étude était assez large, englobant les
premiers signes de difficultés respira-
toires, avec cyanose, et les troubles de
la conscience, sans notion de réanima-
tion médicale ou de complication. Les
usagers interrogés avaient présentés
pour 38 % d’entre eux au moins une
overdose contre 55 % parmi les
patients suivis, dans 90 % des cas
avec des opiacés et dans 80 % des cas
en compagnie d’autres usagers.
Cinquante-quatre pour cent des usa-
gers avaient été témoins de surdo-
sages contre 92 % parmi les sujets
suivis.
Un tiers des sujets interrogés avaient
entendu parler des antagonistes opia-
cés. Soixante-dix pour cent déclarè-
rent que la distribution de naloxone
était une idée intéressante, 6 % ont
estimé que ce produit pourrait les
inciter à augmenter leur consomma-
tion. Quarante-neuf pour cent ont
admis qu’ils pourraient garder la
naloxone chez eux comme un premier
secours ; 89 % des sujets interrogés
ont estimé qu’ils auraient pu utiliser la
naloxone au cours de la dernière over-
dose dont ils ont été les témoins.
Comme 20 % des sujets ont été
témoins d’une issue fatale, Strang a
pu estimer qu’au moins deux tiers des
69 accidents mortels par surdose
auraient pu être évités par l’adminis-
tration immédiate de naloxone
conservée dans la pharmacie des
patients.
Les chiffres de cette étude sont révé-
lateurs. Cette approche soulève le pro-
blème des conditions pratiques de réa-
lisation d’un programme de réduction
des risques, mais aussi et surtout
d’une formation spécifique pour les
usagers, et sans doute de l’extension
des compétences sanitaires aux per-
sonnes en contact avec les usagers et
les jeunes. Dans ce domaine, on
revient insensiblement à des questions
de politique sanitaire.
PrŽvention des rechutes et
rŽsistance au changement
Dimeff L., Marlatt A. : Preventing
relapse and maintaining change in
addictive behaviors. Clinical Psycho-
logy, 1998, 5 (4) : 513-25.
Comerford A. : Work dysfunction and
addiction : common roots. Journal of
Substance Abuse Treatment, 1999, 16
(3) : 247-53.
Les addictions sont souvent considé-
rées comme des pathologies durables,
soumises à des rechutes fréquentes.
De nombreux programmes de traite-
ment anglosaxons ont intégré depuis
vingt ans, dans leurs modalités de
soins, les thérapies cognitivo-compor-
tementales pour prévenir l’apparition
du processus de la rechute. Pendant
longtemps, ces techniques ont pour-
tant été bridées par l’idée même du
processus morbide contenant per se
un mode de récidive latent. C’est le
modèle par exemple de la maladie
alcoolique (considérée longtemps soit
en phase active, soit en rémission),
qui justifie au départ des rechutes des
conduites d’alcoolisation au cours de
la maladie, et qui intègre des modalités
de suivi visant, d’une certaine façon, à
immuniser le patient contre une pro-
chaine récidive en limitant l’impact
ou le retentissement, comme une sorte
de rappel vaccinal. Les dernières tech-
niques de prévention des rechutes
comptent davantage sur les capacités
des sujets à évoluer et sur leur aptitude
au changement. Dimeff rend ainsi
hommage au développement d’idées
apportées par Marlatt au cours de ces
dernières décennies. Il développa en
effet des interventions orientées sur
les situations à haut risque de déclen-
chement des conduites addictives,
tout en apprenant au patient à les
reconnaître et à y faire face. Marlatt
avait assez vite compris qu’il existait
souvent une inadéquation entre le sen-
timent d’efficacité des stratégies
développées, qui était réduit, et les
attentes souvent peu réalistes dues à
une surestimation des capacités du
patient. Il travailla assez vite sur des
facteurs de rechute distaux liés à la
façon de vivre des sujets, avec des dif-
ficultés notamment lorsque le patient
se trouvait confronté à ses désirs
contrariés par des exigences externes.
Les facteurs de rechute proximaux
étaient davantage liés à l’histoire per-
sonnelle du sujet, notamment ses
émotions, ses sentiments de souffran-
ce ou de détresse, aux difficultés
interpersonnelles, et aux pressions
de son environnement. Ces éléments
amenèrent Marlatt à nuancer les
rechutes des “dérapages” et à
conduire ses patients vers des objec-
tifs de réduction et de contrôle de
leur consommation avant d’envisa-
ger des projets d’abstinence centrés
sur des processus de changement de
vie. L’efficacité des thérapies com-
portementales n’est plus à démon-
trer. Il persiste néanmoins des points
de discussion si l’on compare les
données de suivi des différents pro-
grammes de soutien associés, avec
souvent une absence de différence
significative entre les suivis de
groupe fondés sur un programme
comme celui des douze marches et
les thérapies individuelles. Mais il
reste difficile de tirer des conclu-
sions sur l’efficacité comparée des
techniques psychothérapeutiques
dans le domaine général des addic-
tions sans faire référence aux types
de conduites et finalement aux pro-
duits utilisés.
Dans un domaine très semblable,
Comerford insiste aussi, à partir de
son expérience professionnelle dans
le domaine de la réinsertion de
patients dépendants ou non, sur les
capacités des patients au change-
ment, sur leurs difficultés spéci-
fiques souvent apparentes en termes
d’évitement ou exprimées par un

REVUE DE PRESSE
REVUE DE PRESSE
128
Le Courrier des addictions (1), n° 3, juin 1999
sentiment d’échec dans un contexte
de perte de confiance en soi.
Pourquoi ne pas transposer cette
approche cognitivo-comportemen-
tale aux interventions sociales dans
le but de mieux cerner quels sont
les facteurs de résistance au chan-
gement et de favoriser les
démarches actives des patients
allant dans le sens, précisément, du
changement ? Ainsi, les thérapeutes
institutionnels pourrait dépasser la
problématique de l’accompagne-
ment psychosocial de ces patients
pour élaborer avec eux un projet
thérapeutique renforçant leur
propre démarche de recherche
d’une aide et d’un traitement sus-
ceptible de les faire changer ?
BenzodiazŽpines chez lÕalcoo-
lique : pourquoi et comment
Lejoyeux M., Solomon J., Ades J. :
Benzodiazepine treatment for alco-
hol-dependent patients. Alcohol &
Alcoholism, 1998, 33 (6) : 563-75.
Les benzodiazépines sont souvent
prescrites dans le traitement de l’al-
coolisme. Leur activité au cours du
sevrage vise à compenser des phéno-
mènes biologiques, assez bien
connus actuellement et plus ou
moins spécifiques du manque d’al-
cool. La prolongation du traitement,
même à distance du sevrage, reste
souvent de mise. Michel Lejoyeux
nous propose une synthèse remar-
quable de l’utilisation des benzodia-
zépines dans ces indications, tout en
discutant l’intérêt et les limites des
traitements prolongés.
Au cours du sevrage alcoolique des
syndromes de dépendance avérés, le
recours aux traitements benzodiazé-
piniques peut se justifier en considé-
rant leurs actions biologiques.
L’action des prises régulières d’alcool
amène notamment à des modifica-
tions des récepteurs GABA, avec une
réduction du nombre des récepteurs
A, pouvant expliquer les phénomènes
de tolérance à l’alcool. Ces éléments
biologiques peuvent induire des
manifestations anxieuses, des crises
convulsives, des tremblements, et les
benzodiazépines corrigeraient ce
déficit en facilitant la fixation du
GABA sur son récepteur.
Au cours du sevrage, il existe une
hyperactivité noradrénergique qui
induit de la tachycardie, des tremble-
ments et de l’hypertension. En rédui-
sant cette activité, les benzodiazé-
pines ont montré leur activité sur le
locus coeruleus.
Le contexte de l’arrêt brutal d’une
consommation alcoolique durable
entraîne une réponse physiologique
de stress avec des réponses hormo-
nales, et notamment une hypercorti-
solémie ; les benzodiazépines dimi-
nuent l’élévation des corticostéroïdes
stimulés par la réponse hormonale
aux situations de stress.
Des phénomènes de kindling (embra-
sement) ont pu être décrit chez l’al-
coolique, la répétition d’états de
manque et de sevrages amenant une
sensibilité accrue des réseaux neuro-
naux. Celle-ci entraîne souvent une
baisse du seuil épileptique, avec
notamment la possibilité de propaga-
tion plus rapide (embrasement) des
phénomènes d’activité atypiques.
L’utilisation de benzodiazépines rend
alors la survenue des crises épilep-
tiques moins fréquente au moment du
sevrage.
L’indication clinique des benzodiazé-
pines au moment du sevrage pour en
limiter les complications est bien
documentée et reste incontournable.
De nombreuses molécules se sont
montrées efficaces et bien tolérées,
comme le diazépam, le lorazépam,
l’oxazépam, l’alprazolam ou le chlor-
diazépoxide. Mais il existe encore des
controverses en ce qui concerne le
recours systématique aux benzodia-
zépines au moment du sevrage.
Certains auteurs privilégient un abord
pharmacologique minimal dans les
cas de syndromes de manque modé-
rés. D’autres soulignent le risque de
répétition des syndromes de sevrage,
qui progressivement peuvent entraî-
ner des phénomènes de kindling et
semblent augmenter avec le temps le
risque de delirium tremens et de
crises convulsives. Cependant, les cas
les plus sévères, notamment avec
confusion, désorientation, instabilité
motrice ou tremblements apparaissant
précocement au décours du sevrage,
doivent bénéficier d’un traitement
rapide par benzodiazépines. De plus,
les patients ayant déjà suivi des
sevrages compliqués et présenté des
manifestations épileptiques, ont un
risque augmenté d’un facteur quatre
de développer un nouvel état clinique
alarmant au moment du sevrage.
Les discussions sont encore vives en
ce qui concerne le choix préférentiel
d’une benzodiazépine à demi-vie
brève ou longue. Même s’il n’existe
encore aucune étude confirmant un
risque d’abus plus important pour les
composés à demi-vie brève chez l’al-
coolique, les données cliniques amè-
nent à privilégier les molécules à
demi-vie longue, qui induisent un
effet central davantage progressif,
notamment sur l’angoisse. Les études
comparatives d’efficacité, qui restent
rares, mettent l’accent sur le bénéfice
des composés à demi-vie longue.
Il existe trois modalités de traitement
du sevrage qui s’opposent encore. La
première consiste à administrer de
fortes doses de benzodiazépines au
cours du sevrage, puis de réduire les
posologies selon la réponse clinique
des patients. Par exemple, on utilise
10 à 20 mg de diazépam ou l’équiva-
lent toutes les six heures jusqu’à
diminution des symptômes et avant la
réduction des posologies par palier.
Cette technique est souvent utilisée
en routine dans les pratiques hospita-
lières. Une adaptation initiale plus
fréquente a été proposée au cours des
premiers jours en tenant compte des
profils de demi-vie longue des pro-
duits utilisés, et certains préfèrent uti-
liser des “doses de charge” réduites
mais administrées toutes les heures
jusqu’à sédation des symptômes et
avant des prises plus espacées. Cette
technique semble conduire à une
amélioration plus rapide des troubles
et limiter les demandes itératives de
médicaments. Enfin, certains clini-
ciens utilisent une évaluation précise
de l’évolution des symptômes de
manque en évaluant sur une échelle
spécifique l’intensité des signes régu-
lièrement cotés par l’équipe soignan-

te. Les évaluations infirmières amè-
nent à un score et à des règles de
prescription selon l’intensité des
signes retrouvés. Ces évaluations
sont répétées toutes les heures en
début de sevrage et leur fréquence
évolue. Cette dernière méthode
semble nécessiter une quantité de
benzodiazépines prescrites et une
durée de traitement réduites par com-
paraison avec les deux autres tech-
niques précédemment décrites.
Les risques d’abus ou de dépendances
aux benzodiazépines parmi des patients
alcooliques restent discutés. Des études
réalisées parmi des consultants en
alcoologie estiment à 40 % le taux d’uti-
lisateurs de benzodiazépines et à 25 %
la proportion de sujets présentant un
abus de produits. La dépendance aux
médicaments est davantage étudiée
dans les études anglo-saxonnes en
termes de facteurs de risque. Dans ce
domaine, les conduites ou la personnali-
té antisociale, les antécédents d’hyper-
activité avec déficit de l’attention dans
l’enfance, l’impulsivité ou l’alcoolisme
de type II de Cloninger, semblent favo-
riser des conduites de consommation
excessive, des dépendances, tout
comme des antécédents de consomma-
tion multiple ou de polytoxicomanie, ce
qui limiterait l’intérêt des benzodiazé-
pines dans ces contextes cliniques.
La durée du traitement mis en place
au cours du sevrage doit être discutée
en fonction de l’évolution clinique
des sujets. On ne dispose actuelle-
ment d’aucune étude ayant pu
démontrer l’intérêt de la prescription
de benzodiazépines au long cours sur
la consommation d’alcool parmi les
patients anxieux ou non. La prolon-
gation du traitement initié dans ces
conditions de sevrage doit donc être
réévaluée selon l’évolution clinique
des patients et notamment la ré-émer-
gence de troubles anxieux qui, par
ailleurs, peuvent bénéficier, outre
l’abord pharmacothérapeutique, de
traitements cognitivo-comportemen-
taux qui se sont montrés efficaces.
Cette revue de la littérature amène à
reconnaître l’intérêt des benzodiazé-
pines au cours du sevrage alcoolique,
tout en insistant sur les risques de
dépendance et en discutant les modes
de prescription.
DŽpression et toxicomanie
Abraham H., Fava M. : Order of
onset of substance abuse and depres-
sion in a sample of depressed outpa-
tients. Comprehensive Psychiatry,
1999, 40 (1) : 44-50.
La plupart des études de comorbidité
entre troubles psychiatriques et toxi-
comanies insistent sur les dépressions
plus ou moins typiques associées fré-
quemment aux usages, abus ou
dépendance aux produits psycho-
actifs. Sur le plan psychopatholo-
gique, deux explications sont souvent
avancées pour expliquer cette asso-
ciation fréquente : l’usage de produits
pourrait conduire à des troubles de
l’humeur, mais l’abus de drogue
pourrait aussi apparaître secondaire-
ment au trouble thymique, sous-tendu
par une tentative du sujet de soulager
sa souffrance au moyen de produits
psychoactifs, à la manière d’une
“automédication initiale”. Les don-
nées les plus solides, qui proviennent
d’une très large étude épidémiolo-
gique réalisée en population générale
(étude ECA), ont pu montrer que trois
quarts des patients de 18 à 30 ans, pré-
sentant une toxicomanie et des
troubles de l’humeur, avaient d’abord
souffert de troubles de l’humeur. Mais
il n’existe que peu de données analy-
sant l’évolution des troubles produit
par produit.
Abraham et Fava ont donc étudié la
chronologie de survenue des consom-
mations de produits et celle des troubles
de l’humeur parmi 375 patients consul-
tant pour dépression dans une unité
spécialisée de psychiatrie.
Les prévalences d’abus de produits
dans cet échantillon ont été compa-
rées aux données d’une étude ECA en
population générale ; tous les taux
sont majorés (avec des odd ratio de
2,5 pour l’alcool, 4 pour le cannabis,
4 pour les opiacés, 6 pour les psycho-
tropes, 39 pour le LSD et jusqu’à 42
pour la cocaïne), mais ces résultats
restaient prévisibles compte tenu du
biais de sélection, encore que, pour la
cocaïne et le LSD, la prévalence était
particulièrement élevée. Dans des
populations assez spécifiques,
consultant dans un système de soins
pour un trouble précis, il semble évi-
demment plus intéressant de faire
apparaître l’existence de différences
chronologiques dans la survenue des
troubles parmi des sous-groupes de
consommateurs, que d’établir de
façon absolue les prévalences d’utili-
sation de cannabis ou d’alcool par
exemple.
En moyenne, les sujets dépendants
des produits ont présenté un début de
troubles de l’humeur plus précoce de
7,2 ans que les patients déprimés sans
antécédents de toxicomanie. La
dépendance à l’alcool se manifeste en
moyenne 4,7 ans après le premier épi-
sode dépressif, alors que pour la
cocaïne, la période de latence est en
moyenne de 6,8 ans. La survenue du
premier épisode de dépression coïnci-
de avec les prises de LSD et, fait mar-
quant, les dépendances au cannabis
ou aux autres produits semblent coïn-
cider avec les premiers épisodes
dépressifs. Pour tous les autres pro-
duits, la dépression précède l’état de
dépendance. Le nombre d’épisodes
dépressifs successifs est significati-
vement plus important dans le groupe
des sujets dépendants de la cocaïne et
du LSD que dans le groupe des héroï-
nomanes ou des utilisateurs de psy-
chotropes. Ces données chronolo-
giques ne peuvent pas à elles seules
infirmer l’hypothèse des toxicoma-
nies entretenues par des phénomènes
“d’automédication”. Le grand mérite
de cette étude reste d’avoir mis à jour
des troubles dépressifs précoces
parmi des patients qui ont développé
des dépendances aux produits psy-
choactifs, et d’avoir pu différencier
des formes de dépression à révélation
plus tardive parmi les patients
indemnes. Ces éléments soulignent
tout l’intérêt des prises en charge pré-
coces des troubles des adolescents.
Jacques Bouchez *
*Département de soins aux toxico-
manes, hôpital Paul-Guiraud, Villejuif.
REVUE DE PRESSE
129
1
/
4
100%