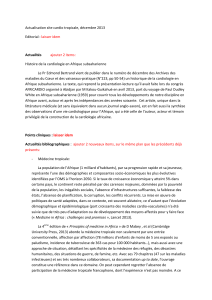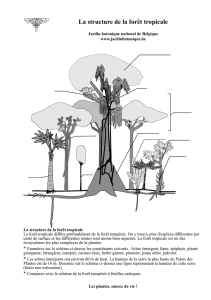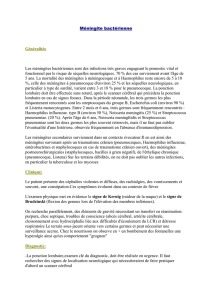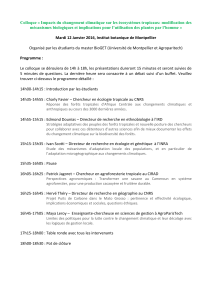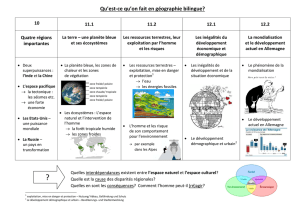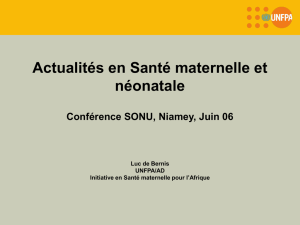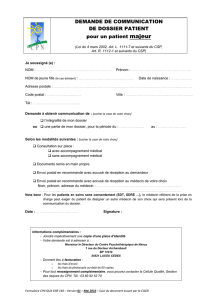U Communications orales RECHERCHE MÉDICALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE :

Médecine Tropicale •2008 •68 •4
404
Communications orales
CO.MT.01 RECHERCHE MÉDICALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
SES CONTRAINTES ET SES POTENTIALITÉS
Dumas M, Preux PM
Institut de Neurologie Tropicale - Faculté de Médecine, Limoges, France
Correspondance : [email protected]
Un nombre, non exhaustif, de constats sur la situation actuelle de la recherche médicale en Afrique subsaharienne est rapporté ; la prise
en compte de ces constats pourrait en permettre un meilleur développement.
Des réflexions concernant l’organisation de la recherche, ses financements, la nécessaire sensibilisation des décideurs, le statut
et le rôle du chercheur, ainsi que la structuration de la recherche, permettent de mieux cerner certains des freins actuels.
Des suggestions sont formulées ; chacune d’entre elles doit être adaptée au contexte de chaque pays. Il appartient aux seuls cher-
cheurs du Sud de prendre les décisions adéquates et de les développer dans un respect mutuel, en partenariat étroit et égalitaire avec d’autres
chercheurs. Le succès est à ce prix. Parmi les suggestions, citons :
- la potentialisation des moyens par le développement de réels Réseaux, régionaux et internationaux, de chercheurs ;
- la création, au Nord, de postes virtuels d’Attachés de Recherche à titre Etranger ;
- la publication d’une ou deux revues médicales africaines de haut niveau, et le développement de la banque de données africaines
«Index Medicus» (http://indexmedicus.afro.who.int/).
CO.MT.02
FIBRILLATION AURICULAIRE AU CAMEROUN :
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES
Ntep M, Ndobo P, Meiltz A, Kingue S, Zimmermann M
Hôpital Central -Yaoundé, Cameroun et Hôpital de La Tour - Meyrin, Suisse
Correspondance : [email protected]
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie cardiaque la plus fréquente mais il n’existe que peu de données concernant la FA en Afrique.
Le but de ce travail était de déterminer le mode de présentation clinique et la prise en charge de la FA au Cameroun, avec un inté-
rêt particulier pour l’anticoagulation.
Ce travail prospectif a été effectué par 10 cardiologues camerounais entre juin 2006 et juillet 2007. Les patients étaient inclus dans
le registre si : a) >18 ans et b) une FA était documentée par un ECG lors de la consultation. Les données recueillies comprenaient le pro-
fil clinique, le mode de présentation et la stratégie thérapeutique
adoptée.
Dans cette étude, 172 patients (75 hommes, 97femmes;
âge moyen 66 +/- 13 ans) ont été inclus. Une cardiopathie était
présente dans 90,7 % des cas (156/172) : hypertensive dans
47,7 %, valvulopathie rhumatismale dans 25,6 %, cardiomyo-
pathie dilatée dans 15,7 %, maladie coronaire dans 6,4 %. Des
symptômes étaient présents dans 91,9% des cas (dyspnée 72 %,
insuffisance cardiaque congestive 49 %, palpitations 47%,
malaise et syncope 30 %) ; 17,4 % des patients présentaient une
histoire d’accident vasculaire cérébral préalable. Le score de
CHADS2 était de 1,93, et 55,8 % des patients présentaient une
FA permanente (96/172). Une échocardiographie a été pratiquée
dans 82% des cas, montrant une dilatation de l’oreillette gauche
(diamètre moyen 50± 10 mm) et une dysfonction ventriculaire
gauche dans 68,8% des cas (96/141). Un contrôle de fréquence
a été choisi dans 83,7 % des cas (144/172) avec la digoxine
(62,8 %) ou l’amiodarone (28,5 %). Une anticoagulation orale
(ACO) a été introduite dans 32,6 % des cas (56/172), et l’aspi-
rine a été préférée dans 61,6% (106/172). L’ACO était prescrite
Session Médecine Tropicale

Médecine Tropicale •2008 •68 •4405
Communications orales
chez 45,6 % des patients < 65 ans, chez 30,8 % des patients entre 65 et 75 ans, et chez seulement 20 % des patients > 75 ans. En fonction
du score de CHADS2, 33,5 % des patients (53/158) éligibles pour une ACO l’ont effectivement reçue et 21,4% des patients (3/14) sans
facteur de risque ont bénéficié d’une ACO.
Au Cameroun, la FA traduit la présence d’une cardiopathie sévère, avec des manifestations cliniques graves. Le traitement consiste
en un contrôle de fréquence et une ACO ne peut être prescrite, pour des raisons socio-économiques, que dans un tiers des cas malgré un
risque thromboembolique élevé.
CO.MT.03
INTÉRÊTS ET LIMITES DE LA CHIRURGIE DIGESTIVE PALLIATIVE EN AFRIQUE
Montagliani L, Rüttimann M, Tramond B
Antenne chirurgicale aérotransportable, HIA Bégin, 69, avenue de Paris, Saint-Mandé, France.
Correspondance : [email protected]
La chirurgie palliative peut sembler un luxe en Afrique lorsque les possibilités thérapeutiques sont limitées ou dépassées, mais peut
permettre de passer un cap et d’assurer une fin de vie acceptable pour le patient et son entourage. Le cas d’un patient de 35 ans pré-
sentant un syndrome occlusif sur une tumeur évoluée du bas rectum et chez qui une colostomie a été pratiquée mérite d’être discuté.
L’indication d’une colostomie de proche amont de décharge est posée après discussion avec l’équipe soignante et explication des
conséquences au patient et à sa famille qui acceptent l’intervention. L’anesthésie comporte une induction à séquence rapide par l’asso-
ciation propofol-succinylcholine, l’entretien est assuré par du propofol en mode AIVOC, du sufentanyl et du vécuronium. A l’ouverture
du péritoine, un épanchement liquidien séro sanglant est mis en évidence ainsi qu’une dilatation majeure du cadre colique avec notam-
ment un caecum et un transverse préperforatif. Il n’y a pas de carcinose péritonéale. On retrouve une volumineuse lésion occlusive du
rectum, le pelvis est blindé. Le sigmoïde est alors ouvert de manière punctiforme pour vidanger le cadre colique dont le diamètre revient
à la normale. Après lavage abondant de la cavité péritonéale jusqu’à l’obtention d’un liquide clair, la brèche sigmoïdienne créée est exté-
riorisée en colostomie sur une baguette iliaque gauche.
En l’absence de poche de colostomie, l’appareillage initial est constitué d’une poche à urine vidangeable simplement découpée
et fixée à la peau par une bande collante. Le patient est extubé à la fin de l’intervention et transporté sur la structure d’hospitalisation de
l’ONG à la 4° heure post opératoire. Le lendemain, le personnel de l’ONG modifie le montage en utilisant une poche à urine à usage unique
non vidangeable, fixée grâce à un socle constitué par un anneau de carton adhérant à la peau par une bande collante. Les suites post opé-
ratoires sont simples, le transit est rétabli dès J3 permettant le reprise d’une alimentation efficace. A J 25, le patient rentre dans son vil-
lage. Il est parfaitement autonome et valide. Il s’alimente normalement et semble parfaitement satisfait de sa prise en charge.
Les contraintes de l’appareillage particulier d’une colostomie ne doit donc pas constituer un frein à la réalisation d’une chirur-
gie palliative en Afrique.
CO.MT.04 AFFLUX DE VICTIME A L’HÔPITAL DE MAMOU EN GUINÉE :
ANTICIPATION ET PRÉORGANISATION NÉCESSAIRES
Mortreux F, Sow I, Kolié KI, Desmaretz JL
Centre Hospitalier Armentières, service Urgences-SMUR, Armentières. Urgences hôpital régional de Mamou, Conakry
Correspondance : mortreuxesc@orange.fr
En Guinée, la ville de Mamou distante de 265 Kms de la Capitale (Conakry), est située sur un axe routier incontournable. L’Hôpital
Régional de Mamou (HRM) voit quotidiennement arriver des accidentés de la voie publique (23,7% de l’activité des urgences en
2006), et doit régulièrement faire face à des afflux de blessés occasionnés par des accidents graves et meurtriers. Le dernier recensé est
celui du 13 mars 2008 à Tamagaly sur la route nationale reliant Conakry à Mamou, un car de 50 passagers ayant percuté en début de mati-
née un minibus surchargé transportant 22 personnes. Sur une distance de 30 kms, une noria de taxis s’est organisée, et a amené 25 bles-
sés (6 urgences absolues et 19 urgences relatives) à la porte du service d’urgences de l’HRM, disposant de 5 lits d’examen, et aucun ser-
vice de réanimation. Deux patients décèderont aux urgences. Le « retour d’expérience » de la prise en charge de ces accidentés, a démontré
à la direction de l’établissement, ainsi qu’aux acteurs de l’urgence, que l’improvisation en situation de crise n’a pas sa place, et que pour
être parfaitement efficace, l’urgence ne pouvait s’organiser dans l’urgence. Pour faire face efficacement à un tel afflux, il est impératif
que l’HRM dispose d’un plan d’organisation préétablie connu de l’ensemble du personnel (triage, cellule de crise, circuits des patients,
matériel dédié...). Ce plan devra être adapté aux réalités locales, tant sur le plan humain que logistique et technique. Il est parallèlement

Médecine Tropicale •2008 •68 •4
406
Communications orales
nécessaire d’agir sur la prévention rou-
tière, et de démarrer une réflexion entre
les autorités sanitaires régionales et
l’HRM, sur les possibilités de développer
la prise en charge médicale des blessés en
amont de l’hôpital, afin d’améliorer la
qualité du transport des victimes et
d’augmenter ainsi leur chance de survie.
D’autre part, une formation concernant
les gestes et techniques de l’urgence pour
l’ensemble des soignants, et la réalisation
de certains outils (fiche « bilan lésionnel
traumatologique », fiche de sur-
veillance...) doivent rapidement être
mises en place, afin d’optimiser la qua-
lité de prise en charge aux urgences. Cette
formation devra être complétée par une
sensibilisation à « la médecine de catas-
trophe », car outre l’accidentologie,
l’HRM peut aussi être soumis à d’autres
risques sanitaires régionaux, avec à tout
moment la possible réémergence d’épi-
démies tels que le choléra ou la fièvre
jaune, et voir son fonctionnement com-
plètement désorganisé et déstabilisé s’il
n’y est pas préparé.
CO.MT.05
COMPLIANCE, ÉVOLUTION CLINIQUE ET INTÉGRATION SOCIALE DES ENFANTS TRAITÉS PAR ARV DE 2004 À 2007
À L’HÔPITAL NATIONAL PÉDIATRIQUE DE PNOM PENH (CAMBODGE)
Tat S, Reinharz D, Tran Hai N, Vibol U, Marcy O, Strobel M, René P, Barennes H
HDR, IFMT BP 9519 Vientiane Laos PDR,
Corresondance : hubert.barennes@auf.org
La prévalence du VIH sida chez les 15-49 ans au Cambodge est passé de 2,1 % en 2002 à 1,9 % (2003). Plus de 1700 enfants reçoi-
vent des antirétroviraux (ARV) (2005). Cette population pose des problèmes spécifiques. Nous avons étudié la compliance au trai-
tement, l’évolution du statut VIH, ainsi que l’intégration sociale des enfants sous ARV et leurs déterminants à l’hôpital National Pédiatrique
de Phnom Penh (HNP).
De Février à juin 2007, tous les enfants (18 mois à <15 ans) séropositifs, traités par ARV à l’HBP de 2004 à 2007, inclus après
consentement familial, ont été enquêtés en langue khmer: i) étude des dossiers médicaux et biologiques, ii) questionnaire par visite à domi-
cile. Les données ont été saisies sur Epidata. L’analyse multivariée des déterminants de la compliance et de l’intégration sociale a été
réalisée avec Stata 8.
Parmi les 183 enfants (M/F : 1,2, âge : 90 mois(40), 57% étaient orphelins d’au moins un parent et 80 % étaient issus de familles
pauvres (<1 $/jour/personne).
73 % avaient eu une mère VIH positive (68 mères décédées) et 98,6% avaient été allaités (de 1 à 48 mois). 2/183 mères avaient
reçu un traitement prophylactique pendant la grossesse. 99% des enfants étaient sous traitement de première ligne et 69 % recevaient du
Cotrimoxazole et 8,7 % du fluconazole. La compliance globale était supérieure à 75 % et se traduisait par un accroissement régulier des
CD4 à 6, 12 et 18 mois (p<0.001) et une diminution de la charge virale à 6 mois (p=0,001). 10 avaient présenté des infections opportu-
nistes depuis la dernière visite. Près de 25 % des enfants déclaraient souffrir de discrimination malgré une participation élevée aux jeux
en commun(85%), aux loisirs (80%), une scolarisation de 60%. L’analyse multivariée ne permettait pas de bâtir de modèle avec les variables
considérées pour la compliance, l’évolution clinique et l’intégration sociale.
Malgré une extrême précarité familiale, le traitement ARV est possible chez les enfants au Cambodge. Les projets doivent se foca-
liser sur le suivi des enfants présentant des problèmes de stigmatisation ou de compliance insuffisante.
Figure 1. Afflux de victimes à l’hôpital de Mamou en Guinée : anticipation et préorganisation nécessaire.

Médecine Tropicale •2008 •68 •4407
Communications orales
CO.MT.06 ANTHROPOLOGIE DE LA RECHERCHE CLINIQUE EN MILIEU RURAL OUEST AFRICAIN
Ouvrier MA
Centre Régional de Recherche et de Formation (CRCF) du CHU de Fann, Dakar, Sénégal.
Correspondance : [email protected]
Depuis une vingtaine d’années, on constate un accroissement du
nombre des recherches cliniques réalisées dans les pays à res-
sources limitées et pays émergents. La mise en place de recherches
médicales au sud suscite, ceci dit, souvent des questionnements et
des inquiétudes aussi bien de la part des promoteurs que des parti-
cipants et provoque parfois des polémiques internationales. Depuis
2006, un groupe de recherche en anthropologie (Université Aix
Marseille III, CreCSS, IRD-UMR145) s’est constitué afin d’organiser
la production d’études et de réflexions en sciences sociales sur les
enjeux de la recherche médicale dans les pays à ressources limitées.
L’anthropologie propose ainsi d’étudier la recherche médicale en ce
qu’elle réfère à un ensemble d’acteurs qui interagissent à différents
niveaux, selon des normes sociales, des facteurs économiques, et en
fonction de représentations idéologiques et symboliques. C’est dans
ce cadre qu’a été initiée une étude anthropologique sur la recherche
clinique sur le site de Niakhar au Sénégal. L’objectif principal de cette
étude est de produire une connaissance sur les déterminants et les
usages sociaux de la recherche médicale en milieu rural ouest-afri-
cain. A partir de l’analyse d’évènements se déroulant avant, pendant et après la recherche médicale, cette étude permettra d’offrir une
meilleure compréhension des interactions entre les multiples acteurs de la recherche. Des thèmes comme le vécu des sujets participants
aux études cliniques en milieu rural, l’insertion de la recherche dans le système local de soins et les différents modes de circulation de
l’information dans la communauté de l’essai, seront entre autres abordés. Dans une perspective anthropologique, cette étude permettra
de contribuer à la réflexion sur les dynamiques sociales autour des processus d’évaluation
thérapeutique dans les pays du sud. Dans une perspective de santé publique, elle permettra
d’améliorer l’acceptabilité des processus de recherche clinique et de faciliter leur mise en
œuvre, au bénéfice de la population.

Médecine Tropicale •2008 •68 •4
408
Communications orales
CO.MT.07
PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT (PTME) DU VIH EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE :
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE 269 SITES DANS 20 PROGRAMMES PTME
Ladner J1, Audureau E1, Khan J2, Besson MH3, Saba J3
1. UFR de Médecine, Université de Rouen, Rouen (France)
2 Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies, University of California, San Francisco (USA)
3. Axios International, Paris.
Correspondance : joel.ladner@chu-rouen.fr
L’objectif est d’étudier la performance des sites dans un même programme de PTME. Depuis juillet 2000, Boehringer Ingelheim offre
la névirapine (NVP) dans le cadre de programmes PTME en Afrique sub-Saharienne. Chaque programme inclus était suivi tous les
six mois par un rapport standardisé. Pour chaque site, Il recueillait le nombre de femmes enceintes vues en consultation prénatale (CPN),
le nombre de femmes pré et post-conseillées, le nombre de femmes VIH+ (prévalence observée) et le nombre de femmes et de nouveau-
nés mis sous NVP. La performance des sites et des programmes a été évaluée par le ratio de couverture en NVP (RCN), défini par le nombre
de femmes mises sous NVP sur le nombre attendu de femmes sous NVP (=prévalence VIH x nombre de femmes vues en CPN). Au total,
269 sites issus de 20 programmes mis en œuvre dans 17 pays d’Afrique sub-Saharienne ont été inclus. Ils cumulaient 2 374 mois de suivi
(8,8 mois de suivi moyen par site). Le nombre moyen de sites par programme était de 13,5. Au total, 283 410 femmes ont été vues en
CPN. Le RCN moyen était de 0,44. Par programme, le RCN s’étendait entre 0,94 et 0,07. Le RCN moyen était de 0,47 dans les struc-
tures de soins primaires et de 0,37 dans les établissements hospitaliers (p=0,01). Le RCN était de 0,45 dans les structures avec moins de
30 CPN/mois, de 0,36 dans les structures entre 30 et 100 CPN/mois et de 0,29 dans les structures avec plus de 100 CPN/mois (p=0,004).
Le RCN était significativement corrélé au nombre de femmes testées (coefficient de corrélation des rangs de Spearman [rs]=0,65, p=0,01).
En analyse multivariée (modèle linéaire généralisé), le RCN était associé significativement au programme (p=0,002), il n’était pas asso-
cié au niveau d’activité CPN (p=0,48), au type d’établissement de santé (p=0,93) et à la prévalence VIH observée (p=0,15). 1 - Le RCN
est un indicateur de couverture des programmes PTME facilement utilisable en routine. 2 - Les programmes implantés dans des petites
structures et dans des zones à forte prévalence semblent plus performants. 3 - Des qualités intrinsèques propres aux sites PTME (satis-
faction des femmes dans l’accueil et la prise en charge, niveau de formation et de savoir-faire dans le counseling des professionnels de
santé, suivi et gestion des programmes, etc.) pourraient expliquer les différences de couverture.
CO.MT.08
RÉALISATION D’UNE CERTIFICATION INTERNATIONALE ISO 9001 VERSION 2000 EN PRÉ HOSPITALIER :
EXPÉRIENCE DE SOS MÉDECIN SÉNÉGAL
Diop MS, Regnault K, Diop IB, Sorge F, Boukoulou F, Signaté B, Diop Y, Fall M
Correspondance : [email protected]
La certification ISO qui a été créée à l’origine dans les pays anglo-saxons pour l’industrie nous paraissait éloignée des préoccupations
d’un système pré hospitalier d’urgence. Cependant, une démarche de qualité en médecine d’urgence ne pourrait-elle pas tirer par-
tie de la méthodologie d’une certification ISO ?
De la norme ISO 9001 version 2000 nous retiendrons deux points essentiels : elle spécifie les exigences relatives au système de
management de la qualité et vise :
- « à démontrer son aptitude à fournir régulièrement un service conforme aux exigences des patients et aux exigences réglementaires
applicables » ;
- « à accroître la satisfaction des patients par l’application efficace du système y compris les processus d’amélioration continue.
Nous avons entrepris de certifier la visite médicale, le transport médicalisé, le transport para médicalisé, le rapatriement sanitaire.
La section catastrophe a été volontairement exclue de la certification. Dans le cadre de la norme, avec l’aide d’un « qualiticien », nous
avons défini une politique qualité. Quatre axes prioritaires ont été développés pour permettre d’atteindre ce niveau de performance sou-
haité : - améliorer les compétences du personnel - le niveau d’équipement - les délais d’intervention - Augmenter les activités. Sur ces
axes nous avons défini des objectifs avec des indicateurs pour les mesurer. Ces indicateurs ont été comparés, mesurés avant et après la
certification. L’activité de SOS Médecin a été déclinée en 3 processus opérationnels et 3 processus supports. La satisfaction du patient
est un élément essentiel de notre système de qualité.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%