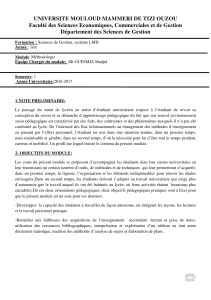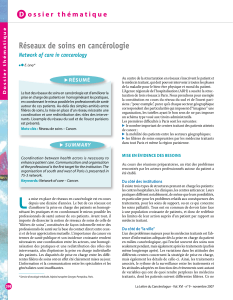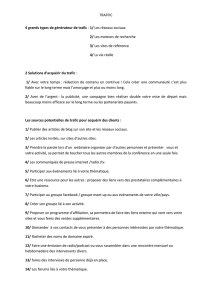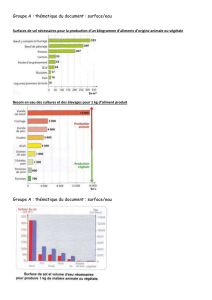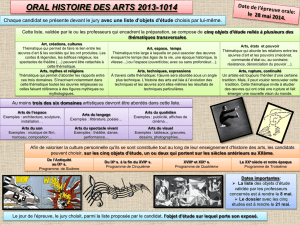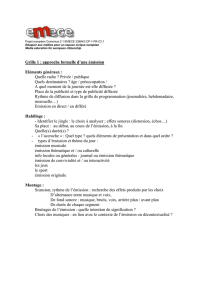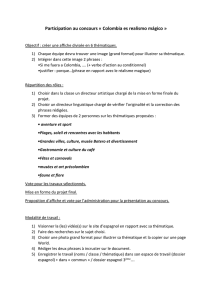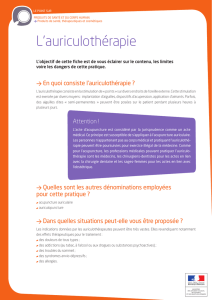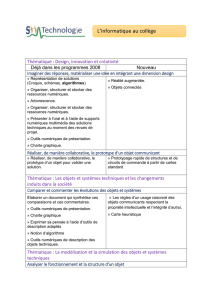III Journées de l’Association européenne d

Dossier thématique
Dossier thématique
391
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
IIIes Journées de l’Association européenne
pour les soins de confort en oncologie (AESCO)
Third Congress of the European Association for Supportive Care in Oncology (AESCO)
●● F. Scotté*, E. Levy*, S. Oudard*
* Service d’oncologie médicale, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.
RÉSUMÉ
Les soins de support en oncologie ne sont pas une nouvelle
discipline : ils correspondent à une écoute attentive, à
l’accompagnement et au confort du patient cancéreux. Au
côté des Journées nationales de soins de support (en asso-
ciation avec le Groupe de réfl exion sur l’accompagnement et
les soins de support pour les patients en hématologie et en
oncologie [GRASSPHO] et la Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer [FNCLCC]), l’Association européenne
pour les soins de confort en oncologie (AESCO) se veut le
moteur, en termes de formation et de développement, de
ce regard particulier sur le patient.
Mots-clés : AESCO – Soins de support – Cancer.
▶
SUMMARY
Supportive care in cancer must not be considered as a new
care, but as a singular approach of patients with cancer.
Complementary to the National Days of Supportive Care (in
association with GRASSPHO and FNCLCC), the Association
européenne pour les soins de confort en oncologie
(AESCO) would be active in teaching and enhancement
of this patient approach.
Keywords: AESCO – Supportive care – Cancer.
▶
ciation sont un moment privilégié de mise au point de certains
thèmes, et elles s’organisent comme suit : un temps de tables
rondes et de symposiums (le premier jour), une matinée dévolue
à l’actualité des techniques et des soins de support, et une après-
midi lors de laquelle l’AESCO invite une discipline afi n d’en
défi nir spécifi quement les besoins et les réponses en termes
d’accompagnement. Cette année, les chirurgies urologiques
et digestives étaient invitées, sous la gouverne du Pr M. Pey-
romaure (service d’urologie de l’hôpital Necker). Le discours
inaugural a été prononcé par M. Aapro, ancien président de
la Multinational Association for Supportive Care in Cancer
(MASCC) et acteur important dans le développement interna-
tional des soins de support. Ce discours a replacé le mouvement
des soins de support et leur développement sur la scène inter-
nationale. Le développement français, national puis régional,
a par la suite été abordé, avant l’évocation des spécifi cités de
prise en charge des toxicités cutanées et des traitements ciblés.
La télémédecine, la douleur pré- et postopératoire ainsi que
la place de la psycho-oncologie ont également été présentées
lors de cette journée.
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES SOINS DE SUPPORT
M. Aapro est intervenu pour apporter sa réfl exion quant au passé
et au développement des soins de support sur les plans inter-
national et européen. Il a, en premier lieu, rappelé les objectifs
d’une prise en charge des soins de support en insistant sur la
symptomatologie, mais en évoquant également l’accompagne-
ment. Au-delà de la défi nition de 1990, proposée par la MASCC,
il a donné sa propre défi nition des “traitements de support” :
Le traitement de support consiste en la prévention et la prise en
charge des eff ets indésirables du cancer et de son traitement ;
Cela inclut les symptômes physiques et psychosociaux, les
eff ets indésirables durant tout le vécu avec un cancer, y compris
l’aide au rétablissement et le soutien aux survivants.
Ainsi, les soins de support vont permettre de tenter d’améliorer
la tolérance des patients aux traitements actifs, de soulager les
symptômes et les complications liées au cancer, de prévenir et
réduire les toxicités des traitements, de faciliter la communica-
tion avec les patients concernant leur maladie et leur pronostic,
de soulager de leur poids émotionnel les patients mais également
les soignants, et enfi n d’aider les “survivants” qui présentent des
troubles physiques, psychologiques et sociaux.
▶
▶
L
es IIIes Journées de l’Association européenne pour
les soins de confort en oncologie se sont tenues les
26 et 27 avril 2007 à l’hôpital européen Georges-
Pompidou, à Paris. Cette association, créée en 2003, a pour
objectif essentiel d’aider à la promotion des soins de support
en développant la recherche, la formation et l’environnement
des patients cancéreux. Les journées organisées par cette asso-

Dossier thématique
Dossier thématique
392
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
En Europe, trois groupes (ayant dans leur intitulé le terme
“Europe”) sont impliqués dans les soins de support :
l’EAPC (European Association for Palliative Care), dont les
objectifs sont essentiellement tournés vers l’accompagnement
palliatif ;
l’AESCO, clairement identifi ée en tant qu’association dédiée
aux “soins de support”, mais dont l’intitulé, inapproprié, oriente
plus vers le confort du patient ;
la European Society for Medical Oncology (ESMO), dont
le groupe Pain and palliation publie des recommandations de
prise en charge.
La European Organization for Research and Treatment of Cancer
(EORTC) n’a réellement eu un impact dans les soins de support
qu’à partir de 2002, avec la publication de recommandations,
notamment pour l’utilisation des facteurs de croissance héma-
topoïétiques (1, 2).
Enfi n, des initiatives nationales sont menées sous l’égide de la
MASCC. Les pays européens actuellement moteurs et soutenus
par cette association internationale sont l’Allemagne, l’Italie et
la Grèce.
D’autres associations nationales existent, sans retentissement
européen ou à plus large échelle.
Sur la scène internationale, c’est la MASCC qui tente d’assurer
une union des diff érents travaux et acteurs en soins de support.
Sa création remonte à 1990, sous l’égide belge et sous la prési-
dence de J. Klastersky (jusqu’en 2000). Plusieurs groupes inter-
nationaux, collaborant depuis les années 1980, ont alors été
réunis au sein de cette association, qui émit la même année
une défi nition des soins de support :
“Supportive care: e total medical, nursing and psychosocial
help which the patients need besides the specifi c treatment.”
Le journal Supportive Care in Cancer, publié pour la première
fois en 1992 et édité par H.J. Senn (Suisse), sera le support de
base de leur communication. À compter de 1998 se crée un
nouveau regroupement avec l’International Society of Oral
Oncology (ISOO), ce qui motive des congrès internationaux.
De nombreuses associations, telles que l’ASCO ou l’ESMO,
sont actuellement en lien avec elle. La MASCC est introduite
en 2000 aux États-Unis comme association exempte de taxes,
et y tient son premier congrès. Le lieu des meetings alterne
entre l’Europe et les États-Unis. Elle regroupe 721 membres
des 5 continents, essentiellement représentés par des médecins
(50 %), des infi rmières (20 %) et des dentistes (10 %), imposant
ainsi sa dimension internationale. Les autres partenaires de
soins, tels que pharmaciens, industriels, psychologues, etc.,
sont également représentés.
Les missions de la MASCC sont les suivantes :
optimiser les soins de support oncologiques pour les patients
cancéreux partout dans le monde ;
stimuler une recherche multidisciplinaire ;
encourager les échanges internationaux d’informations
scientifi ques ;
étendre l’expertise professionnelle en soins de support ;
promouvoir la formation en soins de support des profession-
nels de santé dans le monde ;
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
apporter des ressources d’information pour les patients, leurs
proches et les soignants.
Ces missions sont réalisées par le biais de groupes de travail et
permettent de produire des recommandations d’experts dans les
diff érents domaines proposés (tableau). La plupart des publica-
tions des groupes sont présentées dans le journal Supportive Care
in Cancer, mais également dans d’autres revues internationales
essentielles. Les importantes publications récentes sont des
recommandations concernant la mucite et les antiémétiques,
ces dernières s’accompagnant d’une grille d’évaluation du risque
émétique.
M. Aapro a insisté durant son exposé sur l’importance du
regroupement des forces pour faire évoluer l’idée des soins de
support et leur prise en charge à l’échelle internationale, mais
aussi en France.
SOINS DE SUPPORT EN FRANCE
L’émergence du mouvement des soins de support en France
date des États généraux du cancer de 1999, du fait de plusieurs
réunions émanant de la FNCLCC dès 2001 ainsi que de la créa-
tion d’un groupe de réfl exion. En 2003 paraît un texte fondateur,
publié dans plusieurs revues, défi nissant l’organisation des soins
de support dans tous les établissements prenant en charge des
patients atteints de cancer. Le Plan Cancer, en 2004, puis la
circulaire de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins (DHOS) du 22 février 2005, fi xent les bases des soins
de support et en établissent la défi nition française : “Ensemble
des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout
au long de la maladie, conjointement aux traitements onco-
hématologiques spécifi ques lorsqu’il y en a.” Cette défi nition
propose deux voies d’exploration : la voie des soins – techniques
et traitements – à proposer aux patients (antiémétiques, érythro-
poïétines, antalgiques, traitements des mucites, etc.) et la voie
des soutiens, qui comprend l’organisation des soins autour du
patient (réunions de concertation pluridisciplinaires, conseils
en image corporelle, coordination par établissement de l’orga-
nisation des soins de support).
Les soins de support doivent être étroitement liés et concomi-
tants aux traitements spécifi ques en cours de traitement curatif
antinéoplasique, et devenir prédominants en phase de rémission.
▶
Tableau.
Liste des groupes de travail de la MASCC.
Antiémétiques Médecine palliative
Métabolisme osseux Éducation des patients et professionnels
Fatigue Pédiatrie
Facteurs de croissance Psychosocial
Hémostase Qualité de vie
Infection Réhabilitation
Mucite Toxicité cutanée
Soins oraux

Dossier thématique
Dossier thématique
393
33 34
12 17
60
39
50
22
100
80
Patients (%)
60
40
20
Nausées aiguës
Patients Soignants
Vomissements
aigus Nausées
retardées Vomissements
retardés
0
Figure 1.
Perception des soignants versus perception des patients
dans un contexte de chimiothérapie fortement émétisante.
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
On voit l’importance de cette écoute particulière, notamment
en ce qui concerne les troubles cognitifs post-thérapeutiques
qui perturbent les patients à distance des chimiothérapies et des
radiothérapies. En phase palliative, les soins de support prennent
progressivement le pas sur les soins spécifi ques jusqu’à ce que s’y
substituent des soins palliatifs propres à la fi n de vie du patient.
Cette articulation souple et progressive doit permettre d’éviter
toute rupture dans la prise en charge du patient.
La fi gure 1 refl ète la diff érence de perception des patients et
des soignants vis-à-vis des nausées-vomissements, révélatrice
du chemin à parcourir dans l’écoute et dans la prise en charge
des symptômes ressentis par les malades. Ce résultat d’étude est
majeur dans la promotion du mouvement des soins de support,
dont le but est de mobiliser la communauté soignante en cancé-
rologie pour l’écoute et la prise en charge attentive des plaintes
des patients.
Diff érentes recommandations relatives aux nausées-vomis-
sements ont été rappelées, parmi lesquelles l’importance de
l’administration des sétrons le jour de la chimiothérapie et de
celle de corticoïdes associés à l’aprépitant le jour et les deux
jours suivant chaque chimiothérapie fortement et moyennement
émétisante ; l’importance également d’une utilisation prophy-
lactique des facteurs de croissance hématopoïétiques en cas de
risque de neutropénie supérieur à 20 %.
L’étude ECAS ( e European Cancer Anaemia Survey) avait
montré en 2001 le défi cit de prise en charge de l’anémie pour
60 % des patients. L’étude FACT, en 2006, a montré une nette
amélioration de cette prise en charge, puisque 22 % “seulement”
des patients ne sont pas traités pour leur anémie aujourd’hui.
On observe un changement des mentalités sur ces cinq années
dans l’écoute des symptomatologies des patients, en faveur des
agents de l’érythropoïèse pour l’anémie.
Les dernières recommandations de l’EORTC ont également été
rappelées, avec toutefois une réserve concernant les publications
actuelles et l’impact sur la survie et sur les taux de réponse de
l’utilisation d’érythropoïétines hors recommandation.
La vigilance est de mise avec l’utilisation des biphosphonates
et leur mise à disposition en pharmacie de ville, notamment au
regard du risque d’ostéonécrose et d’insuffi sance rénale.
L’étude IRMA et la recommandation d’une mesure de la clairance
plutôt que de la créatinine ont été soulignées.
D’autres techniques et soutiens ont été présentés :
Le yoga, déjà présenté à l’ASCO 2006, avec un bénéfi ce de
100 % en termes de satisfaction, mais une absence de bénéfi ce
statistique sur les échelles de qualité de vie.
La promotion de l’utilisation des gants et chaussons réfrigérants
en prévention des toxicités unguéales et cutanées liées au docé-
taxel a été développée. Les résultats signifi catifs sont largement en
faveur du développement de cette technique dans les centres.
L’action de l’association Apprivoiser son image dans la maladie
(APIMA) a été soutenue. Son bénéfi ce a été démontré par une
exposition de photographies commentées par des patientes.
Les soins de support en France s’intègrent à la dynamique du
Plan Cancer avec des recommandations faites par les sociétés
savantes et une coordination de ces soins propre à chaque centre.
Le patient doit être replacé au centre du dispositif de soins et
l’objectif est l’optimisation de sa qualité de vie. Prévoir, anticiper
et rendre l’essentiel visible doivent également être des objectifs
de ce mouvement.
Dans le domaine des soins de support, un regard particulier
peut être porté sur les médecines dites complémentaires, avec
toute la vigilance scientifi que nécessaire.
À titre d’exemple, une unité de prise en charge nommée “Prendre
soin” et regroupant des acteurs de soins complémentaires (auri-
culothérapie, relaxation, conseils en image, massages) a été
créée à l’hôpital européen Georges-Pompidou, et le retour des
patients sur l’accompagnement complémentaire aux traitements
antinéoplasiques que ces disciplines apportent est très positif.
Qualité et confort de vie pendant et après le traitement sont
les objectifs des acteurs de cette unité.
AURICULOTHÉRAPIE
Le principe de cette technique vient d’Orient et remonte à
2 500 ans av. J.-C. Des observations intéressantes ont été faites
par le Pr Malgaigne en 1850 à l’hôpital Saint-Louis, puis son
développement a été repris en France à partir de 1950, initiale-
ment par le Dr Nogier, rhumatologue à Lyon. Ce praticien a été
étonné de voir des patients soulagés de leur sciatalgie par des
cautérisations de l’oreille à un point très précis. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a reconnu l’auriculothérapie en 1987.
Les observations et les réfl exions de Nogier l’ont mené à décrire,
dans le pavillon de l’oreille, un fœtus tête en bas. Chaque point
précis correspond à un organe, et une cartographie spécifi que
a par la suite été défi nie avec, sur le schéma de l’oreille, une face
sensitive et une face motrice. Cette cartographie a été validée
sous la forme d’une nomenclature internationale en 1990 par
l’OMS. Des études scientifi ques ont alors été imposées afi n de
prouver la véracité neurophysiologique des relations entre les
points et leurs zones de correspondance spécifi que. Le scan par
▶
▶
▶

Dossier thématique
Dossier thématique
394
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
tomographe à émission de positons, l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) fonctionnelle et les potentiels évoqués ont été
des outils de recherche fondamentaux et ont permis d’assurer
la base neurophysiologique nécessaire à toute démonstration
scientifi que moderne. En 2002, une traduction thermo-auri-
culographique des affi chages pathologiques sur les auricules a
été mise en évidence. Le principe de l’auriculothérapie suit dès
lors les données anatomiques démontrées de notre médecine
contemporaine. Le traitement d’une douleur consistera en des
applications d’aiguilles sur le trajet de la douleur à des points
précis correspondant aux relais nerveux ; pour une sciatalgie, on
piquera sur le trajet du nerf sciatique, sur la substance réticulée,
sur le thalamus et enfi n sur le relais du cortex.
Une étude menée à Villejuif et publiée en 2000 a montré l’effi cacité
sur la douleur de cette technique (3). Des enregistrements des
niveaux douloureux par échelle visuelle analogique (EVA) ont été
faits en préthérapeutique, après traitement antalgique pharma-
ceutique bien conduit (paliers 2 et 3), puis après deux mois de trai-
tement par auriculothérapie associée aux antalgiques. Une nette
régression des scores EVA a été retrouvée grâce à l’asso ciation
des traitements. Une étude versus placebo (aiguilles placées de
façon aléatoire) a été publiée en 2003, montrant une supériorité
de l’auriculothérapie sur le placebo (amélioration des scores EVA
de 30 % versus 10 %, respectivement) [4]. Une étude, actuellement
soumise à publication, évoque les xérostomies postradiques et
une amélioration soutenue à 1 et 2 mois avec le traitement par
auriculothérapie. D’autres développements sont en cours, dans
d’autres indications. L’auriculothérapie est une médecine complé-
mentaire, qui vise à apporter des solutions supplémentaires aux
souff rances des patients. En aucun cas cette dernière technique
ne doit être présentée comme “traitement du cancer”, mais son
utilisation peut faire partie de l’ensemble des outils nécessaires
à un meilleur accompagnement des malades.
LA VISITE VIRTUELLE
Un exemple de développement d’un outil de surveillance et
d’accompagnement des patients en cours de traitement a été
présenté lors de cette session. L’utilisation de la télémédecine et
des nouveaux outils informatiques de communication pourrait
être, dans le futur, un élément intéressant pour faire face aux
inquiétudes démographiques, tout en préservant une surveillance
étroite du patient et une attention portée aux symptômes qu’il
éprouve.
L’augmentation pressante du nombre de cas de cancer, la pauvreté
de la démographie médicale et la volonté d’une surveillance opti-
male des patients ont conduit à une réfl exion sur un nouvel outil
d’évaluation au domicile du patient. Les nouveaux traitements
anticancéreux, essentiellement administrés sous forme ambu-
latoire, voire par voie orale au domicile, imposent, en raison de
leur toxicité non négligeable, d’être particulièrement vigilant à
l’encadrement des soins. Cet outil développé peut, par ailleurs,
avoir d’autres implications, pour le suivi de patients hospitalisés à
domicile, ou encore pour enregistrer, avec une précision proche
de l’exhaustivité, des données d’essais cliniques. Surveiller à
distance, régulièrement, devrait permettre de prévoir, anticiper
et mieux gérer au domicile les toxicités. On peut facilement
imaginer obtenir une diminution des consultations d’urgence
en décelant les eff ets indésirables et en organisant précocement
leur prise en charge au domicile du patient. La technique utilise
les outils modernes de communication, à savoir l’informatique,
Internet et éventuellement des connexions via GPRS (satellite).
La rencontre entre société informatique, prestataires au domi-
cile, patient et soignant est la base d’un développement tel qu’il
nécessite une réfl exion des tutelles et des fi nanciers.
Le principe de la visite virtuelle repose sur une surveillance
continue, qualitative et quantitative, menée en temps réel. La
surveillance “pancarte infi rmière” (pouls, tension, température)
est associée à des données subjectives de ressenti du patient
(commentaires). La visite est menée à des moments précis,
choisis par les soignants au cours de la journée. Tous les inter-
venants ayant l’autorisation peuvent se connecter sur le dossier
du patient, par le biais d’une connexion sécurisée, afi n d’obtenir
les données nécessaires à la prise en charge. La notion d’équipe
soignante garde un sens et le patient retrouve une place naturelle
au centre du dispositif de soins mis en place.
En pratique, le patient entre, à diff érents moments de la journée,
des données relatives à l’hémodynamique, la température, la
saturation en oxygène, les toxicités digestives, et il renseigne des
échelles EVA douleur et fatigue précises. Il complète également
sa visite par une page de commentaire, ce qui rend possible
l’analyse de ses plaintes subjectives au même titre que le permet-
trait l’entretien soignant-soigné. Ces données sont par la suite
recueillies via le serveur Internet par le prescripteur, qui les
analyse. Le médecin mène alors sa visite à tout moment de la
journée, se connecte au site Internet et accède, toujours par
connexion sécurisée, à la liste des patients qu’il suit. Les résul-
tats peuvent apparaître sous la forme brute de chiff res et de
commentaires, mais également sous celle de tableaux montrant
l’évolution des constantes.
Le médecin peut alors déclencher une prise en charge adaptée à
chaque situation : adapter un traitement antalgique, antiémétique
ou encore laxatif, demander un passage infi rmier ou médical
selon les besoins, voire déclencher une prise en charge d’urgence
en cas de situation à risque. Le serveur suit un principe de portail
multi-entrée permettant à tout membre autorisé de l’équipe
soignante d’avoir accès aux données. On imagine aisément
l’intervention possible du médecin traitant, de l’équipe infi r-
mière, du kinésithérapeute ou de la diététicienne. On envisage
également l’accès des services médicaux d’urgence au dossier
du patient (antécédents, pathologie, traitements en cours, suivi
des constantes et des événements récents), ceux-ci pouvant ainsi
intervenir dans des conditions optimales au domicile.
Au cours de cette première phase de faisabilité, la visite virtuelle
a été profi table au patient autant qu’à l’équipe soignante.
Pour le patient traité pour cancer du rein sous thérapie ciblée
orale, le suivi a été simple, la gestion des événements plus rapide
et mieux menée. Deux idées principales ont été précisées par le
patient : “J’ai le sentiment d’être à nouveau accompagné, surveillé

Dossier thématique
Dossier thématique
395
Troubles de la mémoire
Troubles de la concentration
4,5
4
Niveau de diculté
3
2
1
Prétraitement
Chimiothérapie
Chimiothérapie et radiothérapie
Radiothérapie
Post-traitement Post-traitement
à 6 mois
0
4,5
4
Niveau de diculté
3
2
1
Prétraitement Post-traitement Post-traitement
à 6 mois
0
Figure 2.
Évolution des troubles des fonctions cognitives avec
les traitements anticancéreux (ASCO 2006, d’après Kohli S et
al. abstract 8502).
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
par mon équipe médicale” et “Je me sens à nouveau acteur de
mes soins, au centre du dispositif.” Ces propos mettent en avant
le sentiment de sécurité et soulignent combien il est important de
communiquer et composer avec le patient. Du côté médical, les
données objectives (mesurées) et subjectives (page de commen-
taire) ont permis un suivi précis, rapide et correctement évalué.
Les appels téléphoniques ont été dirigés par l’équipe médicale
en fonction des besoins. Le patient n’a pas eu à se heurter aux
multiples standards et boîtes vocales et a reçu directement
l’information et les recommandations.
En aucun cas cet outil ne doit remplacer l’entretien face à face
entre soignant et soigné, mais il peut aider à une meilleure
gestion des événements indésirables au domicile, nombreux
au cours d’une prise en charge de cancérologie.
Son utilisation dans le cadre de la recherche clinique pourrait
également apporter des précisions importantes sur les temps
de survenue des eff ets indésirables, mais également permettre
de suivre les toxicités de grades 1 et 2, qui peuvent se révéler
diffi cilement supportables en cas de chronicité.
Le développement est attendu avec des appels à projets. Comme
tout outil de télémédecine, la pierre angulaire de l’extension
des soins hors du cadre de la recherche clinique est le fi nance-
ment. La participation des tutelles, comme celle des patients,
est une question à soulever. D’autres questions sont encore
non résolues.
COMMUNICATIONS LORS DU SYMPOSIUM
CANCER ET SOINS DE SUPPORT : L’AVIS DES PATIENTS
ET NOUVELLES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES
Un symposium s’est également tenu et a regroupé trois visions
des soins de support :
L’organisation de l’enquête “Cancer, prise en charge initiale
du malade” (CPRIM) relative à la mise en place du dispositif
d’annonce sur le territoire français et ses résultats, présentés
dans les comptes-rendus de la IVe Journée nationale des soins
de support ;
La prévention des toxicités, avec une présentation de l’étude
IRMA 2 sur l’insuffi sance rénale associée au cancer ;
Le suivi des patients en post-thérapeutique, avec une pré-
sentation sur les troubles cognitifs.
Rappelons que l’étude IRMA 1 a eu pour objectif de défi nir la
prévalence de l’insuffi sance rénale dans le cancer et de décrire
le potentiel néphrotoxique et la nécessité d’adaptation posolo-
gique des traitements anticancéreux. L’insuffi sance rénale est
défi nie par le débit de fi ltration glomérulaire, approchée par
le calcul de la clairance de la créatinine, avec une défi nition en
5 grades depuis 2005. La clairance est évaluée selon la formule
de Gault et Cockroft ou la MDRD (Modifi cation of the diet in
renal disease) abrégée. Un suivi a porté sur 4 684 patients, pour
une tumeur solide, et les données ont été analysées rétrospecti-
vement. La créatininémie a été anormale (> 110 µM) pour 7 % des
patients, mais, après calcul de la clairance de la créatinine, 57,4 %
et 52,3 % des patients (selon la formule de Gault et Cockroft ou
▶
▶
▶
la MDRD, respectivement) ont présenté une insuffi sance rénale
( clairance < 90 ml/ mn). Malgré ces chiff res, 80,1 % des patients ont
reçu au moins un médicament néphrotoxique et 79,9 % d’entre eux
ont reçu un traitement nécessitant une adaptation posologique.
Il est à noter que 40 % des patients ont présenté une anémie.
Les objectifs de l’étude IRMA 2 sont les mêmes que ceux
d’IRMA 1, avec un suivi de cohorte de la fonction rénale et
des prescriptions (et évolutions) d’anticancéreux, sur deux ans
en deux phases avec des recueils périodiques tous les 6 mois.
Les résultats de la première phase sont en cours d’analyse avec
4 562 patients inclus dans l’étude.
Une vigilance particulière a été demandée pour certains médi-
caments :
L’association aprépitant et ifosfamide semble majorer la
néphrotoxicité de l’ifosfamide. On sera également attentif à la
déshydratation liée aux vomissements, facteur de risque d’in-
suffi sance rénale.
Les anti-infl ammatoires sont à éviter, et il importe d’être
vigilant dans le maniement des antalgiques de palier 3.
Les biphosphonates sont, pour la plupart, potentiellement
néphrotoxiques (avec une supériorité du zolédronate sur le
pamidronate), à l’exception de l’ibandronate. La posologie de
chaque biphosphonate doit être réduite en cas d’insuffi sance
rénale afi n d’éviter une surcharge médicamenteuse osseuse.
Enfi n, une attention particulière doit être portée aux fonctions
cognitives, dont une présentation à l’ASCO 2006 a montré
qu’elles se détérioraient en cours et à distance des traitements
anticancéreux (fi gure 2).
▶
▶
▶
 6
6
1
/
6
100%