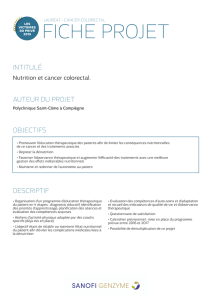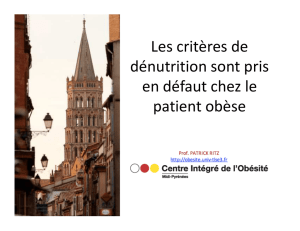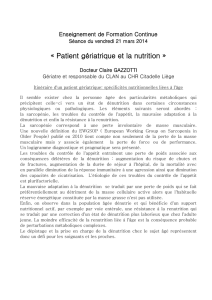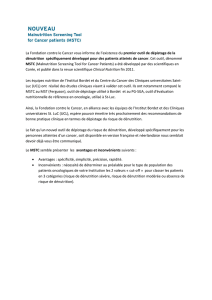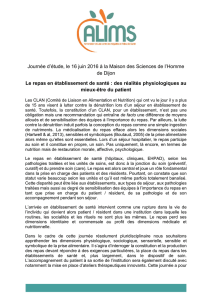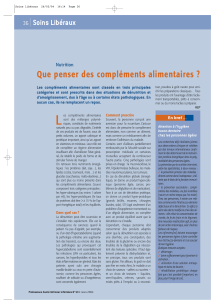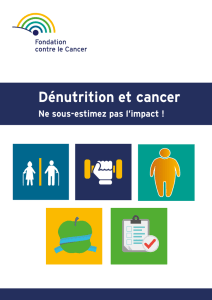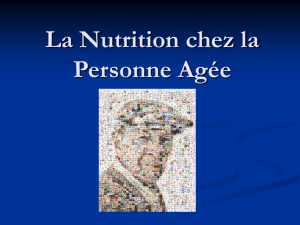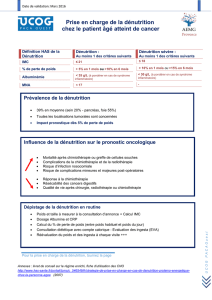Dénutrition du sujet obèse ScienceDirect Undernutrition in obese patient Nicolas Farigon

Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Nutrition clinique et métabolisme 29 (2015) 50–53
Développement professionnel continu
Dénutrition du sujet obèse
Undernutrition in obese patient
Nicolas Farigona,∗, Magalie Miolannea, Florence Montel a, Sylvain Dadet a,
Karem Slimb, Noël Cano a,c, Yves Boiriea,c
aService de nutrition clinique, CHU Gabriel-Montpied, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand, France
bService de chirurgie digestive, hôpital Gabriel-Montpied, CHU Estaing, 63003 Clermont-Ferrand, France
cUnité de nutrition humaine, UMR 1019, CRNH, 63009 Clermont-Ferrand, France
Rec¸u le 17 novembre 2014 ; accepté le 4 d´
ecembre 2014
Disponible sur Internet le 16 janvier 2015
Résumé
La dénutrition avec ses nombreuses conséquences cliniques accroît la morbi-mortalité des sujets atteints. Par conséquent, elle doit être dépistée
et prise en charge le plus tôt possible chez les patients à risque. Cependant en situation d’obésité, le dépistage et les critères d’évaluation de l’état
nutritionnel sont mis en défaut en raison des particularités clinico-biologiques associées à l’adiposité excessive. Le but de cette synthèse est de
discuter les limites des paramètres habituellement utilisés pour le dépistage de la dénutrition afin de mieux évaluer sa fréquence et définir les
situations à risque de dénutrition en situation d’obésité.
© 2015 Publi´
e par Elsevier Masson SAS.
Mots clés : Dénutrition ; Composition corporelle ; Obésité sarcopénique ; Carence protéique ; Chirurgie bariatrique
Abstract
Undernutrition and its numerous clinical consequences increase morbidity and mortality. For these reasons, undernutrition screening and its
treatment must be undertaken as soon as possible for every patient at risk. However in case of obesity, the criteria for the nutritional assessment are
deficient because of the clinical and biological specificities associated with excessive body fat. The purpose of this review is to discuss the limits
of the parameters actually used for nutritional evaluation in order to better assess its frequency and define the situations at risk of undernutrition
in obese patients.
© 2015 Published by Elsevier Masson SAS.
Keywords: Undernutrition; Body composition; Sarcopenic obesity; Protein deficiency; Bariatric surgery
1. Introduction
L’accroissement rapide de l’obésité associée au vieillisse-
ment de la population engendre de nouvelles préoccupations
cliniques en raison de leurs effets cumulatifs voire synergiques
sur la morbi-mortalité. Ainsi la dénutrition chez un sujet dont
l’indice de masse corporelle (IMC) évoque une surnutrition est
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (N. Farigon).
facilement méconnue notamment dans un contexte de mala-
dies chroniques. Les changements de la composition corporelle,
comme la réduction de la masse musculaire et l’augmentation de
la masse grasse, ne s’accompagnent pas toujours d’une réduc-
tion importante du poids corporel d’où la difficulté de poser
un diagnostic de dénutrition. Ce diagnostic est d’autant plus
important que la perte de masse maigre chez le sujet obèse est
un évènement péjoratif pour le pronostic et la qualité de vie de
ces patients. Cette synthèse aborde brièvement la définition, les
mécanismes, la prévalence, les étiologies, les situations à risque,
et la conduite à tenir face à la dénutrition du sujet obèse.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2014.12.001
0985-0562/© 2015 Publi´
e par Elsevier Masson SAS.

N. Farigon et al. / Nutrition clinique et métabolisme 29 (2015) 50–53 51
2. Définition de la dénutrition : quid en situation
d’obésité ?
La dénutrition résulte d’un déséquilibre quantitatif et/ou
qualitatif entre les apports et les besoins de l’organisme. Ce dés-
équilibre entraîne des pertes tissulaires notamment musculaires
avec des conséquences organiques et fonctionnelles délétères
[1]. Chez le patient hospitalisé, la dénutrition aggrave le pronos-
tic en termes de morbi-mortalité, justifiant la mise en place d’un
dépistage précoce pour une meilleure prise en charge [2,3]. Les
outils de dépistage retenus par la HAS en 2003 pour les patients
de moins de 70 ans, puis en 2007 pour les patients de plus de
70 ans, sont basés sur la prise en compte de l’IMC, d’une perte
de poids et d’une albumine ou d’une transthyrétinémie abaissées
[4,5]. Pour les patients de moins de 70 ans, une dénutrition est
suspectée devant un IMC inférieur ou égal à 17 kg/m2, une perte
de poids supérieure ou égale à 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois,
une albuminémie inférieure à 30 g/L, ou un transthyrétinémie
inférieure à 0,11 g/L. Ces deux derniers critères biologiques ne
peuvent être pris en compte en cas de syndrome inflammatoire
avec une CRP supérieure à 15 mg/L. Pour les patients de plus
de 70 ans, les critères retenus sont un IMC inférieur ou égal à
21 kg/m2, une perte de poids supérieure ou égale à 5 % en 1 mois
ou 10 % en 6 mois, une albuminémie inférieure à 35 g/L avec une
CRP inférieure à 15 mg/L, ou un Mini Nutritional Assessment
(MNA) global inférieur à 17.
Les critères anthropométriques retenus pour dépister la dénu-
trition peuvent être pris à défaut en situation d’obésité et masquer
la dénutrition [6]. En effet, l’IMC peut être considéré comme
normal même après une perte de poids importante chez un sujet
préalablement obèse. De plus, la perte de poids même involon-
taire peut être perc¸ue plutôt favorablement dans des situations de
maladie chronique alors qu’elle est un facteur péjoratif du pro-
nostic de la maladie [7]. Enfin, une prise de masse grasse peut
masquer une perte plus ou moins importante de masse maigre
chez le sujet plus âgé [8]. Ainsi, l’obésité sarcopénique définie
par un IMC supérieur ou égal à 30 kg/m2associé à une réduction
de la masse et de la fonction musculaires, est un facteur péjo-
ratif aussi important que la dénutrition, telle que décrite dans la
définition, en termes de morbi-mortalité en situation de mala-
die chronique [9]. Le paradoxe de l’obésité qui, en situation de
maladie chronique serait un facteur protecteur, peut donc être
mis en défaut lorsqu’une sarcopénie est présente [10].
Les critères biologiques peuvent être également insuffi-
sants pour définir la dénutrition du sujet obèse. L’albuminémie
semblerait être le paramètre le plus adapté parmi les critères
« classiques » de dénutrition chez le patient obèse. Cependant, de
nombreux évènements tels que l’inflammation, l’hémodilution,
l’insuffisance hépatique, les pertes urinaires pathologiques que
l’on peut observer au cours de l’obésité compliquée peuvent
aussi entraîner une diminution de l’albuminémie. En dehors de
toute situation d’agression aiguë ou de défaillance chronique
d’organe telles que l’insuffisance hépatique ou un syndrome
néphrotique, l’obésité est souvent associée à un syndrome
inflammatoire de bas grade et à une augmentation du secteur
extracellulaire pouvant interférer avec l’albuminémie. A contra-
rio, l’albumine est un marqueur faiblement voire non corrélé
à la masse protéique, comme on le constate dans l’anorexie
ou les restrictions protéino-énergétiques au cours desquelles
l’albuminémie reste généralement normale. L’albumine appa-
raît donc plus comme un marqueur de morbi-mortalité que de
dénutrition [11]. Par conséquent, la question d’un autre mar-
queur de la perte protéique chez le sujet obèse reste totalement
ouverte. En ce qui concerne les autres paramètres nutrition-
nels notamment les dosages en micronutriments, ils peuvent
être utilisés comme cela a été récemment signalé [12]. Cepen-
dant il s’agit généralement de situations spécifiques comme le
suivi de la chirurgie bariatrique où l’on assiste effectivement à
l’apparition de nombreuses carences en lien avec la réduction
globale des apports nutritionnels, éventuellement combinée à
une malabsorption digestive [13].
3. Mécanismes spécifiques de la dénutrition chez le sujet
obèse
De fac¸on générale, la dénutrition peut résulter d’une dimi-
nution des apports nutritionnels (anorexie, douleurs...), d’une
augmentation inhabituelle des besoins énergétiques (inflamma-
tion chronique, stress chirurgical, hypercatabolisme...), d’une
moindre assimilation des nutriments (malabsorption, diminution
des hormones anabolisantes...). Dans l’obésité, la dénutrition
relève des mêmes causes potentielles, tout en considérant que
l’obésité s’accompagne également de nombreuses perturbations
métaboliques dont les effets complexes peuvent se cumuler et
aboutir avec l’avancée en âge à une réduction progressive du
capital musculaire. Par exemple, l’excès adipocytaire est lié à un
stade micro- ou macro-inflammatoire qui est associé au risque
cardiovasculaire, à l’insulinorésistance et au syndrome métabo-
lique. Ainsi, l’inflammation, tout comme l’insulinorésistance,
sont des évènements biologiques capables d’induire une résis-
tance anabolique musculaire et de participer progressivement à
une réduction du capital musculaire [14,15]. De plus, la perte
pondérale induite par des régimes alimentaires restrictifs qui
souvent se répètent, est responsable d’une diminution de tissu
adipeux et de masse maigre. La récupération de la masse maigre
lors du rebond pondéral n’est pas systématique et il est pos-
sible que ces épisodes successifs de perte et de rebond entraînent
chez certains patients obèses une perte non compensée de masse
musculaire. Cette perte de masse maigre musculaire n’est pas
uniquement le fait du déficit énergétique induit par la restriction
énergétique mais il reflète la demande de l’organisme et plus
particulièrement celle du cerveau en glucose. L’utilisation des
réserves endogènes pour le maintien de la production énergé-
tique résulte essentiellement d’une stimulation de la lipolyse à
partir du tissu adipeux à l’origine d’une diminution de masse
grasse souvent désirée par le patient obèse. Cette lipolyse sera
d’autant plus active que la différence entre dépense énergétique
et apports sera importante. Cependant, la fourniture énergétique
doit répondre également à la fourniture obligatoire du cerveau
en glucose (de l’ordre de 120 g/j) à partir de la transformation de
précurseurs gluconéogéniques (par ordre décroissant : les acides
aminés gluco-formateurs, le lactate, le glycérol), les acides gras
de la lipolyse servant à la production énergétique liée au coût
énergétique de la gluconéogenèse. Les acides aminés d’origine

52 N. Farigon et al. / Nutrition clinique et métabolisme 29 (2015) 50–53
musculaire sont donc fortement mobilisés par activation des
voies de la protéolyse et peuvent servir à alimenter la gluco-
néogenèse hépatique avec pour effet secondaire de provoquer
une diminution plus forte de la masse maigre musculaire selon
la profondeur du déficit énergétique et la teneur du régime en
glucides. Ce besoin spécifique en précurseurs de la production
endogène de glucose est un facteur important du maintien de
la masse maigre en condition de perte de poids. Enfin, ce pro-
blème peut être aggravé par le vieillissement qui s’accompagne
d’une sarcopénie et qui modifie la réponse métabolique au déficit
énergétique, illustrant le danger potentiel des régimes restric-
tifs dans cette population [16]. Il faut par ailleurs noter que
cette perte musculaire a elle-même de nombreuses conséquen-
ces fonctionnelles et métaboliques pouvant aggraver l’obésité
et ses comorbidités. Elle s’accompagne d’une réduction de la
force musculaire, de l’endurance, d’un accroissement de la fati-
gabilité. De plus, le muscle étant un organe fortement impliqué
dans l’oxydation des acides gras, sa diminution participe à la
réduction de ses capacités oxydatives et limite la perte de masse
grasse. Enfin, la réduction du capital musculaire contribue à la
réduction de l’activité physique et entretient le développement
de l’obésité centrale et de l’insulinorésistance dans cette popu-
lation. De fait, l’obésité sarcopénique contribue à réduire les
capacités de l’organisme à répondre à un stress métabolique ou
environnemental et cette situation spécifique doit être désormais
considérée dans l’évaluation clinique des patients obèses.
4. Prévalence de l’obésité sarcopénique et des carences
nutritionnelles
Les carences en macronutriments sont dominées par le déficit
protéique qui confine à l’obésité sarcopénique. Il est intéressant
de noter que ce concept d’obésité sarcopénique est une préoccu-
pation clinique débutante pour laquelle nous ne disposons que
de peu d’études et la définition des seuils de sarcopénie dans
cette population est l’objet de nombreux débats [17–19]. Les
obstacles à la détermination de sa prévalence sont de diverses
natures : l’absence de population de référence, d’études lon-
gitudinales sur des populations correctement phénotypées, les
besoins d’ajustement de la masse musculaire à la corpulence,
et les besoins de trouver les outils appropriés à la mesure de la
composition corporelle et à la mesure de la perte fonctionnelle
associée. Enfin, des études mécanistiques sont encore largement
nécessaires pour déterminer les facteurs de risque et les groupes
de populations à risque de développement d’obésité sarcopé-
nique. Quoiqu’il en soit, on estime globalement la prévalence
de l’obésité sarcopénique de l’ordre de 5 à 15 % dans la popula-
tion générale sachant que l’âge influence fortement les données
[20].
Après chirurgie bariatrique, le déficit protéique est fortement
sous-estimé et les quelques études ayant relevé les apports pro-
téiques rapportent des apports moyens de 0,3–0,4 g/kg par jour
[21,22], alors que les recommandations européennes ou amé-
ricaines proposent une ingestion quotidienne de protéines de
60 g/j minimum ou encore 1,05 g/kg par jour [23,24]. Ces indi-
cations ne reposent toutefois sur aucune détermination précise
des apports et des pertes protéiques dans la phase postopératoire
précoce ou tardive. De plus, les travaux les plus récents semblent
confirmer qu’un apport protéique postopératoire de plus de 60 g/j
ou de 1,1 g/kg de poids idéal et par jour peut limiter la perte de
masse maigre [22].
Les carences en micronutriments sont nombreuses comme
en témoignent les études sur le sujet, aussi bien avant la chirur-
gie bariatrique [12], qu’après la chirurgie [13]. De nombreuses
études et méta-analyses ont confirmé la présence de plusieurs
déficits en micronutriments notamment en cas de chirurgie
malabsorptive mais également par restriction alimentaire dras-
tique [25].
5. Situations à risque de dénutrition
Différentes situations déterminent volontiers un risque sup-
plémentaire de dénutrition : l’âge, l’état dentaire, le contexte
psychosocial (précarité, syndrome dépressif, dépendance), les
maladies chroniques d’organes, l’intensité ou la durée d’une
agression aiguë, certains traitements médicamenteux tels que la
corticothérapie ou les chimiothérapies anticancéreuses, les anté-
cédents de chirurgie digestive lourde ou de chirurgie bariatrique,
les troubles majeurs des conduites alimentaires ou un régime
restrictif trop sévère.
6. Conséquences de la dénutrition du sujet obèse
Comme dans toute dénutrition, l’individu atteint entre dans
une spirale négative de la dénutrition où une augmentation de
la durée d’hospitalisation, du risque infectieux, l’aggravation de
la sarcopénie entretiennent la pérennisation de la dénutrition et
favorisent l’accroissement de la morbi-mortalité. Il existe par
ailleurs des risques spécifiques en lien avec le déficit en micro-
nutriments : dépression et carence en vitamine B6, anémie et
risque d’anomalie du tube neural lors de la grossesse et carence
en vitamine B9, sclérose combinée de la moelle et carence en
vitamine B12, anémie et carence martiale.
7. Conclusions et recommandations
La dénutrition du sujet obèse est un diagnostic difficile
en raison des nombreux obstacles à l’évaluation précise des
paramètres anthropométriques et biologiques mis en défaut
dans cette situation clinique. La dénutrition peut concerner les
macronutriments en lien avec un déficit protéique et/ou les
micronutriments surtout, mais pas uniquement, dans les suites
de la chirurgie bariatrique. Son identification est d’autant plus
importante que la perte de masse maigre est un évènement péjo-
ratif pour le pronostic et la qualité de vie des patients obèses
porteurs de maladies chroniques et/ou âgés. Il n’y a actuellement
pas de consensus mais il faut développer des critères spécifiques
et objectifs permettant une évaluation appropriée de l’état nutri-
tionnel en situation d’obésité, en regard du pronostic. Les critères
cliniques suivants peuvent être proposés : signes cliniques (perte
de poids, œdèmes, évaluation des ingesta, fonte et faiblesse
musculaires), tests de fonctionnalité musculaire, composition
corporelle (masse maigre musculaire), dépense énergétique de
repos, protéines plasmatiques (dont la place n’est pas encore

N. Farigon et al. / Nutrition clinique et métabolisme 29 (2015) 50–53 53
bien définie), qualité de vie. Ce nouveau champ d’investigation
doit faire l’objet de travaux futurs visant à mieux définir les
différents phénotypes lors de la dénutrition du sujet obèse.
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
relation avec cet article.
Références
[1] Walrand S, Guillet C, Salles J, Cano N, Boirie Y. Physiopa-
thological mechanism of sarcopenia. Clin Geriatr Med 2011;27(3):
365–85.
[2] Puthucheary ZA, Hart N. Skeletal muscle mass and mortality - but what
about functional outcome? Crit Care 2014;18(1):110.
[3] Genton L, Graf CE, Karsegard VL, Kyle UG, Pichard C. Low fat-free mass
as a marker of mortality in community-dwelling healthy elderly subjects.
Age Ageing 2013;42(1):33–9.
[4] Haute Autorité de santé. Évaluation diagnostique de la dénutrition
protéino-énergétique des adultes hospitalisés, recommandations de bonnes
pratiques. HAS; 2003.
[5] Haute Autorité de santé. Stratégie de prise en charge en cas de dénu-
trition protéino-énergétique chez la personne âgée : recommandations
professionnelles. HAS; 2007 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/
c546549/strategie-de-prise-en-charge-en-cas-de-denutrition-proteino-
energetique-chez-la-personne-agee
[6] Kyle UG, Pirlich M, Lochs H, Schuetz T, Pichard C. Increased length of
hospital stay in underweight and overweight patients at hospital admission:
a controlled population study. Clin Nutr 2005;24(1):133–42.
[7] Pichard C, Kyle UG, Morabia A, Perrier A, Vermeulen B, Unger P.
Nutritional assessment: lean body mass depletion at hospital admission
is associated with an increased length of stay. Am J Clin Nutr 2004;79(4):
613–8.
[8] Gallagher D, Ruts E, Visser M, Heshka S, Baumgartner RN, Wang J, et al.
Weight stability masks sarcopenia in elderly men and women. Am J Physiol
Endocrinol Metab 2000;279(2):E366–75.
[9] Prado CMM, Lieffers JR, McCargar LJ, Reiman T, Sawyer MB, Mar-
tin L, et al. Prevalence and clinical implications of sarcopenic obesity in
patients with solid tumours of the respiratory and gastrointestinal tracts: a
population-based study. Lancet Oncol 2008;9(7):629–35.
[10] Kalantar-Zadeh K, Abbott KC, Salahudeen AK, Kilpatrick RD, Horwich
TB. Survival advantages of obesity in dialysis patients. Am J Clin Nutr
2005;81(3):543–54.
[11] Aussel C, Cynober L. L’albuminémie est-elle un marqueur de l’état nutri-
tionnel ? Nutr Clin Metabol 2013;27(1):28–33.
[12] Kaidar-Person O, Person B, Szomstein S, Rosenthal RJ. Nutritional defi-
ciencies in morbidly obese patients: a new form of malnutrition? Part A:
vitamins. Obes Surg 2008;18(7):870–6.
[13] Quilliot D, Brunaud L, Reibel N, Ziegler O, Barnoud D, Bouteloup C,
et al. Prévention et traitement des carences en vitamines, minéraux et oligo-
éléments après chirurgie de l’obésité. Nutr Clin Metabol 2010;24(1):10–5.
[14] Guillet C, Masgrau A, Walrand S, Boirie Y. Impaired protein metabolism:
interlinks between obesity, insulin resistance and inflammation. Obes Rev
2012;13(Suppl. 2):51–7.
[15] Guillet C, Delcourt I, Rance M, Giraudet C, Walrand S, Bedu M, et al.
Changes in basal and insulin and amino acid response of whole body
and skeletal muscle proteins in obese men. J Clin Endocrinol Metab
2009;94(8):3044–50.
[16] Zeanandin G, Molato O, Le Duff F, Guérin O, Hébuterne X, Schneider
SM. Impact of restrictive diets on the risk of undernutrition in a free-living
elderly population. Clin Nutr 2012;31(1):69–73.
[17] Prado CMM, Wells JCK, Smith SR, Stephan BCM, Siervo M. Sarco-
penic obesity: a critical appraisal of the current evidence. Clin Nutr
2012;31(5):583–601.
[18] Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F,
et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: report of
the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing
2010;39(4):412–23.
[19] Zamboni M, Mazzali G, Fantin F, Rossi A, Di Francesco V. Sarcopenic
obesity: a new category of obesity in the elderly. Nutr Metab Cardiovasc
Dis 2008;18(5):388–95.
[20] Tardif N, Salles J, Guillet C, Gadéa E, Boirie Y, Walrand S. Obésité sar-
copénique et altérations du métabolisme protéique musculaire. Nutr Clin
Metabol 2011;25(3):138–51.
[21] Moize V, Geliebter A, Gluck ME, Yahav E, Lorence M, Colarusso T,
et al. Obese patients have inadequate protein intake related to protein
intolerance up to 1 year following Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg
2003;13(1):23–8.
[22] Moizé V, Andreu A, Rodríguez L, Flores L, Ibarzabal A, Lacy A, et al.
Protein intake and lean tissue mass retention following bariatric surgery.
Clin Nutr 2013;32(4):550–5.
[23] Torres AJ, Rubio MA. The Endocrine Society’s Clinical Practice Gui-
deline on endocrine and nutritional management of the post-bariatric
surgery patient: commentary from a European Perspective. Eur J Endo-
crinol 2011;165(2):171–6.
[24] Heber D, Greenway FL, Kaplan LM, Livingston E, Salvador J, Still C, et al.
Endocrine and nutritional management of the post-bariatric surgery patient:
an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab
2010;95(11):4823–43.
[25] Ziegler O, Sirveaux MA, Brunaud L, Reibel N, Quillot D. Medical follow
up after bariatric surgery: nutritional and drug issues. General recommanda-
tions for the prevention and treatment of nutritional deficiencies. Diabetes
Metab 2009;35(6 Pt 2):544–57.
1
/
4
100%